
Les monuments arabes de Tlemcen : Introduction
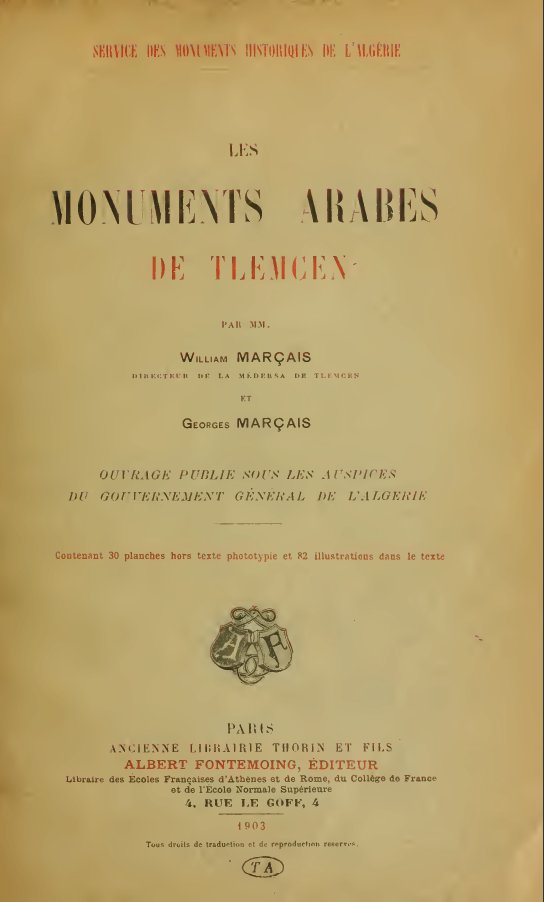
A mi-hauteur de la pente qui descend du Djebel Terni, enveloppée de massifs séculaires d'oliviers, de figuiers et de térébinthes, ayant à ses pieds le lapis changeant des vallées de la Tafna et de la Safsaf, Tlemcen, « la bien gardée de Dieu », occupe une des plus admirables positions que puisse choisir un faiseur de villes. Au Sud, elle a la couronne des plateaux rocheux ; au Nord, elle domine la plaine semée de villages, de marabouts et que ferme très loin la ligne souple des hauteurs. A l'Ouest, s'élèvent au milieu des champs de vignes les ruines grandioses d'El-Mansourah la guerrière ; à l'Est, au flanc de la montagne, se groupe le petit bourg sacré d'El-Eubbâd où dort le saint le plus vénéré du Maghreb.
Les chants populaires composés en l'honneur de la vieille cité sont innombrables ; et les écrivains d'école ont assemblé, pour décrire son charme, toutes les fleurs de la rhétorique arabe. Suivant Yahya-ben-Khaldoun : «Elle est semblable à une jeune fiancée sur son lit nuptial. Les palais de Tlemcen éclipsent le Khawernaq, font rougir Er-Roçâfa, et se moquent d'es-Sedir.
Les vallées fleuries qui l'entourent sont pleines do sources, étincelantes comme la lame qu'on tire du fourreau. » Et, après avoir épuisé les hyperboles, il cite successivement les poètes Abou- Abdallah-ben-Khemîs, El-Hâdj-ben-Abou-Jemâa, Ibn-Khafadja, Abou-Obaïd qui tous chantent à l'envi les grâces de la perle du Maghreb. Plus robuste et plus substantielle est la prose naïve de Jean Temporal, le traducteur de Jean-Léon dit Léon l'Africain, qui la visita au xvi" siècle : « Telensin, dit-il, est une grande et royale cité. Du temps du roi Abou-Tesfin, elle parvint jusques au nombre de seize mille feux, et si elle était accrue en grandeur, elle n'était pas moindre en civilité et honnête façon de vivre... Tous les marchands et artisans sont séparés en diverses places et rues, comme nous avons dit de la cité de Fez. Mais les maisons ne sont pas si belles ni de telle étoffe et Coutances. Outre cela, il y a de beaux temples et bien ordonnés. Puis se trouvent cinq collèges d'une belle structure ornés de mosaïques et d'autres ouvrages excellents dont les aucuns furent édifiés par les rois de Telensin et les autres par les rois de Fez... Il s'y trouve davantage un grand nombre d'hôtelleries à la mode africaine, entre lesquelles il en est deux où logent ordinairement les marchands genevois et vénitiens. Et sont les murailles merveilleusement hautes et fortes donnant entrée par cinq portes très commodes et bien ferrées, joignant lesquelles sont les loges des officiers, gardes, et gabelliers. Hors la ville se voient de belles possessions et maisons, là où les citoyens ont accoutumé en temps d'été demeuré pour le bel ébat qu'on y trouve, pour ce qu'outre la plaisance et belle assiette du lieu, il y a des puits et fontaines.
vives d'eau douce et fraîche. Puis, au dedans le pour pris de chacune possession, son des treilles de vignes qui produisent des raisins de diverses couleurs et d'un goût fort délicat avec des cerises de toutes sortes et en si grande quantité que je n'en vis jamais tant en lieu où je me sois trouvé.
Les habitants de Telensin sont divisés en quatre parties, écoliers, marchands, soldats et artisans. Les marchands sont pécunieux, opulents en possession, hommes justes ayant en singulière recommandation la loyauté et honnêteté de leurs affaires, et prenant merveilleusement plaisir à tenir la cité garnie, en sorte que, pour y faire conduire la marchandise, se transportent au pays des noirs. Les artisans sont fort dispos et bien pris de leurs personnes, menant une très plaisante vie et paisible, et n'ont d'autre chose qui leur revienne mieux que de se donner du bon temps. Les soldats du roi sont tous gens d'élite, et soudoyés suivant qu'on les sent suffisants et mettables, tellement que le moindre d'entre eux touche 300 ducats par mois... Les écoliers sont fort pauvres et demeurent aux collèges avec une très grande misère ; mais, quand ils viennent à être doctorés, on leur donne quelque office de lecteur ou de notaire, ou bien ils se font prêtres. Les marchands et citoyens vont honorablement vêtus, et le plus souvent mieux en ordre que ceux de Fez, parce qu'à vrai dire ils sont plus magnifiques et libéraux.
Ce tableau séduisant n'est malheureusement plus conforme en beaucoup de points à la vérité actuelle. Où sont « les cinq collèges d'une belle structure » où enseignèrent Sidi Senousi, le chérif Abou- Abdallah, Sîdi Ben-Merzouq El-Hafid, et le grand historien des berbères Abd er-Rahmân-Ben-Khaldoun, et tant de cheikhs si savants et si respectables ? Où est la Médersa Tâchfinîya dont le beau portail de mosaïque s’élevait naguère encore sur remplacement de la place d'Alger actuelle ? Mais il est trop tard pour se plaindre, pour déplorer le vandalisme des maitres de Tlemcen pendant les trois derniers siècles. Il faut se contenter d'admirer ce qui subsiste de la « grande et royale cité» et de conserver jalousement ces restes si intéressants par leur valeur d'art et leur importance historique.
Tout d'abord il nous parait indispensable de retracer dans ses grandes lignes le passé historique de Tlemcen. Nous le ferons bien entendu au seul point de vue qui nous occupe. Il ne s'agit pas ici de mettre en lumière le rôle exact que tint cette ville dans l'histoire générale de l'Afrique mineure depuis la conquête musulmane, mais de dresser simplement, en suivant le cours des âges, le bilan de ce que Tlemcen doit de gloire architecturale à chacun de ses anciens maîtres.
Agadir jusqu'à la conquête almoravide et à la fondation de Tagrârt. — Tlemcen est la Pomaria romaine. La ville antique était située sur le plateau où est aujourd'hui Agadir. Le nom de Pomaria a été relevé dans plusieurs inscriptions trouvées sur cet emplacement. On ignore ce qu'était exactement la localité à l'époque de la conquête musulmane. Son sol n'a pas fourni d'antiquités romaines ou byzantines de marque. Les incursions de la première invasion arabe durent passer sur Tlemcen comme sur le reste de l'Afrique mineure sans y laisser de traces sérieuses. Au témoignage d'Ibn-Khaldoun, elle aurait été conquise par Abou El Mohâdjir, lieutenant d'Oqba- ben-Nâfi, et, en souvenir do ce lointain événement, une source tlemcenienne aurait porté encore, à l'époque du grand historien, le nom de Aïn-El-Mohâdjir. Rappelons aussi pour mémoire une tradition locale qui fait do l'un dos saints les plus anciens do la ville, Sidi Wahhâb, un compagnon du prophète venu à la suite d'Oqba a la conquête du Maghreb et mort à Tlemcen. A l'époque héroïque du Khâridjisme, Tlemcen apparaît comme le siège d’une petite principauté çofrite avec, pour imam, Abou- Qorra. Mais, en 790 (174 de l’hégire), elle est conquise par Idris I er . C'est au nom de ce prince qu'est attachée la première mention historique d'une construction d'édifice à Tlemcen.
« Idris, dit l'auteur du Qartas, entra sans coup férir à Tlemcen, donna l’amân au peuple et édifia une belle mosquée qu'il orna d'une chaire sur laquelle il fit graver ces mots : « Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Cette mosquée a été élevée par les ordres de l'imam Idrîs-ben-Abdallah-ben- Hosaïn. »
Il importe de ne pas oublier qu'à celte époque, Tlemcen, c'est Agadir, et rien de plus-, et des monuments tlemceniens celui dont l'édification première remonte le plus loin dans le passé se trouverait donc être la mosquée d'Agadir. Elle subit au reste de fréquentes restaurations, reçut de nombreux compléments dans la suite des âges. Idris II y aurait retravaillé vingt-cinq ans après sa fondation ; les Omeyyades de Cordoue, les Beni-Zeiyân y ajoutèrent ou y firent des réparations. Sous la domination Idrîside, Tlemcen (Agadir) devint probablement une sorte de place avancée vis-à-vis de Tiaret la Khâridjite. La forte position du lieu engageait a s'y établir solidement. Aux âges suivants, nous en voyons le commandement confit'' par les Idrisides de Fâs à leurs cousins les descendants de Solaïmân- ben-Abdallah. Dès cette époque lointaine, Tlemcen apparaît comme une dépendance d'un empire marocain. Elle est la vassale de Fâs. Il en sera presque continuellement de même jusqu'au jour où Yarmoràsen, débarrassé de la tutelle almohade, érigera la ville en capitale d'un royaume indépendant. Mais cette longue tradition de vassalité pèsera lourdement sur les destinées de Tlemcen. Fréquemment, ses voisins de l'Ouest s'efforceront de la faire descendre de son nouveau rang, et de rétablir son antique dépendance vis-à-vis de Fâs et de Marrâkech.
La dynastie des Idrîsides ne tarda pas à être battue en brèche par deux puissances rivales, les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides. La branche de la famille idrîside fixée à Tlemcen gouverne tantôt sous l'une, tantôt sous l'autre de ces suzerainetés. Puis, à la chute définitive des descendants d'Idris I er, elle est remplacée dans le commandement de la ville par une famille d'émirs Maghràwa, les Beni-Khàzer, de la grande race berbère des Zenata. Ces princes acceptent l'investiture des Omeyyades de Cordoue.
Nous possédons des descriptions très sommaires de Tlemcen au IX siècle, laissées par des voyageurs et des géographes arabes. Ils la dépeignent comme une ville peuplée, dans une banlieue fertile, déjà construite et entourée d'un mur. Suivant Ibn-Haouqal (vers 950 de l'ère chrétienne), le mur est en brique ; suivant El-Yaqoûbi (vers 967 de l'ère chrétienne), il est en pierre et il est double. En 973, Tlemcen est prise et saccagée par Bologgin ez-Ziri, lieutenant des Fatimides dans le Maghrib ; ses habitants sont transportés à Achîr.
Mais la ville se relève de ses ruines avec le gouvernement des émirs Maghràwa, connus sous le nom de Beni-Yala. Préludant à son rôle de future capitale, elle peut être considérée alors comme le siège du gouvernement du Maghreb central. Au XI siècle, elle voit venir jusqu'il elle les hordes nomades de nouveaux envahisseurs, la tribu Hilâlienne des Zighba. Mais El-Bekri, qui écrit a cette époque (1067-1080), la dépeint comme une ville prospère et forte. Il y signale un reste de population chrétienne (?) et donne le nom de cinq de ses portes. L'emplacement de deux au moins peut facilement être déterminé : la première, la porte de Wahb, qui avait reçu le nom du vieux saint tlemcenien Sidi Wahb (Sîdi Wahhàb), était située auprès de son tombeau, au Nord du petit bois de Sidi Yaqoùb ; mention en est faite dans des textes bien postérieurs; la seconde, la porte de la montée (Bâb El-Aqba), était encore debout, il y a vingt ans. Située au levant d'Agadir, elle dominait le tombeau de Sidi Dâoudi. Ce personnage, le « maître du pays » avant Sidi Bou-Médyen, appartient lui-même au V e siècle. Sa coupole dut être édifiée pour la première fois à cette époque. Mais il n'y a plus rien d'antique à discerner dans le petit monument actuellement debout, auquel est attaché le nom du saint. Semblable à beaucoup de qouhbas tlemceniennes, il a dû subir, au cours des siècles, de fréquentes restaurations. Conquête almoravide. — Fondation de Tagrârt. — A la fin du XI siècle, Tlemcen change de maîtres. Dès 1079, le prince almoravide Yousouf-ben-Tàchfin envoie son général Mazdali contre la capitale maghrawienne. En 1001, il vient lui-même renouveler l'attaque, prend la ville, et soumet à son pouvoir tout le Maghreb central. Suivant une pratique dont l'histoire des peuples musulmans offre de nombreux exemples, il commença d'édifier une ville nouvelle à l'endroit où s'était dressé son camp ; ce fut sur le vaste plateau, situé à l'Ouest d'Agadir, à l'emplacement même de la ville moderne. Cette cité almoravide, Tagrârt, est la véritable ancêtre de la Tlemcen actuelle. De sou berceau, Agadir, la ville se transporta une première fois vers l'Ouest au XI siècle, par ce curieux procédé. Au XIV e siècle, elle sera sur le point île subir un nouveau et semblable déplacement, avec la construction de Mansourah. Nous renvoyons sur ce point au chapitre consacré aux ruines de cette localité. — Agadir prise, la nouvelle cité de Tagrârt demeura le siège officiel du Gouvernement. Les Almoravides y édifièrent un château-fort, qu'il faut probablement identifier avec le Qaçr el-qadîm. Tagrârt devait croître de plus en plus au fur et à mesure qu'Agadir déclinait, et survivre à cette dernière. Il semble certain qu'à la fin de la dynastie almoravide elle avait pris assez d'importance pour qu'on songeât à y édifier une grande mosquée. La date de 1136 (530 de l'hégire), relevée sur une inscription de la mosquée cathédrale de Tlemcen, montre qu'on avait travaillé, à cette époque, à une partie essentielle de l'édifice, la coupole du mihrâb.
Conquête almohade. — Tlemcen, après avoir été un des boulevards de l'empire almoravide, vit la chute de cet empire. Elle fut le théâtre de là bataille décisive que l'almohade victorieux, Abd-el-Moumin, livra au dernier almoravide, Tâchfîn- ben-Ali. Les Almohades avaient établi et fortifié leur camp dans la gorge qui ouvre le plateau rocheux dominant la ville au Sud (es-Sakhratein, les deux rochers). Tagrârt, puis Agadir furent prises, et Tâchfin-ben-Ali s'enfuit vers Oran où il trouva la mort (1145), Abd-el-Moumin, maître de la ville, la dévasta d'abord ; puis, peu après, il fit relever les remparts d'Agadir, augmenter ceux de Tagrârt, et travailla à la Grande Musquée. Ses successeurs l'imitent, accroissent et fortifient le vaste périmètre des murailles, surtout à l'époque de la lutte contre les Béni Ghânya (1185-1223). Yaqout, qui écrit à l'époque almohade, donne de Tlemcen la description suivante : « Tlimsân (un Tnni- sân) est formée de deux villes voisines, entourées de murs et distantes l'une de l'autre d'un jet de pierre. L'une est ancienne, l'autre nouvelle. La nouvelle, tracée par les Almoravides, s'appelle Tagrârt; c'est là que résident L'armée, les fonctionnaires et diverses classes de gens. La vieille ville, Agadir est habitée par la masse du peuple». Les derniers Almohades retravaillèrent vraisemblablement à la Grande Mosquée. La coupole primitive du tombeau de Sîdi Bou-Médyen à El-Eubbâd fut l'œuvre du quatrième de ces princes, Mohammed en-Nâcer.
Les Abd-el-Wâdites ; Tlemcen, capitale. — C'est à l'époque almohade que s'installèrent dans le pays de Tlemcen les ancêtres des plus célèbres de ces futurs maîtres. La grande famille berbère zenatienne des Abd-el-Wâd, refoulée du Sahara par l'invasion hilâlienne, remonta vers le Nord et vint s'établir dans la partie occidentale du département actuel d'Oran. A la même époque, leurs frères ennemis, les Beni-Mérîn, venaient occuper le pays qui va de la Molouya à Fâs.
D'abord gouverneurs du pays de Tlemcen pour les Almohades, les Emirs abd-el-wâdites, au déclin de cette dynastie, s'affranchissent de toute suzeraineté, C’est Yarmorâsen-ben-Zeiyân qui accomplit cet acte d'indépendance. Tlemcen devient capitale; un royaume du Maghreb central apparaît dans l'histoire, à la tête duquel les successeurs de Yarmoràsen se succèdent pendant près de trois siècles. Ibn Khaldoun résume en ces termes l'avènement de Tlemcen à une fortune plus haute : « Tlemcen est la capitale du Maghreb central, la métropole pro- tectrice des tribus zenatiennes qu'elle est toujours prête à abriter dans son sein... Pendant les guerres d'Ibn-Ghânya, elle a vu tomber autour d'elles de nombreuses forteresses, Qaçr- Adjiça, Zerqa, El-Khadhra, Metîdja, etc... Depuis lors, ces villes sont restées désertes. On n'y trouve plus un seul foyer habité, on n'y entend plus le chant du coq. Tlemcen, au contraire, a toujours vu sa prospérité augmenter, ses quartiers s'étendre, ses maisons, solidement construites en briques et en tuiles, s'élever et s'agrandir. Les enfants de Yarmorâsen-ben- Zeiyân, l'ayant prise pour siège de leur empire, y bâtirent de beaux palais et des caravansérails pour les voyageurs... Elle prit l'aspect d'une vraie capitale musulmane, siège d'un Khalifat». La tentative de Yarmoràsen ne va pas, du reste, sans rencontrer d'obstacles. Ses quarante-quatre ans de règne se passent en grande partie à repousser les attaques de ses voisins de l'Est et de l'Ouest. Ces derniers surtouts, les Mérinides, sous les successeurs de Yarmoràsen, chercheront à ramener le nouvel empire sous la suzeraineté de Fâs et de Marrakech. Ils y réussiront momentanément au cours du XIV e siècle, et, pendant vingt-cinq ans, ils seront maîtres de Tlemcen. Cet interrègne mérinide coupe en deux parties distinctes l'histoire de la dynastie des Beni-Zeiyân.
La première dynastie zeiyânide. — On distingue généralement la première branche régnante des Beni-Zeiyân sous le nom de dynastie Abd-el-Wâdite. Ces monarques construisirent beaucoup à Tlemcen. Le fondateur, Yarmoràsen, éleva le minaret de la Grande Mosquée. A l'histoire de cette construction se rattache une anecdote célèbre que l'on trouvera plus loin. La coupole qui recouvre le tombeau de l'imâm Mohammed Ben-Merzouq, à l'angle Sud-Ouest du bâtiment, date de la même époque; et, suivant la tradition, Yarmoràsen lui-même aurait été inhumé tout auprès. En même temps qu'il travaillait à la grande mosquée de Tagràrt, le monarque Abd-el-Wâdite n'oublia pas celle du vieil Agadir, il en fit réparer le dôme et le minaret. Ce dernier, tel qu'il subsiste jusqu'à nos jours, nous offre très vraisemblablement l'œuvre de Yarmorâsen. Ce prince travailla activement aux remparts de la partie occidentale de la Ville, dont les continuelles incursions de l'ennemi rendaient nécessaire le renforcement. Enfin les textes mentionnent qu'après la construction du minaret de la Grande Mosquée, Yarmorâsen abandonna le vieux château (El-Qaçr El-Qadim) pour des raisons de convenance personnelle et alla jeter dans la partie méridionale de la ville les fondations d'un nouvel édifice royal. C'est du Méchouar qu'il s'agit très vraisemblablement. Cette œuvre architecturale de Yarmorâsen ne fut point, au reste, le fruit de là paix; c'est au milieu de guerres continuelles que le premier des Beni-Zeiyân accomplit ses desseins de fondateur de capitale. A deux reprises, il dut évacuer Tlemcen, et le voyageur El-Abderi, qui visita la ville en 688, nous en trace un tableau assez triste : « Cette cité est très belle à voir, dit-il, et contient de magnifiques choses ; mais ce sont des habitations sans habitants, des maisons sans propriétaires, des lieux que personne ne visite. Les nuages pleurent les malheurs de la ville en versant leurs eaux, et les colombes sur les arbres déplorent sa destinée en poussant des gémissements».
Si pénibles qu'aient été ces débuts de L'empire zeiyânide, il n'en reste pas moins qu'il eut la chance d'avoir un fondateur qui régna près d'un quart de siècle; dès sa naissance, le droit à la vie du nouveau royaume s'affirma ainsi énergiquement. — Les successeurs de Yarmorâsen continuent d'embellir leur capitale au milieu des mêmes embarras. Le siècle que dure la dynastie Abd-el-Wâdite nous apparaît comme une époque de vie très intense, sous l'impulsion de monarques guerriers, bâtisseurs, protecteurs des arts et des sciences, braves et violents, souvent diplomates médiocres, mais animés d'une rare et tenace continuité de vues. Entre deux guerres, ils poursuivent l'œuvre architecturale du fondateur; et ces guerres ne sont pas toujours des razzias, de simples séries d'escarmouches. Elles mettent parfois en péril l'existence même de la cité abd-el-wâdite : telle celle qui eut pour épilogue le fameux siège de Tlemcen, et à laquelle est liée l'histoire de la fondation d'El- Mansourah. Deux ans avant le commencement de ce siège, sous le règne d'Abou-Saîd Otsmân, est élevé l'oratoire de Bel-Hassen, la plus richement décorée des mosquées tlemceniennes (1296). Quelques années après la délivrance du siège, le sultan Abou-Hammou fait construire la médersa, la zâwiya, la mosquée d'Oulàd-El-Imàm (vers 1310), et la mosquée du Méchouar, dans son palais « aussi grand que bien des villes » (1317 ; 717 de l'hégire). Son successeur Abou-Tâchfin, prince artiste, versé lui-même dans l'art du dessin, passe plus que tout autre pour avoir contribué à embellir sa capitale. Ce sont surtout des édifices civils que les historiens lui attribuent, des palais comme le dâr-es-soroûr, le dâr-abî-fihr, le dâr-el-moulk. Aucun n'est parvenu jusqu'à nous. Seule la Médersa Tàchfînîya, qui fut fut œuvre, était encore debout au milieu du siècle dernier, et ne fut complètement démolie que vers 1876. Dans son dernier état, selon toute vraisemblance, elle offrait surtout l'importante restauration qu'elle subit environ cent ans après sa construction, sous le règne d’Aboli El-Abbas Ahmed. Entre temps, Abou-Tàchfin faisait élever le minaret de la grande mosquée d'Alger (1323; 723 de l'hégire). Enfin il parait bien que le grand bassin, situé au Couchant de Tlemcen, sous les murs modernes de la ville, doit également être considéré comme son œuvre.
Cest dans la quinzième année du règne d'Abou-Tâchfin que tomba la dynastie abd-el-wâdite, première branche des Beni-Zeiyân. Le 27 de Ramadhân 737 (1 mai 1337), après un siège de deux ans, Tlemcen est prise d'assaut par le mérinide Abou El-Hasen ; Abou-Tâchfîn succombe dans une Lutte suprême en défendant le Méchouar. Pendant vingt -cinq ans, Tlemcen va obéir aux princes de la dynastie zenatienne occidentale.
L'interrègne mérinide. — Tlemcen n'eut pas à souffrir de ses nouveaux maîtres. Pendant Le quart de siècle qu'ils y régnèrent, ils la dotèrent de ses plus beaux monuments. Toutefois il paraîtra remarquable que, soit à dessein, soit par hasard, la ville même n'eut pas de part aux fastueuses constructions des Beni-Merin; tout au plus réaménagèrent-ils peut-être le vieux château (El-Qaçr El-Qadim), qui semble avoir été presque toujours la demeure de leurs gouverneurs. Mais ce fut, pour ainsi dire, la banlieue de Tlemcen, qui obtint leur pré- dilection de princes bâtisseurs. Les trois annexes architecturales de Tlemcen, Mansourah, Sidi Bou-Médine et Sidi El-Halwi sont leur œuvre. — Mansourah, œuvre des Mérinides, est antérieure à leur occupation de Tlemcen. L'histoire de la fondation, de la construction de son enceinte et de sa mosquée se rattache au premier siège de Tlemcen (1299; 698 de l'hégire). On la trouvera plus loin rapportée et discutée. Mais il parait certain que nombre d'embellissements apportés à «Tlemcen la Neuve », comme on appela El-Mansourah, ne datent que de l'interrègne mérinide. La construction d'un palais somptueux, une restauration probable de sa mosquée furent l'œuvre d'Abou El-Hasen Ali (vers 1348;
747 de l'hégire). — Bou-Médine doit aux Mérinides trois des édifices dont elle se fait gloire : la mosquée, la médersa, le petit palais. On peut dire qu'ils furent les véritables créateurs de cette localité.Enfin, sept années après Sidi Bou-Médyen, le Pôle, le Secours suprême, le patron par excellence de leur nouvelle conquête, un autre saint Tlemcenien très vénéré se vit aussi consacrer un oratoire par les magnifiques vainqueurs (Cf. infrà: Mosquée de SidiEl-Halwi).
Restauration de la branche cadette des Abd-el-Wâdites. — Dynastie Zeiyânide. — Dès 1349, les princes abd-el-wâdites Abou-Tsàbit et Abou-Saîd avaient réussi momentanément à reprendre au gouverneur mérinide la capitale de leurs ancêtres. Mais ils n'avaient pu s'y maintenir contre les armes triomphantes du mérinide Abou-Inàn. Aussi ne faut-il compter la restauration véritable des descendants de Yarmorâsen que de 1359 (760 de l'hégire). A cette date, Abou-Hammou Mousa II, petit-fils d’Abou-Zaïd, frère cadet du deuxième sultan abd-el-wâdite Abou-Saîd Otsmân, réussit à reprendre définitivement Tlemcen aux Mérinides. La dynastie issue de cette restauration est distinguée sous le nom particulier de dynastie zeiyânide. Cette royauté de la branche cadette des Beni-Zeiyân est loin d'égaler en gloire celle de la branche ainée. Elle dura deux cents ans ; mais l'histoire des vingt-cinq princes qui s'y succèdent offre presque sans interruption le triste spectacle de meurtres, d'usurpations, d'appels à l'étranger. Deux seulement des monarques zeiyânides, le restaurateur de la dynastie, Abou- Hammou II, et Abou'l-Abbâs Ahmed, le treizième souverain, ont des règnes un peu longs. Les autres ne demeurent guère sur le trône que quelques années, certains quelques mois. L'impuissance du malheureux royaume zeiyânide à vivre avec quelque grandeur se manifeste par les continuelles interventions d'abord des Mérinides, qui se considèrent toujours comme suzerains «les monarques tlemceniens, et des Hafcides de Tunis, plus tard des Espagnols et des Turcs, jusqu'au jour où, sous le cimeterre de ces derniers venus, la dynastie zeiyânide s'éteint définitivement. Naturellement, dans celte précarité du pouvoir, les constructions sont rares; le nombre des monuments zeiyânides est fort restreint et leur importance médiocre. Le premier des princes zeiyânides, Abou-Hammou II, fut, à beaucoup d'égards, le plus glorieux. Son secrétaire et historiographe Yahya-ben-Khaldoun, frère du grand historien des Berbères Abder-Rahmân-ben-Khaldoun, nous a abondamment renseigné sur son long règne. Abou-Hammou II, né et élevé en Andalousie, s'efforça de réunir à sa cour des savants et des littérateurs. Il composa lui-même de nombreuses poésies et un traité politico-littéraire sur l'art de régner. En butte aux intrigues de son fils Abou-Tâchfin et aux retours offensifs des Mérinides, il réussit à se maintenir trente ans sur le trône jusqu'à ce qu'un parricide vînt mettre fin à ses jours 1389 ; 791 de l'hégire, Yahya-ben-Khaldoun nous a laissé de pré-cieux renseignements sur la capitale zeiyânide à l'époque d'Abou-Hammou. D'une masse de descriptions enthousiastes et de poèmes hyperboliques en l'honneur de la cité, il reste à retenir que Tlemcen avait alors cinq portes facilement identifiables. Le périmètre de Tlemcen, à la fin du XIV e siècle, peut par là être à peu près exactement déterminé (cf. infrà : Enceinte de Tlemcen). L'œuvre architecturale d'Abou-Hammou comprend d'abord la restauration de partie de l'enceinte, et du Méchouar, ruinés par le mérinide Abou El-Abbâs en 789, et surtout la construction de la médersa, de la mosquée, et de la qoubba de Sidi Brâhîm. Ces deux derniers monuments sont seuls debout aujourd'hui. L'histoire de leur fondation sera exposée plus loin (cf. infrà: Mosquée de Sîdi Brâhîm). Il faut mentionner encore parmi les œuvres d'Abou-Hammou la construction d'une bibliothèque attenante à la Grande Mosquée. Enfin un certain nombre de petits oratoires tlemceniens doivent appartenir à l'époque de la restauration zeiyânide, au règne d'Abou-Hammou ou à celui de ses successeurs. Mais le témoignage historique de l'activité architecturale, apparemment médiocre des premiers Zeiyânides, nous fait défaut, et il faut descendre jusqu'au règne d’Abou El-Abbâs Ahmed, le treizième de ces princes, pour trouver la mention certaine de constructions d'édifices. Abou El-Abbas restaura la médersa Tâchfinîya. A la suite d'un soulèvement populaire inspiré par l'un de ses neveux, Abou-Zeiyân Mohammed, il fit, au dire de l'historien Tenesi, élever les murailles du Méchouar, « ce qui causa grandement dommage aux propriétaires voisins, dont on dut abattre les maisons. C’est également à ce prince qu'il faut attribuer la construction de l'oratoire, aujourd'hui ruiné (à l'exception du minaret) du petit village de Sîdi-Lahsen, dans la banlieue orientale de Tlemcen. Il fut consacré à la mémoire de son ami et conseiller, le pieux Sidi Lahsen Ben-Makhlouf er-Râchidi, après la mort de ce personnage. A la même époque semble appartenir le minaret de la petite mosquée du Derb-Msoufa, à Tlemcen, qui porte le nom du Cheikh Senousi. Ce savant, mort à la fin du XV e siècle, y enseignait déjà de son vivant. Enfin il n'y a guère à attribuer aux Zeiyânides postérieurs que la construction de la qoubba de Cheikh Senousi. Ce petit édifice fut élevé, très vraisemblablement, quelques années après la mort, du grand théologien, vers 1490-15O0. C'est à cette époque que Léon l'Africain visita Tlemcen et en laissa la description, qu'on a pu lire en tête de cette étude (cf. suprà, p. 8, 9).
La domination turque à Tlemcen. — Les Turcs furent les derniers maîtres de Tlemcen avant nous. Il est à noter que les chérifs marocains, héritiers des traditions mérinides, cher- chèrent à deux reprises à rattacher, par la conquête, Tlemcen à leur empire. Ils furent victorieusement repoussés par les soldats de l'Ojàq. La vieille capitale, désormais simple annexe du beylik d'Oran, subit entre les mains de ces nouveaux maîtres une profonde décadence. Elle se dépeupla, son enceinte se réduisit, des quartiers entiers tombèrent en ruines. Lorsque nos troupes entrèrent à Tlemcen pour la première fois, un cinquième au plus de la ville primitive était encore habité. L'extrême négligence des nouveaux occupants laissa sans entretien la plupart des édifices. Le Méchouar, citadelle de la garnison tlemcenienne, conserva son enceinte de murs; mais beaucoup des constructions que contenait cette véritable ville tombèrent à terre. Les dégradations de Sidi EI-Halwi, du petit palais de Sidi Bou-Médine, d'Oulàd el-Imâm doivent dater de cette époque. Tlemcen fut simplement pour les Turcs une place de garnison. Leur occupation n'y a point laissé de souvenirs épi- graphiques ou archéologiques. Dans la masse variée des inscriptions tlemceniennes, funéraires, votives, dédicatoires, on n'a pas relevé, à notre connaissance, une seule inscription turque, alors qu'Alger en offre un grand nombre. Le seul monument de quelque importance qui soit l'œuvre des Turcs nous semble la qoubba de Sîdi Bou-Médyen. On pont, affirmer que, dans son dernier état, la plus grande partie de cette qoubba est une œuvre turque. Une inscription qui figure sur la porte d'entrée du tombeau donne la date de 1208 (1793 de l'ère chrétienne), et le nom du bey d'Oran Mohammed El-Kebir. La restauration de la coupole en bois de la médersa de Sîdi Bou-Médiène doit également dater de cet âge. Une tradition rapportée par Barges attribuait la construction même de l'édifice au bey Mohammed. Une autre tradition, recueillie par nous de la bouche de vieux Boumédinois, rapporte à ce même personnage l'aménagement, actuellement subsistant, de la maison de l'oukil; cet édifice aurait été auparavant une zâwiya pour les pèlerins. Enfin les deux tombeaux de Sidi Abdallah Ben-Mançour et de Sîdi Mohammed Ben- Ali, à Aïn-el-Hout, sont également datés par les inscriptions l'un de 1804 (1218 h; — beylicat de Mostafa El-Manzali), l'autre de 1761 (1174 h; beylicat d'Ibrahim El-Miliani).
C'est, comme on le voit, aux Almoravides, aux Almohades, aux Abd-el-wâdites et surtout aux Mérinides de Fâs que Tlemcen doit ses embellissements successifs. En dehors de la Grande Mosquée, les monuments Tlemceniens appartiennent pour la plupart à l'époque qui va des dernières années du XIII e siècle au milieu du XIV e siècle. Contemporains des grands monuments de Grenade, ils forment un groupe se rattachant à la période de plein épanouissement du style andalou, lui-même rejeton vigoureux de l'art arabe. Cette époque, qui voyait en France s'élever les savantes architectures de Saint-Urbain de Troyes, de Saint-Nazaire de Carcassonne et de Saint-Ouen de Rouen, était aussi marquée, dans la péninsule ibérique et dans le Maghreb, par l'apparition des plus beaux spécimens de cet art ingénieux et fragile que les Orientaux y avaient transporté avec eux.
Les origines étrangères de l’art arabe d’Orient. — A vrai dire, lors delà conquête de l'Espagne (709), l'art arabe n'avait pas pris nettement conscience de lui-même : il manquait de formules traditionnelles et d'ouvriers.
Les premières mosquées d'Orient avaient eu le plus souvent, pour architectes, non des Arabes, mais des artistes ayant déjà fait leurs preuves, dans le pays récemment conquis ou dans les pays voisins. Il n'est pas jusqu’au vieux sanctuaire préislamique de la Kaâba dont une tradition curieuse ne veuille faire l'œuvre d'un architecte copte venu d'Alexandrie. C'aurait été, d'autre part, un chrétien d'Egypte, qui construisit la première mosquée d'Amr ben-El-Aci àFostàt (El-Jâmi El-atiq), un chrétien encore, qui bâtit la mosquée- d'Ahmed ben-Touloun au Caire, en 879. Les Perses aussi furent souvent employés comme architectes.
« Quand les Arabes, dit Ibn Khaldoun, eurent cessé d'observer les préceptes stricts de leur religion, et quand le goût d'une vie luxueuse et de la domination les eut pris, ils apprirent des Perses subjugués les arts et l'architecture, et bâtirent des édifices somptueux». Enfin et surtout les Grecs eurent un rôle important dans la formation de ce qui devait être l'art arabe. Le calife El- Walid fils d'Abd-el-Malik, fit venir douze cents ouvriers de Constantinople pour reconstruire la mosquée de Damas. Longtemps les Omeyyades eurent auprès d'eux des maîtres byzantins qui formèrent des disciples arabes. — Parfois les souverains musulmans se contentèrent de désaffecter les temples des religions vaincues pour les accommoder au nouveau culte : l'Eglise Saint- Jean de Damas en fournit un exemple célèbre. Très souvent aussi des morceaux d'architecture étaient arrachés aux édifices existants pour être utilisés dans les mosquées.
L'art arabe en Espagne et dans l'Afrique du Nord. — Ces collaborations, ces emprunts se continuèrent dans le Maghreb et en Espagne quand les Arabes en furent maîtres. Oqba ben Nâfi construit la mosquée de Kairouan, et c'est « une véritable forêt de colonnes à chapiteaux antiques de toutes provenances 3 ». Pour élever le palais de Zahra, près de Cordoue (commencé en 936), Abd-er-Rahmân III réunit les architectes et les artistes les plus habiles de Bagdad, de Constantinople et d'autres lieux. Dans ce même palais, on trouvait des colonnes empruntées aux édifices d'Asie Mineure, d'Italie, à une église chrétienne de Sfax, des cuves de marbre, apportées de Jérusalem par un personnage que les historiens arabes désignent sous le nom de « Rabi l'évêque ». De fréquents rapports existent entre les califes de Cordoue et les empereurs de Byzance. L'examen des monuments moresques d'Espagne des VIII e, IX c et X e siècles en montre nettement les effets.
Première période, arabo-byzantine. — Le plus noble représentant de cette première période est le vénérable édifice de la mosquée de Cordoue (commencée en 786), l'ancêtre de toutes les mosquées d'Espagne et du Maghreb. Il faut citer, à côté, une mosquée de Tolède, maintenant église Del-Cristo de la Luz (965), des bains publics à Grenade et à Barcelone, enfin quelques fragments du cloître de Tarragone.
Les caractères qui distinguent cette première période sont, outre l'emploi de matériaux, de systèmes d'appareillage et de charpente antiques, la forme des arcades généralement en fer à cheval, souvent découpées en festons, ne présentant jamais l'ogive, qui était cependant en usage dans les monuments d'Egypte contemporains, l'emploi du dôme hémisphérique qui venait de Byzance, la forme des chapiteaux, copies grossières de types corinthiens et composites, l'emploi dans les arcades des voussoirs colorés ou alternativement lisses et colorés, enfin le style des décors garnissant les surfaces, palmettes, entrelacs, tout à fait semblables à ceux qu'on observe sur les monuments byzantins de Constantinople, de Ravenne et de Venise.
L'influence byzantine, très reconnaissable dans les monuments d'architecture, est peut-être plus tangible encore, dans les produits de l'art industriel espagnol, qui ne se distinguent guère, que par des inscriptions arabes, des objets analogues d'art byzantin.
Deuxième période. — Transition. — Une période de transition, où l'art arabe occidental se dégage lentement de l'imitation byzantine, remplit les deux siècles qui suivent (XI et XII ), période assez mal connue par suite du petit nombre des monuments étudiés. L'énigmatique chapelle de Villaviciosa à Cordoue, la tour de la Giralda et quelques parties anciennes de l'Alcazar de Séville, tels sont, les spécimens dont l'examen a pu jusqu'ici servir aux archéologues à déterminer les caractères de cette phase intéressante. Il faut y ajouter les palais Siciliens de la Cuba et de la Zisa, qui datent vraisemblablement du XII e siècle, époque de l'occupation normande. « De nouvelles recherches..., disait Girault de Prangey, pourront compléter, un jour, les notions qu'il a été possible de recueillir sur les édifices de cette époque intermédiaire entre Cordoue et Grenade ». C'est du Maroc surtout, qu'il faut attendre, à notre avis, les documents les plus importants sur cette période intéressante de l'architecture maghrébine. Les grandes mosquées de Fàs et de Marrakech, sinon dans leur ensemble, au moins dans leurs parties principales semblent dater de cette époque. Tous ceux qui s'intéressent à l'art musulman d'Occident doivent impatiemment désirer le jour où paraîtra une description complète, appuyée d'une illustration abondante, de la Kotoubîya de Marrakech, de la Qarawiyîn de Fâs, de la tour de Hassan à Rbât. Enfin, parmi les monuments qu'on trouvera étudiés plus loin, la Grande Mosquée de Tlemcen, qui fut construite vers 1136, nous offre un document de première importance. Encore toute imprégnée de tradition byzantine, elle marque cependant, comme nous tenterons de le montrer, un pas en avant vers une formule d'art plus libre et plus raffiné.
Troisième période. — Art moresque. — C'est à Grenade qu'eut lieu l'éclosion de cet art à la fois léger et touffu, fragile et foisonnant, qui intéresse et séduit davantage par l'ingéniosité du détail que par la composition d'ensemble, à qui manqua le plus souvent le sentiment de la grandeur d'aspect et le souci de la noblesse de la matière.
L'Alhambra en est le modèle le plus achevé. Les princes artistes des Beni El-Ahmar, ayant fait de Grenade le siège de leur empire, transformèrent en un palais de rêve la vieille citadelle, dont dès le XI e siècle Sawar ibn-Hamdoun el-Qaisi avait jeté les premiers fondements. Le père de la dynastie, Mohammed ech-Chîkh commença l'œuvre, et, pendant deux siècles, ces successeurs y travaillèrent, ajoutant des salles, des portes, une mosquée, des bains, des jardins intérieurs, enrichissant le décor, inscrivant tour à tour leurs noms et leurs devises dans l'éblouissant revêtement des murs. — Plus encore que l'Alhambra, l'Alcazar de Séville subit des modifications sous ses maîtres successifs. Un examen un peu attentif de ce palais montre qu'il peut difficilement servir pour étudier l'évolution du style. L'homogénéité de ses garnitures, qui, si nous les comparons à celles des monuments d'une date plus certaine, semblent rattacher celui-ci aux dernières années du XIII e siècle, n'est en effet qu'apparente. Un goût archéologique curieux poussa ses possesseurs chrétiens à le restaurer presqu’en entier dans le style moresque de cette époque. Plusieurs salles portent dans un cartouche, en caractères coufiques d'une belle allure, l'inscription suivante : « Gloire à notre maître le sultan don Pedro. » Un tel « truquage », s'il jette un jour intéressant sur les prolongements de l'influence arabe, sur les rapports sans haine établis entre vainqueurs et vaincus, sur le dilettantisme très moderne des princes espagnols de la fin du XIV e siècle, doit faire prudemment rejeter tous les renseignements archéologiques qu'on pourrait puiser à l'Alcazar.
Déjà la note sommaire, mais précise, que ce savant a fait paraître dans le Journal Asiatique sur la mosquée de Tin-Mil, retrouvée par lui, peut être considérée comme un document fort important (janvier-février 1902). Nous lui sommes personnellement redevables de la communication de bonnes photographies du minaret de la Kotoubiya.
Il semble bien que les monuments de Tlemcen aient été, moins que ceux d'Espagne, soumis aux courants de la mode. C'est que nous n'avons pas à faire dans la cité maghrébine à des palais que chaque maître s'efforce d'accommoder au goût du jour où à ses convenances personnelles. Les résidences royales de Tlemcen ont disparu tour à tour, le Méchouar abd-el-wâdite, comme le château mérinide de Mansourah. Ce qui nous reste à étudier, ce sont des mosquées, de proportions réduites, auxquelles on n'a guère touché après leur fondation. Chaque monarque préfère en élever une autre à côté de celle de son prédécesseur, et s'acquérir par cette œuvre, toute personnelle, des mérites auprès de Dieu. Chez un peuple resté fidèle à la religion musulmane, assez respectueux des traditions, ayant, d'ailleurs perdu toute initiative créatrice, toute habileté artistique, les édifices religieux ont pu subsister et parvenir jusqu'à nous, attaqués par le temps sans doute, mais n'ayant pas eu trop à souffrir des hommes, ruinés parfois, mais rarement déformés par des embellissements maladroits.
On ne trouve pas ici de ces œuvres de « recherche » comme la plupart de nos cathédrales gothiques, où se sente le travail lent et inquiet, l'apport laborieux des générations successives. Les mosquées de Tlemcen semblent plutôt des conceptions de princes artistes et croyants, vite réalisées par des ouvriers habiles. Leurs dimensions généralement restreintes, la simplicité du plan, la commodité des matériaux employés, tout facilitait la promptitude de l'exécution et assurait par conséquent l'homogénéité du style.
Architectes et ouvriers. — On ne saurait relever avec trop de soin les noms d'architectes et d'artistes musulmans fournis par les textes épigraphiques et historiques. Utilisés avec réserve et critique, ils peuvent constituer de bons documents pour l'histoire encore obscure de l'art arabe. Malheureusement dans le Maghreb, comme en Orient, les renseignements précis sur la personne des constructeurs et des décorateurs sont extrêmement rares. Une tradition nous fournit le nom incertain de l'architecte qui aurait élevé à la fois la tour de Rbât, la Giralda, et le minaret de la Kotoubîya. Un texte historique nous mentionne l'auteur des boules dorées qui décoraient la Giralda; et là s'arrêtent nos informations sur les artistes almohades. Particulièrement, pour ce qui concerne les édifices tlemceniens, c'est de quelques textes épars, que l'on peut établir sur l'origine des artistes mérinides ou abd-el-wâdites, d'assez fragiles conjectures. Le nom même que nous fournit l'inscription commémorative tracée à la coupole de la Grande Mosquée n'est pas celui de l'architecte ; c'est, comme il arrive le plus souvent, celui de l'intendant des travaux, du fonctionnaire «sous la surveillance duquel on a élevé l'édifice. »
Pour ce qui concerne la période abd-el-wâdite, il faut toutefois considérer comme assez important le passage suivant d'Ibn-Khaldoun : «A l'époque d'Abou-Hammou I er et de son fils Abou-Tâchfîn, les arts étaient très peu avancés à Tlemcen, parce que le peuple, qui avait fait de cette ville le siège de son empire, conservait encore la rudesse de la vie nomade; aussi ces princes durent s'adresser à Abou El-Walîd, seigneur de l'Andalousie, afin de se procurer des ouvriers et des artisans. Le souverain espagnol, maître d'une nation sédentaire chez laquelle les arts avaient nécessairement fait beaucoup de progrès, leur envoya les architectes les plus habiles de son pays. Tlemcen s'embellit alors de palais tellement beaux que depuis on n'a jamais rien pu construire de semblable». Ce renseignement vient jeter une clarté nouvelle sur l'étroite parenté qu'un examen archéologique révèle entre les monuments grenadins et les édifices abd-el-wâdites. D'après un autre historien, Abou Tàchfin aurait employé à ses coûteuses constructions des milliers d'esclaves chrétiens ? Tant architectes, que maçons, faïenciers, doreurs et peintres. Enfin, l'on verra plus loin ; que des carreaux de faïence, figurant dans un monument abd-el-wâdite, la mosquée du Méchouar, sont sûrement de fabrication andalouse. Les premiers souverains de la dynastie tlemcenienne auraient donc tiré de la brillante Espagne à la fois des équipes d'ouvriers et des matériaux pour la décoration des édifices de leur capitale. Ils ne furent jamais cependant que des souverains du Maghreb, tandis que leurs frères ennemis, les Mérinides, furent des monarques à la fois africains et andalous. Aussi parait-il légitime de présumer que la collaboration d'artistes espagnols n'est pas étrangère à la réelle beauté des monuments dont ces derniers princes dotèrent Tlemcen conquise. Une inscription du minaret de Nedromah fournit le nom d'un architecte de cette époque. Malheureusement ce nom est de lecture incertaine et l'ethnique qui l'accompagne est difficilement identifiable. Un autre texte épigraphique tlemcenien, nous fait connaître un artiste d'ordre secondaire de la période mérinide. C'est l'inscription funéraire du sculpteur sur bois qui construisit le minbar de la mosquée de Sidi Bou-Médine. Ce personnage est qualifié de el-Djaziri, el-Marrâkchi, c'est-à-dire né à Algérisas et fixé par la suite à Marrakech. C'était donc un andalous d'origine. Quant au nom d'Ahmed el-Lamti qui figure sur une colonne de la mosquée de Sîdi El-Halwi, il faut résolument renoncer à suivre Brosselard lorsqu'il propose de voir dans ce personnage le sculpteur de la colonne portant son nom et du chapiteau qui la surmonte. Un examen attentif nous a révélé la présence, sur le fût de la colonne, d'un cadran solaire. C'est ce cadran et non la colonne qu'Ahmed el-Lamti a signé. L'inscription où figure son nom, nous offre un intéressant spécimen tlemcenien de coufique astronomique, et un fac-similé en sera donné plus loin. Mentionnons encore la curieuse légende rapportée par Barges et qui fait venir d'Espagne le revêtement de bronze des portes de Sidi Bou-Médiène. Peut-être L'imagination populaire n'a-t-elle fait à ce propos qu'embellir d'incidents merveilleux une vieille tradition relative à l'origine andalouse de ce remarquable travail.
Ce n'est guère que dans la période de pleine décadence, à l'époque turque et à celle d'Abd-el-Kader, que l'on rencontre des signatures d'artistes sur des monuments tlemceniens. Dans le décor de plâtre, qui orne l'entrée du tombeau de Sidi Bou- Mediène, est inscrit le nom d’El-Hâchemi Çarmachîq, avec la date de 1208 de l'hégire (1793). Ce personnage appartenait vraisemblablement à une famille d'ouvriers d'art turcs, fixés à Tlemcen ; car nous retrouvons les noms de deux autres Çarmachiq sur des inscriptions d'une mosquée de Mascara, avec cette mention qu'ils sont originaires de Tlemcen. Enfin l'ouvrier en bois qui fit le minbar de la mosquée de Sidi Brâhîm en 1832 (1218 H) a également signé son œuvre ; il s'appelait Ben-Ferfara, et c'est à lui encore que la tradition attribue la chaire de la mosquée de Sidi Bou-Médine édifiée par l'ordre d'Abd-el-Kader vers 1843.
Le Plan. — Le plan du temple tlemcenien, c'est celui qu'on retrouve en Orient comme en Espagne, à la mosquée d'Amr comme à la mosquée de Cordoue, avec ses éléments vraisemblablement dérivés de la basilique byzantine. La porte principale, placée le plus souvent dans le grand axe du monument, donne entrée dans le çahn, sorte d'atrium rectangulaire bordé sur trois faces par des portiques à une ou plusieurs nefs. Au milieu se trouve le mîdha, le phiala byzantin, où de l'eau courante sert aux ablutions rituelles. Du côté du çahn opposé à la porte, s'ouvrent des nefs parallèles, qui constituent la véritable salle de prière. Ces nefs sont, dans les mosquées antérieures au XV e siècle, perpendiculaires au mur de la façade principale. Percé dans le mur du fond, suivant le grand axe, se trouve ce qui tient lieu de sanctuaire, dans ces temples sans mystères et sans idoles, le mihrab sorte d'abside atrophiée, indiquant aux fidèles la direction de la Kaba de La Mecque, le pôle du monde musulman. C'est là que se place l'imâm dirigeant la prière des fidèles. Une coupole précède presque toujours la niche du mihrâb, qui fait extérieurement saillie sur le mur du fond. Parfois, une seconde coupole s'élève au centre de la salle de prière, dans la nef médiane, plus large que les autres, cette disposition, fréquente en Orient, rappelle Sainte-Sophie de Constantinople.
L'établissement de la coupole précédant le mihrâb nécessite un plan carré inférieur. Il en résulte que la travée qui longe le mur du fond doit être égale, en largeur, à la nef médiane, généralement plus large que les autres nefs. En plan, la rencontre de la travée du fond et de la nef médiane engendre la forme T, dont on a signalé l'analogie avec la forme en tau des églises chrétiennes primitives. Cette disposition ne devait rien avoir, au reste, de traditionnel ni d'obligé. Il est en effet curieux de remarquer que, visible dans les mosquées mérinides, elle ne se retrouve pas dans le plus ancien des temples tlemceniens; nous décrirons, en étudiant cet édifice, la tricherie qui a permis de négliger celle égalité (cf. infrà Grande Mosquée).
Orientation des mosquées. — Nous ne saurions aborder ici d'une façon générale la délicate question de l'orientation des mosquées. L'histoire de la qibla dans les différents pays que soumit successivement la conquête musulmane mériterait sûrement l'honneur d'une sérieuse monographie, pour laquelle les historiens, les géographes, et surtout les traditionnistes offriraient d'importants documents. Nous marquerons simplement d'une façon sommaire, quelques points concernant l'orientation des oratoires tlemceniens.
La tradition veut que remplacement de leurs mihrâb ait été déterminé par l'observation des astres et plus particulièrement de la constellation d'Orion (El-Jaouza). Il s'en faut de beaucoup que ce procédé primitif ait assuré l'unité de l'orientation dans les mosquées tlemceniennes. D'un édifice a un autre, la direction de la qîbla est assez variable. Elle va du Sud-Sud- Est à l'Est-Sud-est. Il ne semble pas cependant, pour la plupart des édifices religieux, que les sultans mérinides ou abd-el-wâdites aient été gênés dans l'orientation de leurs constructions nouvelles par la présence de constructions voisines préexistantes. Les mosquées de Mansourah, de Sîdi El-Halwi, de Sidi Bou-Médiène, par exemple, ont été élevées, pour ainsi parler, en rase campagne, ce qui n'empêche pas que chacune d'elles nous offre une orientation différente. Aucun obstacle de cette nature ne parait non plus avoir existé pour la plupart des oratoires situés à l'intérieur de la ville. Dans tous les cas, le souci d'une orientation un peu exacte aurait pu alors donner l'idée d'un procédé constructif qui se rencontre parfois en Egypte : la disposition oblique du mihrab dans la muraille. Or cette disposition ne se rencontre dans aucune des mosquées tlemceniennes. L'axe du mihrab y est invariablement perpendiculaire au mur qui contient sa niche. C’est donc que le souci dont nous parlons n’a point existé chez les constructeurs tlemceniens. Plus tard, il est vrai, des scrupules sont nés. Des voyageurs ont dénoncé l'orientation inexacte des mosquées maghrébines, et aujourd'hui il n'est pas rare que de pieux musulmans, lorsqu'ils font la prière à la Grande Mosquée de TIemcen, ne se tournent légèrement vers la gauche du mihrâb.
D’une façon sommaire nous pouvons distinguer comme il suit l'orientation des principales mosquées tlemceniennes : Sud- Sud-est la Grande Mosquée, la mosquée de Bou-Médiène, la mosquée de Sîdi Brâhîm; Sud-est les mosquées de Bel-Hassen, d'Oulâd el-Imàm, de Sîdi El-Halwi, de Sidi Lahsen; Est-Sud- Est la mosquée de Mansourah, et aussi les oratoires ruinés d'Eubbâd es-Sefli, y compris probablement le monument que l'on désigne couramment sous le nom de Qoubba de Sidi Bou- Ishâq et-Tayyâr.
Nous donnons ce classement rapide sans nous hasarder à en tirer aucune conjecture. En outre nous appellerons qibli, ou Sud, le côté de la qibla, jaoufi ou Nord, le côté opposé à la qibla, gharbi ou occidental, le côté situé a droite du mihrâb pour un observateur qui fait face à sa niche, charqi ou oriental, le côté situé à gauche. Ces désignations, si peu exactes qu'elles soient, au point de vue d'une détermination rigoureuse de l'orientation, se retrouvent au reste dans des textes relatifs aux mosquées tlemceniennes.
Mobilier. — C'est dans la salle de prière que se trouve le minbar, chaire de l'imam, sorte d'escalier de bois adossé au mur du fond, généralement à droite du mihrâb, le sedda (banc) du haut duquel le mosammi reproduit pour les fidèles éloignés les attitudes de l'imâm, et leur « fait parvenir » sa prière. Le sedda, dont nous ne trouverons que deux exemples à Tlemcen, est généralement composé d'un plancher surélevé, auquel un escalier donne accès, et qui porte une balustrade sur ses quatre faces; il est ici placé dans l'axe du monument et occupe toute la nef centrale. C'est, là enfin qu'on trouvait la maqçoura, enceinte permettant aux sultans de faire la prière en sûreté. Toutes ces pièces d'ameublement ne sont d'ailleurs point indispensables, et ne se rencontrent que dans les mosquées où l'on célèbre le service solennel du vendredi.
L'ameublement des mosquées tlemceniennes est, comme on le voit, fort sommaire, et en outre, il est très peu artistique. Les ouvrages de boiserie n'occupent pas un rang d'honneur dans la vieille cité abd-el-wâdite. On n'y trouve par exemple aucun spécimen de ces beaux pupitres à Coran [Koursi] qui font l'orgueil de certaines mosquées égyptiennes. Le sedda est fruste; les minbars sont simples, massifs, et font triste figure à côté de la belle chaire de style byzantin de la mosquée de Kairouan. Cependant, au dire de vieillards de Sîdi Bou-
Médiène, la mosquée de cette localité possédait encore, au siècle dernier, un minbar mérinide précieusement sculpté et incrusté d'ivoire. Il aurait été mis en pièces dans les troubles qui suivirent la première apparition des troupes françaises à Tlemcen.
Dépendances. — Des dépendances d'importance variable s'ajoutent à ces temples : d'abord le minaret (dans toute l'Afrique du nord çaouma), la tour du haut de laquelle le moueddin lance cinq fois par jour la profession de foi musulmane et l'appel à la prière. Accolé à l'un des murs de la musquée, souvent au mur de façade, le minaret tlemcenien est toujours construit sur plan carré, et rappelle la Giralda de Séville. Un parapet entoure la plate-forme. Il est généralement crénelé de nierions en trapèzes dentelés. Un édifice terminal, également carré, sorte de campanile décoré de fausses arcade- e< percé de la porte de l'escalier, s'élève au milieu de la plateforme. Il est surmonté d'ornements de cuivre, couronnes ajourées, boules et croissants. Construit généralement en dernier lieu, le minaret n'apparaît pas comme une dépendance essentielle delà mosquée. Il semble bien que la Grande Mosquée de Tlemcen s'en soit passée pendant prés de soixante-dix ans; de même la mosquée Qarawiyin à Fàs, la Kotoubiya a Marrakech et la Grande Mosquée d'Alger, n'eurent des minarets que de longues années après leur fondation.
Une autre dépendance, qui, elle aussi, n'est en usage que dans les mosquées cathédrales, est la « chambre du prêche ». Appuyée au mur du fond derrière le mihrâb, dont elle enveloppe en quelque sorte la saillie, cette salle très simple, en appentis, communique avec la mosquée par une petite porte percée à gauche du mihràb. C'est de cette petite chambre que sort le prédicateur, lorsqu'à l'office solennel du vendredi il se dispose à monter au minbar pour prononcer le sermon prescrit par la loi religieuse. Un curieux passage d'El-Bekri autoriserait presque à en voir l'origine dans une extériorisation de la maqçoura; et de fait à Tlemcen, cette salle est fréquemment appelée maqçoura, mais son nom le plus courant est
« chambre des morts . C'est qu'a Tlemcen une coutume plus ou moins ancienne veut que, aux enterrements qui ont lieu le vendredi et les jours de grandes fêtes, on introduise le brancard funèbre dans cette salle pour que l'imam fasse sur le cadavre la prière des funérailles. C'est la une pratique légèrement hétérodoxe, peu compatible avec la pure doctrine Mâlikite, mais fortement enracinée.
Il va sans dire que c'est le plan théorique d'une mosquée complète que nous venons de détailler. Mais il s'en faut que tous ces éléments soient toujours réunis : nous en étudierons, et non des moins riches au point de vue ornemental, qui n'ont pas de çahn, ni de portiques ; d'autres n'ont pas de minaret. Il semble que l'élément indispensable de ces temples soit, avec la salle où l'on fait la prière en commun, la niche indiquant la qibla; nous verrons cependant qu'elle ne peut servir a les caractériser nettement, car on la rencontre dans des édifices de destination toute autre, médersa, qoubba des tom- beaux, etc.
Dépendances extérieures. — Les alentours immédiats de la mosquée tlemcenienne doivent être considérés comme dépendances du sanctuaire lui-même. Fréquemment un acte de habous en consacre le caractère religieux et imprescriptible. II en est ainsi, par exemple, à Sidi Bou-Médine, où l'acte de fondation de la mosquée place au nombre de ses habous le reste du terrain demeuré libre autour d'elle après sa construction. Ce terrain est occupé par un chemin droit qui fait le tour de l'édifice et permet l'accès de ses différentes portes. Des arcades partant du mur de la mosquée vont joindre la masse du roc qui la surplombe. Un chemin du même genre existe autour de Sidi El-Halwi, et un autre existait sur trois faces de la Grande Mosquée. Du côté Est de ce dernier monument, il subsiste aujourd'hui encore une pittoresque allée à arcades dont il sera parlé plus loin (Cf. infrà, Grande Mosquée). Pour d'autres oratoires de moindre importance, il n'a jamais existé autour de chemin de dégagement, mais les constructions voisines, parfois adossées aux murs mêmes de la mosquée, faisaient très souvent partie de ses habous. Elles offraient un logement aux fonctionnaires de l'oratoire, moueddin, imam, etc., ou encore, les revenus en étaient affectés au service du culte. Il en est ainsi, par exemple, à la mosquée de Bel-Hassen et à celle du cheikh Senousi.
Les alentours de la mosquée peuvent encore être occupés par diverses dépendances. Nous reparlerons plus loin des tombeaux vénèrés qui s'élèvent dans le voisinage immédiat de certains oratoires tlemceniens. Pour le moment, nous devons citer en première ligne, parmi les annexes extérieures des mosquées, les latrines publiques [motahherât). Ces édifices comprennent essentiellement une cour centrale carrée, à ciel ouvert ou recouverte d'un dôme. Autour sont disposés des bassins rectangulaires pour l'ablution, des logettes-cabinets d'aisance avec un bassin carré de petites dimensions, une ou plusieurs loges munies d'un bassin de dimensions moyennes pour le ghosl, c'est-à-dire la lotion rituelle générale (naqâir).
De l'eau courante alimente abondamment ces divers bassins. En outre le tout se complète parfois d'une fontaine publique extérieure. Les anciennes latrines de la Grande Mosquée ont disparu : elles occupaient un espace assez considérable, au Nord de l'édifice, sur un emplacement qui fait aujourd'hui partie de la rue de la Paix. Les latrines de Sidi Bou-Médine et de Sidi El-Halwi subsistent encore dans leur étal primitif et seront étudiées plus loin. A Sidi Lahsen, d'après le témoignage oral de vieux habitants du village, un édifice ruiné, situé à l'Est du minaret subsistant, et séparé du reste de la mosquée par l'étroit chemin d'un derb (impasse), contenait des latrines, une fontaine publique placée sous une voûte, et au premier étage une école. C'était à peu près la disposition classique d'un édifice fréquent en Égypte, le Sabîl-Kouttâb (fontaine-école). Remarquons à ce propos que l'institution de la fontaine publique n'a jamais joué, à Tlemcen, le rôle important qu'elle a tenu en Orient; Sans doute un certain nombre d'anciennes fontaines ont pu disparaître depuis la conquête ; mais, au dire de vieux Tlemceniens que nous avons consultés, les fontaines publiques ont toujours été peu nombreuses dans leurville et rarement ornées de pompeuses inscriptions dédicatoires. C'est que nous avons à faire ici à une cité montagnarde, où presque chaque maison possède un puits d'eau vive. Les princes et les gouverneurs tlemceniens n'ont donc pas eu à assurer, par des fondations officielles, l'approvisionnement en eau de leurs sujets et de leurs administrés.
Proportions. — Les proportions adoptées pour les mosquées sont assez constantes et très simples. Si, en suivant l'axe qui va du Jaouf (côté Nord) à la qibla, l'on additionne la largeur de la première nef à la longueur de la cour, on obtient une distance égale à la profondeur de la salle de prière, moins le mihrâb. La cour seule est égale à la salle de prière moins la coupole du fond. Le centre de la mosquée se trouve donc assez exactement placé en avant des premiers piliers de la nef, à l'endroit où un renfoncement, découpé dans le pavage surélevé de cette nef, indique la position du mihrâb aux fidèles placés dans la cour.
Les nefs dont le nombre est fort variable — il va de trois jusqu'à treize, — ne sont pas en largeur inférieures à 2 m, 70, et supérieures à 4 m ,60. Cette persistance des largeurs réduites, pour ainsi dire indépendante des dimensions totales de l'édifice, et qui se constate aussi bien dans les mosquées que dans les monuments civils, provient vraisemblablement des exigences de la charpente, de la rareté des dois de grande taille et de résistance suffisante. Les plus longues pièces ne dépassent pas 5 mètres de long, et les plus grosses 20 centimètres au carré.
Matériaux. — Les matériaux sont :
D'abord le bois, généralement cèdre ou tuya, que l'on trouve, simplement équarri dans les charpentes, sculpté, gravé et formant en des assemblages de très savantes combinaisons dans les solivages apparents, dans les auvents et les portes, ou posé brut, en brins minces, dans les plafonds de maisons privées, ou bien encore noyé dans le corps des maçonneries en longrines, constituant un chaînage qui consolide les murs.
Le pisé (tàbia), ciment fait d'argile, de sable, de chaux et de débris de toutes sortes, battu sur place dans des caisses d'environ 0,80 m de hauteur. Il prend avec le temps la consistance d'une pierre très dure, et ses ruines forment des chicots d'un seul bloc régulièrement criblés de trous. Ces trous ont été laissés par les ais qui réunissaient les parois du moule. Un enduit de plâtre recouvrant les surfaces intérieures et extérieures les dissimulait aux veux ; cet enduit tombé, ils apparaissent, intriguant fort les touristes par leur symétrie.
La terre cuite sous son triple aspect de brique, de tuile et de terre émaillée.
Les briques ont ordinairement 0 ,26 m de long, 0,12 m de large à peine 0,04 m d'épaisseur. Les joints ont environ 0,03 m mais ils s'augmentent suivant les besoins de l'appareillage. Les tuiles creuses sont des portions de cône très allongé; elles sont souvent rouvertes d'un émail vert à base d'oxyde de cuivre.
La terre émaillée joue un rôle important dans la décoration extérieure ; elle forme ce qu'on a assez improprement appelé la mosaïque de faïence, combinaison de morceaux vernissés, de tons différents, découpés suivant un dessin et encastrés les uns dans les autres. Ces morceaux, probablement moulés, cuits, puis couverts et recuits avec l'émail, sont ajustés ensuite à la lime et posés selon le carton sur des plans convenablement dressés ; ils sont enfin assemblés et reliés entre eux d'un bon mortier de sable et de chaux ; ils forment ainsi de grandes plaques de 0,05 environ d'épaisseur, que l'on fixe sur la paroi à décorer par des broches d'os ou de bois scellées dans les joints. La terre est d'un rouge assez sombre; les émaux dont ils sont couverts sont de nombre limité, mais de tonalité franche et d'un admirable effet. Le blanc est d'une belle pâte, demi-mate, légèrement verdâtre, très peu craquelée. Le brun de manganèse est généralement employé très épais, de manière à former un ton presque noir. Le jaune est un jaune de fer assez impur, don- nant une ocre verdâtre et mouchetée où les craquelures sont fréquentes. Le vert de cuivre est de valeur et de ton très variables; dans le même décor on le rencontre, très sombre et très profond, ou très clair et se rapprochant soit du céladon, soit du bleu turquoise. Le bleu de cobalt est assez rare; il ne semble pas avoir été employé à Tlemcen avant la seconde moitié du XIV e siècle ; il est clair et assez pur.
Le plâtre, revêtement habituel des murs arabes, passé au balai ou rayé simplement de traits horizontaux simulant un appareillage ; à l'intérieur, il est appliqué en épaisseur sur une couche de mortier et retenu par des clous carrés à tête large ; parfois moulé et rapporté par morceaux, parfois taillés sur place d'après un dessin préalablement établi, repercé de défoncements allant de quelques millimètres à plus de cinq centimètres de profondeur. Il semble moins fin que celui du revêtement des palais espagnols.
La pierre est assez rare. Elle est représentée par quelques blocs de grand appareil, le plus souvent empruntés aux monuments antiques, quelques chapiteaux de grès, plus fréquemment par des chapiteaux et des fûts de colonnes taillés dans un beau marbre onyx transparent et chaud, que les sultans abd-el-wâdites et mérinides tiraient vraisemblablement des carrières d'Aïn-Taqbalet.
Formes extérieures—Le minaret carré, les toits plats surmontant chaque nef, telles sont les formes extérieures des mosquées tlemceniennes. Nous sommes ici dans une cité montagnarde, les pluies et les neiges n'y sont pas rares, elles doivent pouvoir s'écouler au versant des toits de tuiles; donc, ainsi qu'à Grenade et à Marrakech, peu de dômes de plâtre; les coupoles s'indiquent extérieurement par des pavillons à quatre croupes; les nefs ont aussi des combles en pyramide. Seuls, certains tombeaux sont couverts par des dômes hémisphériques ou à pans coupés, forme consacrée de la qoubba. Notons aussi que des bains et des latrines publiques pré- sentent également des dômes percés par des jours.
L'emploi habituel du pisé, et surtout de la brique et du plâtre, matériaux commodes, à la fois portatifs, légers, et offrant, quand ils sont bien liés, des masses d'une cohésion suffisante, ne devaient pas orienter les Arabes vers les problèmes de la construction. Quelques formules simples, empruntées aux Byzantins et médiocrement appliquées, firent tous les frais de l'anatomie des édifices.
Construction — Nous avons dit plus haut la composition des murs de pisé et de briques. Parfois les assises horizon- tales de ces dernières sont interrompues par des rangs en diagonale, parfois par des lits de moellons. Plus souvent on trouve ces moellons chargeant le sommet seul au départ des voûtes.
Le plus simple des solivages employés est, dans les bâtiments privés, la juxtaposition de rondins de bois reposant sur les deux murs parallèles et recevant directement la chaux et le béton soigneusement pilonné des terrasses.
Dans les édifices publics, les voûtes les plus employées sont la voûte en berceau et la voûte d'arête, formée de la pénétration d'une voûte cylindrique longitudinale par une seule ou par plusieurs voûtes cylindriques perpendiculaires. Parfois des rondins de bois alignés au sommet des murs, parallèlement à l'axe des berceaux, semblent servir de sommier à l'amorcement de ces berceaux.
Nefs, couloirs, escaliers sont généralement couverts suivant ces deux modes classiques.
Nous avons vu qu'il était rare que les toits fussent à deux pentes seulement. Il est, par conséquent, peu fréquent de voir ces berceaux buter contre un mur de pignon. Une portion de voûte cylindrique les termine souvent aux deux extrémités. Un revêtis de plâtre les garnit intérieurement. Ce genre de voûte allongée et surbaissée se rapproche beaucoup de la construction des coupoles ou qoubbas.
Celles-ci sont à pans coupés ou circulaires, appareillées par assises. Exceptionnellement on trouve à la Grande Mosquée de Tlemcen une de ces coupoles primitives formées de cintres entrecroisés, dont la mosquée de Cordoue, et surtout l'église del Cristo de la Luz à Tolède présentent de si curieux exemples.
C'est la demi-voûte d'arête qui forme ordinairement la trompe d'encorbellement sur laquelle reposent les coupoles tlemceniennes.
La légèreté des matériaux qui composent les voûtes en berceau et le faible écartement des murs goutterots, font que ces voûtes n'exercent pas de poussées bien considérables. La couverture de tuile est plus lourde, mais il résulte de la disposition des nefs parallèles qu'elles se contrebutent les unes les autres, et que, loin de s'additionner, leurs poussées se neutralisent. Il n'est besoin de lutter que contre la poussée des charges des nefs extrêmes. Des contreforts, parfois même des arceaux, réunissant la mosquée aux édifices voisins, sont, vraisemblablement dans ce but, dressés contre les murs extérieurs. Il convient de remarquer d'ailleurs que, de même qu'à Sidi Oqba et à Cordoue, ces contreforts ne correspondent pas toujours aux points où la butée des arcs en rendait l'établissement logique.
Des tirants, peut-être même un chaînage de bois noyé dans les murs, achèvent de consolider la construction.
Charpentes. — Comme pour les voûtes, le type des charpentes est emprunté aux monuments antiques. Extrêmement simples, elles offrent, avec les fermes romaines dont les vestiges nous sont parvenus, une très grande analogie. Ces fermes sont, en raison de la faible dimension des pannes, assez rapprochées les unes des autres. Rarement des entraits s'assemblent à la base des arbalétriers, mais des entraits retroussés consolident la charpente et supportent un plan décoratif de caissons formant plafonnage.
Parfois les sommets des chevrons sont simplement réunis entre eux par des chevilles ou des clous, leurs pieds noyés dans la maçonnerie sans sablière ni patins. La volige seule maintient tout le chevronnage dans son plan.
Ce genre de charpente, peu compliqué, devint par la suite de moins en moins savant. Nous montrons ici un comble de qoubba datant de l'occupation turque. Il est assez élevé au-dessus de l'extrados. Les bois sont à peine équarris, les assemblages, mal faits, sont maintenus par des clous. Au sommet se réunissent huit arbalétriers : un pour chaque arêtier, un pour le milieu de chaque croupe.
Quand on les compare aux Occidentaux du moyen âge on peut, sans être taxé de sévérité, juger les Arabes de médiocres constructeurs, empruntant à autrui des formules dont ils ne semblent plus comprendre le véritable but, en créant eux-mêmes d'autres, dont ils ne tirent aucun parti logique pour concourir à la stabilité de leurs édifices.
Les preuves qui peuvent appuyer ce jugement se rencontrent à chaque pas dans l'examen de leur technique.
On sait l'heureux usage que les Gothiques firent de l'arc brisé, comment ils modifièrent l'arc roman en en faisant deux tronçons distribuant logiquement les poussées. Or, cet arc exista de tout temps chez les Arabes ; mais ils ne s'en servirent jamais que comme d'une forme décorative, sans modifier en l'adoptant leurs procédés habituels de construction.
L'encorbellement à stalactites qu'ils empruntèrent aux Persans ne fût pour eux, on Occident du moins, même lorsqu'ils le reproduisaient en pierre, qu'un moyen de décor. Quant aux ouvrages en bois de faibles dimensions, voici ce qu'en dit Viollet-le-Duc : « Les ouvrages de bois des Arabes, des Orientaux ont au moins conservé la formule traditionnelle de la véritable menuiserie, et si les artisans n'en comprennent pas et n'en savent plus appliquer la structure, du moins ils en ont respecté l'apparence». Nous constaterons, à propos des plafonds de Sidi El-Halwi, la justesse de cette appréciation.
Mais si les artistes musulmans ne furent que de piètres constructeurs, il convient de reconnaître qu'ils furent, en revanche, des décorateurs de premier ordre. Sans s'attarder à la recherche des matières rares, sans viser aux tours de force de l'habileté technique, sans laisser leur esprit s'égarer aux inventions d'une symbolique compliquée, ils dépensèrent libéralement leur science d'ornemanistes purs, de calligraphes élégants et souples. Sur des supports maladroitement édifiés, ils appliquèrent, avec des clous et du mortier, un « maquillage » toujours séduisant, étonnant parfois de richesse et de grâce facile.
C'est ce qui, pensons-nous, suffira à expliquer la place importante réservée à l'ornementation dans le texte et l'illustration de la présente étude.
Les arcs. — Nous l'avons vu plus haut, la courbure donnée aux arceaux ne fut jamais pour les Arabes le résultat d'un raisonnement de constructeur, mais plutôt une fantaisie d'ornemaniste. Les différentes formes qu'ils adoptèrent, en Occident du moins, ne s'exclurent pas les unes les autres, elles furent parallèlement employées ou reparurent les unes après les autres, suivant le goût du jour. Nous en donnerons ici une énumération rapide.
L'arc brisé parait avoir été le premier cintrage des monuments égyptiens; on en rencontre à la mosquée d'Anir et dans les plus vieilles mosquées du Caire. L'arc outrepassé, celui auquel on a donné le nom caractéristique d'arc en fer à cheval, ainsi que l'arc en plein cintre ne semble avoir fait son apparition que plus tard. L'arc outrepassé ne fut d'ailleurs jamais beaucoup employé en Orient. Des innombrables cintrages qu'on y rencontre (arc brisé simple reposant sur deux encorbellements, arc brisé rectiligne, are trilobé, arc dentelé, arc sur- baissé, arc en accolade, etc.), l'arc en fer à cheval est, pour ainsi dire, l'un des moins fréquents. Le XIV e siècle nous en a cependant laissé quelques rares exemples à la mosquée Tekich, à la mosquée du cheikh Hakem, le XV e à la mosquée Qâitbey.
En Espagne, dès la période byzantine (VIII, IX e et X e siècle), nous rencontrons l'arc outrepassé; il ne comporte jamais de brisure. On y voit également apparaître l'arcade découpée en grands lobes ou festons (notons que la ligne joignant les centres de ces découpures circulaires donne un arc sensiblement brisé).
La mosquée de Cordoue présente une combinaison extrêmement curieuse d'arcs en festons. Du sommet de ces arcs partent d'autres arcs également découpés, qui s'entrecroisent avec des pleins cintres supérieurs, laissant entre eux de grands espaces ajourés.
La période qui suit XI et XII e siècle emploie, avec l'arc lobé, l'arc outrepassé plein cintre et brisé. La Puerta del Sol de Tolède présente à la fois un premier fer à cheval ogival et un second en plein cintre. Nous trouverons les trois modes de cintrage réunis à la Grande Mosquée de Tlemcen (Cf. PI. V).
Enfin, la période arabe moresque adopte toutes les variétés d'arcades. A l'Alhambra, on trouve surtout l'arc plein cintre surhaussé porté par des encorbellements.
Dans le Maghreb, il semble bien que l'arc outrepassé ait, de tout temps, dominé. L'on y rencontre cependant l'arc non outrepassé; il est réservé pour quelques petits cintrages, fenêtres ou arcatures décoratives. Le xiii c et le xiv c siècle y employèrent le 1er à cheval plein cintre ou brisé presque indifféremment. A peine peut-on établir que, dans le même monument, le plein cintre couvre des écartements plus larges que l'arc ogival; mais cette remarque n'a rien de rigoureux.
L'arc d'ouverture des mihràbs est, de préférence, en plein cintre et tracé à l'aide d'une seule ouverture de compas. Nous déterminerons, en étudiant les plus importants, la disposition des claveaux décoratifs qui les accompagnent.
La plupart des arcs brisés semblent très librement tracés. Quelques-uns pourtant se construisent d'après des formules très simples : nous reproduisons deux d'entre elles. L'un, qui fait partie d'une grande porte mérinide, se sert de deux ares de cercle, et est appareillé par claveaux rayonnant autour d'un centre placé au-dessous des centres de construction. L'autre, qui s'ouvre dans les nefs d'une mosquée, ne fait encore intervenir que deux centres, niais intervertit les ouvertures de compas dans la partie supérieure et inférieure des branches qui la composent (0, centre de l'arc AD et de la rentrée BC; 0, centre de AB el de DE. Les briques sont appareillées par lits horizontaux presque jusqu'à la moitié des arcs, par claveaux rayonnants au dessus. Parfois un triangle de briques horizontales G fait au sommet une véritable clef.
Pour établir ces arcs, il est bien probable qu'on ne fit jamais usage de cintres arrondis; voici, d'ailleurs, le procédé encore employé par les maçons arabes. Une planche horizontale est fichée dans deux joints vers la naissance; des briques sont posées aux extrémités; une seconde planche, posée sur ces briques; et l'on élève ainsi, en les étayant tant bien que mal, des étages successifs qui vont se rétrécissant jusqu'au sommet. La courbe, à peu près dessinée par les briques, est régularisée avec du mortier.
L'angle des brisures est extrêmement variable : l'ogive est parfois très aiguë, et nous rencontrerons, à la mosquée de Sidi Bou-Médine, des arcs brisés qui ne se distinguent du plein cintre que par une déformation supérieure à peine sensible.
Enfin, il n'est pas jusqu'à l'arc lobé et entrecroisé de Cordoue qui ne soit représenté dans les édifices du XIV e siècle. Nous étudierons tout à l'heure les curieuses formules ornementales auxquelles il donna naissance (Cf. infrà, fig. 9).
L’encorbellement à stalactites. — De même que la découpure des arcs, la stalactite, une des formes les plus caractéristiques de l'architecture musulmane, peut n'être considérée que comme un motif ornemental, n'intéressant en rien l'anatomie des édifices.
Ce genre de relief, dont l'élément primitif, la trompe, semble d'origine persane, a pour but de décorer un encorbellement quelconque. Son emploi le plus logique fut de substituer au pendentif sphérique un certain nombre de trompillons ménageant une transition entre le carré inférieur et un plan circulaire.
En Orient, les constructeurs fatimides n'employèrent que les quatre trompes d'angle pour porter la coupole. A l'époque des Ayyoubides et sous les premiers Mamelucks, on superposa deux ou trois étages de petites trompes, faisant successivement passer du carré à l'octogone, de l'octogone au polygone à seize côtés, etc. Le type du pendentif arabe était dès lors fixé.
Cependant cette solution n'était pas encore trouvée lors de la conquête d'Espagne. Il fallut aux constructeurs byzantins, et plus lard aux constructeurs arabes, se livrer de leur coté à des expériences et des recherches, ou suivre pas à pas les artistes orientaux dans leurs acquisitions successives.
La première apparition d'encorbellements à stalactites qu'on ait pu jusqu'ici observer en Occident semble être ceux des palais siciliens de la Zisa et de la Cuba, qui ne remontent guère qu'au XII e siècle. Là, ce procédé, qui devait être, entre les mains des artistes du XIII et du XIV e siècle, si fécond en ressources décoratives, s'exprime déjà très perfectionné. Un simple rapprochement de l'exemple que nous en offre le palais de la Cuba- avec les angles de la coupole placée en avant du mihrâb, à la Grande Mosquée de Tlemcen (fig. 19), permettra, croyons-nous, de reconnaître dans l'encorbellement maghrébin une ébauche maladroite, il est vrai, mais d'autant plus curieuse du pendentif à stalactites.
Cet encorbellement, dont la parenté avec les niches angulaires de Cordoue est évidente, ne remplit encore qu'imparfaitement le but poursuivi. Comme à Cordoue, des portions horizontales sans ornement s'avancent en porte-à-faux au-dessus de la corniche du plan carré ; mais deux petites trompes, flanquant des plans incurvés y remplacent la niche polyédrique de la mosquée espagnole. On saurait difficilement imaginer un encorbellement formé par la superposition d'éléments semblables à cette niche, tandis que les éléments qui s'indiquent dans la mosquée maghrébine pouvaient, en se multipliant, couvrir des coupoles entières.
Les décorateurs tlemceniens n'en firent d'ailleurs pas un si constant usage que les artistes d'Andalousie. Ceux-ci en garnirent des coupoles, des voûtes, des douelles, en composèrent des impostes et des chapiteaux. Le grand porche de Sidi Bou- Médiène, plusieurs niches de mihrâbs, les consoles du balcon de Mansourah, quelques pans coupés d'habitations particulières, telles sont les applications qu'on en trouve à Tlemcen.
Ces pendentifs sont assez habilement tracés, comme on pourra s’en rendre compte par les figures 5, 29, 38. Il est curieux de remarquer que l'élément essentiel en est souvent une réduction de la demi-voûte d'arête, qui, nous l'avons vu, sert à établir la plupart des coupoles tlemceniennes. Cette trompe, répétée et alternant avec des consoles rectangulaires, constitue le groupement le plus généralement adopté. On n'y voit jamais intervenir la stalactite proprement dite : le parallélépipède rattaché seulement par son sommet à la paroi et pendant au centre d'un groupe de coupolettes rayonnantes.
La mouluration. — Une des parties les plus essentielles du décor en relief est la mouluration. Les Arabes n'en firent jamais un très grand usage; elle fut toujours chez eux très limitée et très simple. En Egypte, cependant, on rencontre le tore, le quart de rond, le cavet, le talon, le talon renversé, la doucine et le listel. Dans le Maghreb, l'arsenal des moulures est extrêmement réduit. On peut dire qu'à Tlemcen la seule moulure employée est, avec la plate-bande et le listel, le cavet nu ou décoré d'inscriptions, parfois accosté, dans sa partie avançant, d'un grain d'orge plus ou moins profond.
Les colonnes— C'est dans les colonnes que se révèle surtout cette pauvreté de la mouluration ; elle est, dans les monuments tlemceniens particulièrement sensible. Il semble bien que la plupart d'entre elles n'ait jamais eu de base. Le plus souvent la colonne repose sans intermédiaire sur le sol; parfois un empattement lui sert de support ; mais les exemples qu'on en peut observer sont d'origine douteuse et correspondent mal avec le fût qui les surmonte. De plus ces fûts, toujours cylindriques, ne portent jamais cette succession de gorges et de boudins qui précède l'astragale dans les colonnettes de l'Alhambra, ni ces bagues sculptées que présentent les colonnes aghlabides ou fatimides de Kairouan. L'astragale fait partie du chapiteau et est d'une extrême simplicité.
Le chapiteau tlemcenien— Ses origines. — Dérivé de cette décomposition du chapiteau corinthien qui fut le chapiteau byzantin, le chapiteau moresque ne fut d'abord qu'une copie grossière de celui-ci. Il semble bien en effet que les artistes musulmans se décidèrent seulement à en sculpter eux-mêmes lorsque la
« Carrière » que leur offraient les édifices de leurs prédécesseurs se fut à peu près épuisée. La partie primitive de la mosquée de Cordoue ne comporte guère que des chapiteaux de provenances étrangères d'une incroyable diversité de forme et d'exécution. Les huit nefs orientales, postérieures de plus d'un siècle au premier périmètre, contiennent des chapiteaux de deux types distincts régulièrement alternés, qui semblent bien avoir été exécutés sur place pour l'emploi qu'ils remplissent encore aujourd'hui, mais qui restent comme des contrefaçons assez maladroites de types empruntés aux colonnades voisines.
Tous deux ont adopté ce caractère de bloc épannelé, de « Préparation » de metteur au point en vue d'une exécution plus complète, qui se rencontre déjà dans les sculptures ornementales de basse époque. Dans l'un, trois rangs de feuilles d'acanthe, droites, enveloppent complètement la corbeille primitive; de gros disques d'angle, souvenirs des fines volutes corinthiennes, s'échappent entre les feuilles supérieures. Un tasseau quadrangulaire, s'avançant directement sous le tailloir, marque seul la place du fleuron, qui s'étalait au dessus dans les modèles arecs et romains, el qui, dans le type A {fig. 6), est orné d'une dernière feuille d'acanthe.
Dans l'autre, dont la formule se rattache aux types B 2 et C 3 , deux rangs de feuilles seulement; les volutes forment toujours les angles, mais l'espace compris entre elles est occupé par un lourd quart de rond sans ornements, élargissement byzantin du rebord de la corbeille.
Ce deuxième type, que l'on peut étudier à la Grande Mosquée de Tlemcen {fig. 17), se simplifia encore avant de donner naissance à une formule originale. Le type D 4, qui est une œuvre arabe, ne porte plus qu'un rang de feuilles scindées entre elles, formant couronne au bas de la corbeille. Dans l'exemple E 1, des fentes médianes partant de l'astragale ont transformé l'ancienne couronne d'acanthe en un méandre continu s'incurvant à son sommet.
Dès lors ce grand méandre vertical devient l'élément essentiel du chapiteau moresque. Il peu! , comme h la Cour des lions, se briser et former entrelacs; il reste toujours reconnaissable. Dans les parties hautes de Sainte-Marie-la-Blanche à Tolède, il forme à lui seul tout le chapiteau. Dans les types que nous rencontrerons à Tlemcen, un renflement médian, s'épaississant sous la courbe du sommet comme une nervure principale (Voir type C et/à/. 17), vient préciser clairement son origine.
Un autre ornement des plus persistants dérive de ces bouquets de feuilles, présentées de profil, divisées en deux, accostant, d'une part, l'axe du chapiteau corinthien et se collant, d'autre part, sous les volutes angulaires, dont l'exemple A donne une représentation schématique. Ces bouquets deviennent avec l'interprétation arabe des palmes décoratives qui s'échappent du méandre inférieur. Le type F- 1 nous les montre déjà garnissant de leur longue portion le glacis qui joint le haut et le lias de la corbeille, de leur portion courte formant, par un accouplement, un fleuron médian, motif très courant des décors arabes. Les chapiteaux de l'Alhambra et les chapiteaux tleceniens présentent presque tous de curieuses variations sur ce thème initial.
Une modification importante de proportion et déforme différencie le chapiteau moresque du type primitif. Avec le XIII e siècle, le galbe tronconique delà corbeille, de la « cloche », suivant l'expression anglaise, a complètement disparu. Le chapiteau arabe est maintenant formé de deux parties bien distinctes, superposées: l'une inférieure, cylindrique, l'autre supérieure, portion de cube à peu près deux fuis plus large que liante. Notons que le chapiteau tlemcenien est presque toujours inscrit dans un cube parfait.
La corbeille corinthienne ne se trahit plus que par une survivance du rebord supérieur. C’est un turban, sorte de tore large et aplati qui, assez rare en Espagne, se rencontre fréquemment à Tlemcen, surtout dans les chapiteaux mérinides, et est le plus souvent couvert d'inscriptions. Notons que les sculpteurs maghrébins se sont généralement peu souciés que les tronçons de ces turbans se raccordent entre eux pour former un cercle complet.
Des enroulements s'échappant du turban ou passant au dessus, comme dans le chapiteau ionique; rappellent les volutes angulaires.
Ainsi, lorsque l'art du praticien se fut perfectionné, que les califes n'eurent plus besoin de recourir à la main-d'œuvre chrétienne, au lieu de retourner vers une imitation plus précise des modèles anciens, ou d'en donner, comme le firent les sculpteurs gothiques français, une interprétation naturaliste, les décorateurs arabes, dans un esprit tout différent, conservèrent la formule, mais en lui donnant une signification purement ornementale, sans paraître se souvenir jamais des objets réels qu'ils déformaient inconsciemment.
La décoration bas-relief extérieure et intérieure— La décoration des chapiteaux, parfois très riche, est presque toujours méplate, elle habille la forme sans la défoncer. Il est facile d'y noter l'éloignement persistant des artistes arabes pour tous les modelés profonds, soit que la vigueur de l'éclairage leur ait fait craindre les ombres fortes qui tachent violemment les surfaces et détruisent l'harmonie de l'ensemble, soit plutôt que les prescriptions religieuses qui leur interdisaient la sculpture des corps humains aient orienté leurs goûts et leurs recherches vers d'autres ressources décoratives.
Cette prédominance de ce qu'on a appelé l’esprit de découpage sur l’esprit de modelé se manifeste le plus clairement dans le décor de brique, qui constitue avec ses filets et ses entrelacs la garniture logique des extérieurs, le décor de pierre sculptée, tel qu'on le rencontre à Mansourah, et dans le décor de plâtre.
Issu de traditions byzantines dont les traces sont encore visibles en Egypte et en Syrie, le revêtement de plaire, naqch hadîda, fut rarement employé par les artistes égyptiens ; quelques mosquées (mosquée d'Hassan, mosquée de Kalaoun) en présentent cependant d'intéressants spécimens. Il était réservé à l'école andalouse et magrébine d'en faire la matière d'une décoration prodigieusement riche et ingénieuse. Kairouan, Tunis, où l'art des gypso plastes est encore cultivé à l'heure actuelle, l'Andalousie surtout, où la décoration de stuc a joué un rôle considérable, le Maroc, où l'on connaît des portes à Marrakech et à Mékinez, Fâs dont la mosquée Qarawîyin passe pour un des chefs-d’œuvre de l'art moresque, Tlemcen enfin, comme nous le verrons plus loin, montrent les ressources infinies de cette matière plastique par excellence, qui, fort heureusement, a pu, malgré sa fragilité, traverser des siècles et parvenir jusqu'à nous.
Ce revêtement, parfois très légèrement modelé, présente plusieurs niveaux et fait intervenir des défoncements profonds, qui en soulignent fortement la composition. Cependant il n'accuse presque jamais une saillie sensible sur le nu du mur. Nous en excepterons néanmoins un motif curieux des écoinçons de mihrabs. C'est un bouton de forme variable, sorte de cône arrondi, parfois spirale, et qu'une coquille ornementale remplace au minaret de Mansourah. L'origine évidente s'en retrouve a la mosquée de Cordoue, dans les reliefs du même genre que présentent les portails latéraux.
Le décor à faible relief extérieur et intérieur se complète par le décor méplat polychrome, dont le premier n'est souvent que le support et l'encadrement.
Polychromie. — Céramique. — Nous avons étudié plus haut cette marqueterie en terre émaillée dite mosaïque de faïence, au point de vue de la technique de sa fabrication; il convient d'examiner sommairement les traditions auxquelles on peut la rattacher, et le rôle que lui firent jouer les décorateurs maghrébins.
Il est assez difficile de préciser quelle en est l'origine véritable. Une hypothèse assez bien établie rattache l'emploi architectural de la mosaïque de faïence à l'influence byzantine.
Cet emploi dériverait, non de l'industrie céramique, mais de la mosaïque de pierres et de pâtes colorés. On sait le goût que montrèrent les Romains pour les pavages composés de petits fragments cubiques de marbre ou de toute autre matière suffisament résistante ; des panneaux ainsi formés servirent aussi au revêtement des murs et des plafonds. Le portique de Saint- Laurent, près de Rome, d'autres encore en présentent de curieux spécimens. Ce genre de décor était une sorte de spécialité des artistes byzantins ; les nems à'optis alexandrinum, d'opus graecum, graecanicum, par lesquels on le désignait, est, à cet égard, significatif. Les ouvriers grecs en expédiaient des fragments tout préparés, ou se transportaient eux-mêmes dans les différentes contrées pour l'exécuter sur place. Lorsque les Musulmans envahirent pour la première fois la Palestine, ils trouvèrent l'église de Bethléem ornée de ce qu'ils appellent
Fsifsa. Ce mot, diminutif de fasfasa, est une adaptation du grec (constructions en petits cailloux). L'empereur de Byzance aurait fourni à El-Walid une certaine quantité de fsifsa pour la construction de la mosquée de Damas, et en Occident, l'enduit qui couvre encore le cadre du mihràb à la mosquée de Cordoue aurait été envoyé de Constantinople à Abd-er-Rhamàn III par l'empereur Romain III.
Cette décoration multicolore du mihrâb et de la coupole de Cordoue pourrait bien avoir eu pour succédané naturel un nouveau genre de décor plus simple comme technique, la mosaïque de découpure, et se perpétuer, sans grande modification, dans le procédé des qîrâti, dont nous parlerons tout à l'heure.
Une seconde hypothèse attribuerait l'emploi du décor de faïence à des influences orientales continues. Il semble bien qu'il faille, en Orient, rattacher à de très anciennes traditions l'usage des revêtements céramiques, et plus spécialement des combinaisons qu'engendre la terre émaillée. Nous trouvons la (race d'une technique assez voisine des mosaïques de faïence, en Egypte, à l'époque de Ramsès III, dans le palais de Tell el-Yahoudi. On connaît, d'autre part, les belles façades de briques émaillées que nous a laissées la Perse antique. Pour ce qui est de la Perse musulmane, Ait Renan, empruntant les observations faites sur place par Dieulafoy, retrace ainsi les phases qu'y traversa cette fabrication :
« ... D'abord il n'y eut qu'un dessin de briques sur champ, sans émail; — sous les Seldjoukides, apparaissent des rehauts de bleu turquoise appliqués sur les tranches des briques ; à partir de 1350, la palette s'enrichit, les couleurs se multiplient, ou intercale clans les frises des briques carrées sur lesquelles sont ménagées, en relief, des lettres émaillées afin de simuler, sans grande dépense, le travail exécuté jusqu'alors en mosaïque... Bientôt on néglige la brique crue, on fait abus de briques émaillées et, par économie, on substitue les carreaux à la mosaïque».
Tels furent les divers âges du revêtement céramique dans les mosquées persanes. Il en fut sensiblement de même dans les pays musulmans occidentaux, et on aurait tort de croire avec Ary Renan que « l'Espagne, le Maghreb et le Maroc aient utilisé concurremment, presque simultanément, la mosaïque et le carreau de faïence, la décadence do l'invention arrivant en même temps que l'invention elle-même ». Il est facile, au contraire, d'observer en Occident un développement parallèle, de retrouver les premières combinaisons de la brique non émaillée, incrustant la pierre calcaire creusée à cet effet, aux portails latéraux de la mosquée de Cordoue, ou émergeant du mortier et de la maçonnerie dans l'inscription liminaire de l'église del Cristo de la Luz, d'en suivre le progrès logique avec les grands disques noirs de la Giralda, isolés au milieu de la pierre rose, le plein épanouissement avec les marqueteries multicolores des lambris espagnols et des portails Tlemceniens, enfin la décadence, c'est-à-dire le carreau et les contrefaçons évidentes du décor mosaïque, commençant par la juxtaposition des émaux sur une même plaque et aboutissant au carreau de faïence, tel que nous les pourrons étudier dans les pavements de Sidi Bou-Médine. Une discussion complète de ces origines sortirait du cadre de cette étude ; contentons-nous de remarquer ici que la mosaïque de faïence apparaît d'abord nettement dans le Maghreb comme un mode de décor extérieur, par fragments réduits, étroitement relié au gaufrage de brique dont nous avons parlé plus haut (cf. suprà, p. 74).
Avec le XIII e siècle, l'emploi dut s'en généraliser rapidement. L'industrie céramique prit vers cette époque un développement énorme. L'Andalousie comptait de nombreuses fabriques qui expédiaient leurs produits jusqu'en Orient. Bien des questions encore se posent relativement aux débuts de cette industrie. Les procédés d'émaillage, d'ailleurs fort simples, furent-ils transmis, par une voie inconnue, des artistes de la Perse? Doit-on les attribuer, ainsi que la technique des faïences à reflets, à des ouvriers emmenés en captivité par les galères des chevaliers de Rhodes et qui, de Lindos, auraient propagé leur industrie dans la péninsule ibérique, à Valence, à Malaga, à Manisès? L'Egypte, où le décor de faïence joue à la même époque un certain rôle dans l'ornementation des monuments, eut-elle quelque influence sur le développement de la céramique andalouse? Ce sont autant de points obscurs dans la question générale si intéressante et si mal connue encore des rapports de l'Orient et de l'Occident musulmans au moyen âge. D'autre part, les mêmes ateliers menèrent-ils de front deux genres différents de fabrication? Produisirent-ils parallèlement les plaques polychromes, les vases, les plats à reflets et les fragments unicolores où se découpaient les pièces de mosaïque? Le petit nombre des textes, la perpétuelle confusion qui existe entre la faïence à émail stannifère et à décors peints et la terre couverte dans la masse d'un seul émail opaque ou translucide, ne permettent aucune affirmation à ce sujet.
Nous présenterons ici quelques observations sur les dénominations qu'on attribue à Tlemcen aux différentes variétés de la céramique monumentale. La plaque de faïence à décor polychrome, plus rarement monochrome sans décor, est appelée zelîj. C'est une adaptation de l'espagnol azulejo probablement dérivé lui-même du motazul, bleu. Ce dernier nom indique assez le rôle joué dans le décor primitif parla couleur bleue, si commode à employer et si résistante à la cuisson. Zelîj ne s'applique en principe qu'il la tuile carrée d'assez grandes dimensions 0,20 côté) recouverte d'un enduit de couleur. Toutefois, comme aujourd'hui encore, le mosaïste marocain taille sa mosaïque dans de larges tuiles monochromes, il arrive que le nom de zelîj soit allusivement donné à la mosaïque elle-même. Une première sorte de mosaïque très simple est composée de petites canes de faïence de différentes couleurs (0 m ,025decôté). On en fabrique aujourd'hui encore Tétouan; l'un de nous en a rapporté de cette ville de jolis échantillons. Ce sont en quelque sorte des zelîj monochromes et réduits; on leur donne le nom de qirâti. Disposés côte à cote, ils forment des panneaux où alternent le blanc, le brun, le vert, ou des bandeaux qui cernent les surfaces par des filets d'un seul ton, formés de petits rectangles allongés. Ces véritables damiers de qîrâti peuvent être les premiers spécimens apparus de la mosaïque de faïence magrébine. Mais il faut noter qu'ils ornent seuls le minaret d'un des oratoires tlemceniens relativement les plus récents, la mosquée de Sidi Bràhim. Le décor formé par cette juxtaposition de petits morceaux de céramique se complique ; il donne des croix, des polygones étoiles, des disques et des ovales. Puis, enfin, à la belle époque de l'architecture tlemceniene, il aborde les délicats méandres de l'entrelacs curviligne, les dessins précis de l'entrelacs géométrique. La mosaïque de faïence, traitée alors d'après les procédés d'ajustage décrits précédemment, est distinguée — mais non absolument ; alors encore, on l'appelle qîrâti — sous le nom particulier de qortobi, « la cordouane », ce qui indique clairement qu'on lui attribue une origine andalouse.
D'autre part, il est remarquable que, contrairement à ce qu'on observe en Orient, la couleur bleue, au nom espagnol de laquelle se rattacherait le terme même de zelîj, ne se trouve pas, au Maghreb du moins, dans les plus anciens revêtements de mosaïque. Les vieux minarets d'Agadir et de Tlemcen n'en comportent pas. Les façades mérinides elles-mêmes, qui marquent le plus complet épanouissement de cet art que L'Occident ait peut-être connu, ne se servent de l'émail bleu qu'avec la plus grande parcimonie. Ce n'est que plus tard qu'il joue dans les lambrissâmes et les parements un rôle important, sans toutefois tenir la place du brun de manganèse, du blanc, du vert de cuivre, et du jaune de fer, qui complètent avec lui la palette du céramiste arabe.
Sa résistance, presque inattaquable aux intempéries, faisait de la mosaïque de faïence le revêtement tout désigné des extérieurs. Aussi est-ce sur les portails et sur les minarets, où elle forme des écoinçons, des cadres, des frises, qu'à Tlemcen on la rencontre surtout, soit employée par fragments isolés ou par groupes réduits s'incrustant dans un appareil de brique, dans un enduit, voire même dans la pierre taillée à cet effet, formant des peints brillants dans la surface mate qui les entoure, soit en blets d'un seul ton soulignant les lignes d'architecture, soit enfin en panneaux complets composés d'entrelacs, de dessins géométriques ou d'inscriptions se détachant Le plus souvent sur fond blanc.
L'école arabe d'Occident ne compte pas, croyons-nous, de plus beaux et déplus complets spécimens de ce genre de décor comme garniture extérieure que les monuments tlemceniens, en particulier les œuvres mérinides. La gamme des tons est réduite; mais les émaux sont d'une belle pâte, plus belle, moins creuse, nous a-t-il paru, que celle des monuments espagnols. Le dessin des cartons est parfaitement approprié à la matière. L'ornement n'y est plus seulement géométrique, car l'entrelacs curviligne y remplit des façades entières.
Il y avait là une difficulté d'exécution exigeant des ouvriers habiles et soigneux. La commodité du décor géométrique à répétition résulte en effet du nombre très restreint des calibres donnés à l'ouvrier, qui n'a qu’à tailler mécaniquement les fragments de terre émaillée, sans avoir à suivre une combinaison d'ensemble.
Dans les garnitures intérieures, la mosaïque est plus rare à Tlemcen et semble avoir fait assez tardivement son apparition. Nous noterons cependant quelques exemples de ces lambris à décor géométrique qui sont si fréquents en Andalousie. On verra les fragments de deux d'entre eux au Musée de la ville. Ils proviennent l'un du Méchouar, l'autre de la Médersa Tach- finiya, un troisième se trouve à la Qoubba de Sidi Brâhim. — Rarement aussi on s'en est servi comme pavage. Le palais de Mansourah, le petit palais d'El-Eubbâd, le Méchouar et la Médersa Tach-finiya en présentaient cependant îles spécimens fort intéressants.
Il va sans dire que cette décoration est presque invariablement méplate. On connaît cependant les revêtements de moulures et de stalactites dans les monuments égyptiens, ceux des colonnes engagées de l'Alhambra (salle du Jugement) ; nous en noterons un emploi très heureux comme enveloppes de petits chapiteaux au minaret de Sidi bel-Hassen.
La céramique est également représentée à Tlemcen par des carreaux de pavement à estampages et par des carreaux à décor multicolore sur émail stannifère. Beaucoup d'entre eux sont d'époque récente; quelques-uns semblent d'une fabrication assez archaïque. Nous les étudierons en même temps que les édifices auxquels ils appartiennent (Cf. Qoubba de Sidi Bou-Médiène, Mosquée du Méchour, Qoubba et Mosquée DE Sidi Brahim).
Peinture. — La céramique ne fut pas la seule à compléter par les colorations vives le charme du décor extérieur et intérieur. Des fragments qu'on peut observer sur le minaret de Sîdi Bou-Médiène et au musée de la Ville montrent des traits de couleur brun rouge peints sur un enduit crémeux, couleur maigre d'un aspect analogue à certains décors de poteries antiques et qui semble d'une très grande solidité. Mais c'est surtout à l'intérieur que la polychromie jouait un rôle important : les plafonds de bois, les portes étaient décorés de motifs peints; le revêtement de plâtre était suit rehaussé, soit complètement couvert de tons simples qui ont presqu'entièrement disparu. Le rouge, le bleu, le vert olive, tels furent vraisemblablement les couleurs qui enrichissaient le décor blanc; on les retrouve encore dans les fonds.
Il faut peut-être y ajouter l'or, qui y jouait son rôle ainsi qu'à l'Alhambra; mie tradition encore existante semble y autoriser. Mais, dans ce cas, comme en plusieurs autres, l'archéologue prudent doit se tenir en garde contre l'imagination musulmane et le mirage des temps disparus.
« Tlemcen a perdu sa couleur », dit Ary Renan. Cela est possible. La ville n'a cependant pas eu autant à souffrir que Tunis et Kairouan de la propreté arabe et du passage périodique à la chaux. Il est. d'autre part, vraisemblable que ses salles de prière ne connurent jamais les somptueuses parures des monuments andalous : l'écaillage discret de la croûte calcaire, l'examen des quelques parties laissées intactes ne nous ont pas permis une telle supposition.
Quoi qu'il en soit, on peut dire que les intérieurs maghrébins avec leur pavage, leurs lambris de céramique ou leur garniture de nattes aux colorations chaudes, leurs panneaux de plâtre rehaussés de quelques tonalités franches et claires, enfin leur plafond de cèdre brodé de motifs délicats, devaient constituer des ensembles polychromes puissants et harmonieux, dont les restes que nous contemplons ne nous peuvent donner qu'une faible idée.
Nous étudierons maintenant les éléments décoratifs, les formes linéaires qui entrèrent dans la composition des ornements gravés et méplats. Nous nous efforcerons de déterminer les thèmes primitifs qu'empruntèrent les artistes arabes, et d'indiquer, en nous aidant de quelques croquis, le genre de variations qu'ils exécutèrent sur ces thèmes. Les éléments peuvent être groupés en trois familles : l'écriture, la géométrie ou entrelacs rectiligne et l'entrelacs curviligne.
L'Ecriture. — Dans la difficile étude qu'il reste à faire de l'histoire de l'écriture arabe, il faudra soigneusement distinguer la paléographie des manuscrits de l'épigraphie des monuments et des monnaies. Chacune d'elles a évolué à part. Tandis que les plus anciens documents tracés sur papyrus nous montrent un caractère franchement arrondi ', les plus anciens documents gravés dans le métal ou sur la pierre, nous offrent un caractère rigide, volontiers carré, qui, comme on l'a remarqué, semble indiquer la recherche d'un type monumental d'écriture, distinct du type manuscrit. Cette écriture monumentale et monétaire, d'aspect rigide, à laquelle on a donné le nom impropre d'ailleurs «l'écriture coufique, se fixe en Orient vers l'époque de l'Omeyyade Abd- el-Mâlik (705). Elle règne jusque vers le milieu du IX e' siècle. En Egypte, les inscriptions du miqyâs de Rôda (fit/. 7), en Espagne des inscriptions delà mosquée de Cordoue, du cloître de Tarragone, de la façade del Cristo de la Luz, de Tolède, en Tunisie des inscriptions du rempart de Sousse et du cimetière de Bâb-es-Selin de Kairouan appartiennent à cette période ; mais l'épigraphie tlemcenienne ne fournit aucun spécimen de coufique primitif; peut-être le Maroc en révèlera-t-il un jour. Certaines des inscriptions précitées indiquent déjà, il faut le remarquer, une tendance ornementale qui, très sobre encore, se manifeste cependant par la forme donnée, l'importance arbitrairement attribuée à certaines lettres : arrondissement du Noun final, croisement du Lam-Alif, etc.
Durant les siècles qui suivent, cette tendance s'accentue singulièrement. L'épigraphie, qui dans l'architecture arabe-byzantine était pour ainsi dire isolée du reste de l'ornementation, à mesure que le style arabe se dégage de l'influence grecque, se lie plus volontiers à l'arabesque qui l'entoure, elle tend à devenir arabesque elle-même, elle emprunte au décor floral ses motifs et sa tournure. La tête du Kaf se divise en feuille double, le Ain rappelle parfois le fleuron qui marque le départ des palmes, la fin des groupes de caractères s'allonge et s'arrondit en ligatures et en départs de rinceaux. C'est la nouvelle variété de coufique connue sous le nom assez impropre de qarmatique, et pour lequel on a proposé la dénomination meilleure de caractère angulaire fleuri. Il apparaît pour la première fois en Tunisie en 341 ; puis, transporté peut-être parles Fatimides en Egypte, il remplit toute leur épigraphie. En Tunisie, il prend au reste, au v° siècle de l'hégire (xi e siècle de l'ère chrétienne) une allure d'une extraordinaire fantaisie. Si l'on compare l'inscription funéraire de la Seiyidet el-Jâmi de Kairouan à l'inscription almoravide de Nedromah qui date de la même époque -, où aux inscriptions du mihrâb de la Grande Mosquée de Tlemcen qui lui sont postérieures de plus d'un siècle, on trouve le qarmatique tunisien singulièrement touffu ; et d'ailleurs, dans son efflorescence exubérante, il demeure inférieur aux types maghrébins occidentaux, plus sobres, d'un développement plus classique et plus discipliné.
L'épigraphie tlemcenienne offre des spécimens de qarmatique sur bois, sur pierre, et enfin sur plâtre. Ces derniers sont de beaucoup les plus nombreux. Comme de juste, ils offrent généralement des types plus raffinés, et plus délicatement fleuris que les premiers. La facilité d'emploi de la matière doit en être la cause. A deux exceptions près, que nous signalerons plus loin, ce ne sont pas des inscriptions historiques. Le coufique fleuri tlemcenien n'offre que des inscriptions pour ainsi dire ornementales, versets du Coran, sentences pieuses, etc. La Grande Mosquée qui appartient à la première moitié du XIII e siècle présente trois variétés curieuses d'inscriptions qarmatiques sur plâtre. L'une se découpe sur un fond dépouillé de tout ornement. La seconde dont on trouvera les caractères reproduits ici est sobrement accompagnée de quelques rinceaux. Ses lettres y sont assez déformées ; cependant elles conservent encore les figures primitives; la coupe en biseau qui termine les lettres semble une influence de l'écriture manuscrite, tracée au qalam. La troisième de ces inscriptions qui forme le cadre du mihrâb présente une disposition caractéristique : les deux cinquièmes de la bande qu'elle occupe sont réservés à la partie inférieure, la plus expressive de la lettre, et le fond n'y porte aucun décor ; les autres sont garnis d'entrelacs foisonnants, et les hampes des lettres longues qui y montent indiquent des tendances purement ornementales. Le sommet de ces hampes remplace le plus souvent le biseau primitif par une palme double qui s'inscrit presque dans la même figure géométrique.
Le XIII e siècle nous montre un nouveau processus de l'épigraphie monumentale tlemcenienne. Comme dans les palais andalous, de petits groupes de caractères coufiques, reproduisant des sentences de quelques mots deviennent un élément favori de l'ornementation murale. Avec cet emploi nouveau, le qarmatique joue un rôle important dans les revêtements de plâtre. Ce n'est pas que la longue bande de coufique fleuri disparaisse alors des monuments tlemceniens. On la retrouve à sa place d'honneur, encadrant le cintre des mihrâbs dans les mosquées de cette époque. Bien mieux, l'une des seules inscriptions coufiques tlemceniennes ayant un caractère historique date de la fin du XIII e siècle. Elle s'étale dans deux bandeaux de plâtre, précieusement fouilles, aux deux côtés du mihrâb de la mosquée de Bel-Hassen. Mais il est visible que le but cherché par l'artiste dans les inscriptions coufiques de cet âge est moins d'édifier et d'instruire, que de plaire aux yeux. Le souci ornemental tient alors le premier rang. L'inscription, avec ses déformations conventionnelles elle décor floral qui l'enveloppe de toute part, devient souvent une sorte de logogriphe savant, indéchiffrable pour la grande majorité des fidèles. L'arabesque qui l'avoisine et probablement aussi la décoration calligraphique des manuscrits de l'époque sont les sources des nouvelles formes. Les mosquées de Sidi Bel-Hassen et d'Oulâd El- Imam présentent des exemples admirables de ce coufique fleuri, du même style que celui qui règne à l'Alhambra et à l'Alcazarde Séville. Les caractères les plus fréquents en sont la stylisation lancéolée des anciens biseaux, l'allongement arbitraire des grandes lettres dont les hampes vont rejoindre le bord supérieur, se brisent et forment en se juxtaposant des bordures quasi-régulières suivant le cadre du panneau, enfin L'entrelacs à angle droit ou diagonal analogue à celui de la lettrine byzantine.
Les artistes mérinides ne font qu'exécuter de nouvelles variations sur ce thème. On rencontre assez fréquemment dans leurs monuments une forme de cintre dentelé reposant sur deux Lam ou deux Alif choisis régulièrement dans la phrase. Elle semble une représentation schématique de l'arc en fer à cheval, ou même de la qoubba à toit plat. Sidi'l-Halwi et Mansourah nous fournissent en outre, de cette époque, de beaux spécimens de coufique sur pierre et sur bois, robustes et moins tourmentés que Le type des inscriptions de plâtre.
Il est intéressant de noter que, de même que l'élément floral s'était fortement combiné avec le trait coufique, de même le trait scriptural donna naissance à quelques formes qui prirent place dans l'arabesque. Elles sont dépourvues de toute signification, n'accompagnent plus aucun caractère; mais on ne saurait en chercher l'origine en dehors de l'ornementation épigraphique des monuments ou calligraphique des manuscrits.
Parallèlement au caractère coufique, les décorateurs tlemceniens se servirent du caractère cursif arrondi. En Egypte son adoption comme type habituel des inscriptions monumentales ayant un caractère historique est liée au triomphe des Ayyoubides sur les Fatimides. A partir du VI e siècle de l'Hégire, le coufique fleuri ne retrace plus que des sentences pieuses, des versets coraniques ; il est purement ornemental. En Occident, le caractère arrondi se montre, il la même époque, dans les inscriptions monumentales avec une rare perfection; ainsi la bande dédicatoire qui court sur le tambour de la coupole du mihrâb à la Grande Mosquée de Tlemcen, datée de 530 de l'Hégire, est d'une belle écriture arrondie L'inscription sur bois de la maqçoura de cette même mosquée datée de 533 offre un type curieux, intermédiaire entre le carré et l'arrondi. Mais sur des inscriptions funéraires du début du VII e siècle, le caractère arrondi s'affirme avec des formes très élégantes 3 ; et aux siècles suivants toutes les inscriptions historiques abd-el-wâdites et mérinides appartiennent à ce type : habous de Sidi Bel-Hassen, d'Oulâd-el-Imâm, de Bou-Médine, inscriptions dédicatoires de Mansourah, de Sidi Bou-Médine, de Sidi'l-Halwii, de la bibliothèque d'Abou-Hammou à la Grande Mosquée. — Le seul type en usage fut, sans grande variation de style, ce qu'on a appelé le type andalous ; c'est celui des monuments sévillans et grenadins, celui de la fameuse inscription de l'Alhambra : « Lâghâlib illà llah » Le neskhi oriental ne se montre jamais à Tlemcen; il apparut par contre il Alger à l'époque turque. Quant à la vieille écriture cursive barbaresque, elle ne devint jamais, à proprement parler, une écriture monumentale ; mais elle se rencontre d'assez bonne heure dans l'épigraphie funéraire et y règne définitivement à partir du xv' siècle. — Les inscriptions cursives jouent un rôle très important dans les monuments tlemceniens. De dimensions extrêmement variables, parfois elles forment, autour des champs d'arabesques ou même des larges bandes coufiques, de longues bordures de versets coraniques ; parfois, elles occupent en courtes sentences pieuses des disques ou des polygones au centre des panneaux. Le fond est rarement garni d'un rinceau continu. Plus souvent des fleurons détachés, des vergettes, de petits ornements en forme de V sont chargés de combler les vides.
L'élément géométrique. — Ses origines. — Les questions relatives aux origines de l'élément géométrique sont encore entourées de beaucoup d'obscurité. Les décors persans de l'école parthe, quelques fragments de monuments coptes, quelques sculptures Syriennes, les pavements mosaïques des vieilles églises de Rome et de Salonique, les broderies et les dentelles primitives arabes, telles sont les différentes sources qu'ont tour à tour proposées les archéologues. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'aucun peuple n'ait, avant les Arabes, fait de ce genre de décor la formule initiale de tout un style. Tous les arts se sont plus ou moins servis de l'ornement géométrique: le carré, le quadrillage, le cercle, ont de tout temps revêtu des surfaces ou composé des bordures ; il est possible même que, dans les premiers monuments arabes, il ait joué un rôle accessoire à côté de l'élément floral et de l'élément épigraphique ; mais il appartenait à l'art musulman définitivement constitué d'en faire sa formule préférée et comme sa caractéristique.
« Élégance et complexité par des involutions géométriques plus ou moins distinctes ou mêlées, et construites avec symétrie. Des figures abstraites, la flexion linéaire et une sorte de croissance organique : en d'autres termes, des thèmes purement géométriques que la graphique traduit par des épures, et que la technique met en œuvre en y enfermant la matière, tel est le fonds essentiel de l'art arabe».
Cependant, si les tendances naturellement abstraites de leur esprit, leur amour de la complication mathématique, leur éloignement religieux pour toute représentation de corps animés poussèrent les Arabes à cultiver ce genre d'inspiration, les exigences de la matière employée entrèrent au début pour une part notable dans son adoption. La menuiserie, la charpente à petits bois, l'assemblage des briques et des fragments découpés dans la terre émaillée, le découpage des claires-voies dans les tailles de pierres ou les revêtements de stuc, telles durent être les premiers problèmes dont la résolution sollicita l'emploi du décor géométrique.
L’entrelacs rectiligne. — Ses applications. — C'est dans le réseau des claires-voies qu'il apparaît d'abord, en Occident, à la Grande Mosquée île Cordoue. Au minbar de Sidi Okba (vers 894) qui appartient à la même période, nous le trouvons également garnissant les rectangles ajourés. Dans ces deux monuments, il revêt nettement le caractère d'entrelacs rectiligne, qu'il ne perdit jamais complètement : l'artiste, qui s'est servi d'un large ruban légèrement modelé, voire même strié en manière de cordelettes, le fait passer alternativement en dessus et en dessous des différentes portions de lui-même qu'il croise. Cet enchevêtrement régulier ne fut pas toujours conservé dans le décor de plâtre; on ne considéra souvent le trait que comme un moyen de limiter les surfaces ; mais il subsista toujours dans la mosaïque de faïence, où la bande blanche dessinait, les traits de l'épure.
L'époque de transition n'en fait pas encore un usage très constant. A la Grande Mosquée de Tlemcen, les meneaux, qui maintenaient probablement jadis les fragments de verres colorés, sont encore les seules parties du monument où la combinaison géométrique s'étale bien franchement : partout ailleurs le décor floral joue le principal rôle. Dans les palais de Sicile, une plus grande place lui est réservée. La figure du polygone étoile formé par le croisement de deux carrés (seule figure géométrique qui se rencontre sur les parois de la Grande Mosquée maghrébine) y donne lieu ii des combinaisons fort simples, mais où se manifeste nettement la tendance arabe.
Il était réservé au XIII et au XIV e siècle de donner à ce genre d'ornement un développement extraordinaire. A Tlemcen, les plafonds de bois, les caissons de plâtre, les revêtements de bronze des portes, les claires-voies et surtout les mosaïques de faïence permettent à l'imagination mathématique des décorateurs de se donner libre carrière.
La formule la plus fréquemment employée est, sur plan carré, la rosace rayonnant autour d'une étoile à seize et vingt-quatre pointes. L'étoile à huit, à dix-huit et à nombre de pointes impair ne se rencontre pas. Celle à douze et à vingt pointes apparaît assez tardivement. L'étoile primitive à huit pointes et les combinaisons qu'elle engendre se retrouvent dans presque toutes les frises de plâtre.
Le revêtement de plâtre des trumeaux et des murs se servit (railleurs très peu de l'ornement géométrique proprement dit; le diagramme le plus communément en usage est une juxtaposition de losanges curvilignes ou île motifs se raccordant en sautoir, qui n'est point à proprement parler une combinaison géométrique et dont nous essaierons plus loin de rechercher l'origine.
La mosaïque de faïence eut, en revanche, comme nous l'avons dit, souvent recours au décor géométrique. Il composa depuis la combinaison d'une ou de deux formes jusqu'à la grande rosace de construction savante. Il convient d'ailleurs de noter que le décor ainsi formé conserve son caractère original en restant « infini ». Rien ne limite l'extension des lignes et la « cristallisation » des motifs. Le panneau qu'il compose n'a pas, comme certains panneaux de l'Alhambra, un axe et des arrêts nécessaires. Seuls les besoins de l'architecture et les grandes lignes d'une composition d'ensemble très voulue imposent des bornes au groupement polygonal.
L'entrelacs curviligne. — Nous l'avons vu, le décor géométrique semble dériver de l'entrelacs rectiligne. Parla, il se rattache au genre de décor que l'on désigne parfois plus particulièrement du ternie vague à l’arabesque : nous voulons parler de toute cette famille d'ornements dont l'entrelacs curviligne est le point de départ, niais dans Lequel l'involution linéaire s'enrichit et se complique, le plus souvent, de formes accessoires, épigraphiques < m florales, qui en défigurent complètement l'épure primitive. Parmi ces ornements, nous distinguerons d'après les formes qui les ont engendrées, et pour en faciliter l'étude, deux groupes distincts : l'un que nous appellerons entrelacs architectural, l'autre entrelacs floral.
L'entrelacs architectural. — L'origine du premier groupe est la ligne découpée en lobes ou en festons : soit composée de portions de circonférences semblables, se juxtaposant les unes aux autres, soit de successions de courbes et de raccordements rectilignes, formant des groupes régulièrement répétés. Ces deux genres de lignes trouvent leur première expression dans les formes architecturales. Celui-là, dans l'arcade lobée, telle qu'on la rencontre à Cordoue (fig. 9, A), celui-ci dérive naturellement de l'emploi de la stalactite. La section d'un encorbellement de coupolettes par un plan (//y. 9, El donne ce contour à festons ou à lambrequins que nous venons de décrire. Tous deux eurent une curieuse descendance dans le décor extérieur et intérieur des monuments du Maghreb et d'Andalousie.
Décor extérieur. — L'arc festonné, nous l'avons montré plus haut, fut abandonné d'assez bonne heure, dans le Maghreb du moins. Le XIII e siècle ne l'employa plus comme cintrage, mais il continua à tenir une place fort honorable dans les faibles reliefs du décor de brique. C'est lui que nous retrouvons comme première bordure de bon nombre d'arcades mérinides. Il se répète, s'enrichit d'un double ou triple entrelacs et sert de cloison aux fragments déterre vernissée (C) '. Déplus, il est, avec la découpure à lambrequins, le point de départ des décors les plus caractéristiques des extérieurs arabes : l'arcature et le réseau. En effet, si les architectes byzantins, qui élevèrent les charpentes de Cordoue sur deux étages d'arceaux entrecroisés, n'eurent pas, à proprement parler, d'imitateurs, c'est vraisemblablement à eux que les décorateurs arabes doivent le décor ingénieux et logique dont ils revêtirent tous les minarets d'Occident. Cet entrecroisement reparaît dans les galeries d'arcades aveugles (B) dont la Puerta del Sol de Tolède, la Giralda et la Kutubiyya de Marrakech offrent les plus anciens exemples. L'élément ordinaire en est l'arc lobé. Il reparait aussi, agrandi et- multiplié, dans le réseau des grandes surfaces rectangulaires. L'élément en est alors la ligne festonnée ou à lambrequins. Partant d'un arc inférieur, qui en rappelle clairement l'origine, ils donnent naissance à une superposition de losanges mi-curvilignes mi-rectilignes (F). Les minarets mérinides ont donné de cette formule de très ingénieuses applications. Comme on le voit, ces losanges offrent l'avantage d'être juxtaposables, la moitié de la figure présentant en creux le contour que l'autre moitié présente eu plein.
Le plus souvent l'intérieur en est meublé par la retombée des arcs supérieurs et par un fleuron terminal des arcs inférieurs. Constamment employé dans les minarets, ce réseau ne se rencontre guère dans les autres revêtements extérieurs. Nous en trouverons cependant un exemple à la Médersa de Sidi Bou- Médiène et une interprétation en mosaïque de faïence au portail de la mosquée (fig. 46).
Décor intérieur. — Ces deux thèmes, transportés dans la décoration intérieure, se traduisirent dans le plâtre par des ornements d'échelle plus réduite et d'un caractère plus compliqué. L'arc lobé constitua, comme aux portails de brique, la première garniture des grands arceaux des nefs, voire même de la circonférence inférieure des coupoles. Parfois repoussé tout au bord des cintres, il les découpa en petites dents régulières qui donnèrent naissance au gaufrage des douelles (D) ou au cotelage des coupoles (D). L'Alhambra et le petit palais d'El-Eubbâd présentent des spécimens de ce découpage. Quant à la succession de lambrequins et au réseau qu'il engendrait dans le décor extérieur, nous croyons en retrouver un souvenir dans le décor régulier à losanges curvilignes, qui constitue un des remplissages les plus constamment usités dans les revêtements de plâtre.
Il semble bien, en effet, qu'il apparaisse peu déformé dans les panneaux ajourés qui garnissent les tympans de l'Alhambra et de l'Alcazar. On en pourra voir ici (G) une interprétation très simple remarquée dans la salle du Jugement. C'est un trait gravé sans décor accessoire, qui reproduit visiblement le trait initial des grands réseaux. A Tlemcen, nous en trouverons de nombreuses applications. Quoique très enrichi et affectant les formes les plus diverses, il est cependant assez reconnaissable; il alterne dans les écoinçons avec l'entrelacs floral; il revêt les grandes surfaces des murs.
Dans ce nouvel emploi, il se mélange intimement avec la flore. Nous avons noté, en parlant des réseaux de brique, les fleurons couronnant la soudure des lambrequins. Les vieux minarets qui subsistent à Séville, la Giralda, le clocher de San Marcos, s'ornent de ramifications végétales découpées dans la terre cuite. Cette assimilation des deux familles de décor, déjà visible dans le revêtement extérieur, devint plus complète dans les compositions de plâtre. Non seulement, en effet, les fleurons et les palmes y meublent les losanges superposés, mais ces losanges deviennent eux-mêmes ornements floraux, leurs courbes ne sont plus que le diagramme de construction que les longues feuilles détachées de leur tige viennent revêtir (H). Nous verrons tout à l'heure comment cet entrelacs architectural, converti en palme, se déforme en même temps que la palme elle-même au contact de l'écriture.
Entrelacs floral. — Nous étudierons maintenant le deuxième groupe : l'ornement floral proprement dit.
Dans tout décor floral arabe, il convient d'examiner deux parties distinctes de la composition : d'une part, l'épure de construction et, de l'autre, le motif qu'elle supporte, l'entrelacs curviligne et l'élément végétal, la tige et la feuille.
On le sait, la décoration musulmane est l'art le moins naturaliste qui soit. Les prescriptions religieuses, qui interdisaient la représentation humaine, laissaient aux artistes arabes libres carrières relativement à l'imitation des plantes. Or ils ne s'avisèrent jamais de copier aucune des formes végétales qui les entouraient ; leur seul but fut de garnir les surfaces de combinaisons savantes, prétextant la répétition des formes peu variées de la flore ornementale.
La disposition byzantine que présentent les claveaux en mosaïque du mihrâb de Cordoue, une tige médiane portant des rameaux opposés, convenait mal à cet emploi ; les exemples d'un tel point de départ rigide suivant l'axe sont fort rares dans les mosquées Tlemceniennes. En revanche, le rinceau, également en usage dans les décors byzantins, eut, en s'implantant dans l'art arabe, des applications très nombreuses et très diverses, soit que, d'un seul jet, il formât la nappe des écoinçons, soit qu'en plusieurs tronçons s'enchevêtrant les uns aux autres il meublât des surfaces régulières.
On trouvera un certain nombre de diagrammes joints à ceci (fig. 10). Tous sont empruntés à l'analyse d'ornements reproduits dans la suite de cette étude. Ce sont la spire simple (A), la spire à deux enroulements contraires (B et C), le rinceau (D) et les combinaisons auxquelles il donne lieu : l'entrelacs formé par deux rinceaux courant suivant une même direction (E) par deux rinceaux courant dans deux directions opposées (F), la direction étant donnée par la disposition des brandies secondaires et leur inclinaison sur la tige principale. Notons que, lorsque cette tige se montre dans tout son développement, elle porte un bouquet terminal à ses deux extrémités, ce qui achève de lui enlever tout caractère naturaliste. Il faut donc les considérer comme de libres fantaisies ornementales, tenant autant de la géométrie que de la flore. Comme telles, elles sont d'une composition sinon claire, du moins ingénieuse et logique. Les points d'attache ne sont généralement pas dissimulés ; les rapprochements sont souvent marqués par des ligatures décoratives qui suppriment les parallélismes désagréables ; les croisements de tiges sont aussi très clairement exprimés ; dans certains ornements, ils s'encadrent dans l'enroulement des palmes ou dans les fleurons d'axe [fig. 33, 48, 72).
Restait à adapter sur ce support flexible le motif végétal proprement dit. Ce fut encore l'art byzantin qui fournit ce second élément. Une seule plante, croyons-nous, constitua presque exclusivement la flore des décors arabes, et par ses curieuses déformations engendra la garniture des entrelacs curvilignes : ce fut la feuille ornementale par excellence de toute l'antiquité classique, L'acanthe, plus spécialement l'acanthe épineuse, employée de tout temps par les Grecs et qui fut, ii partir du v' siècle, d'un usage constant dans les édifices romains.
On ne doit point s'étonner de voir une telle palme s'adapter ii une tige si peu faite pour elle et dont la tournure mince et souple rappelait si mal le port naturel de la plante à laquelle elle appartenait. Les décors byzantins présentent déjà des exemples d'acanthe ou de tronçons d'acanthe portés par des tiges flexibles formant rinceau (fig. H). On le sait d'ailleurs, les sculptures des chapiteaux de la décadence en font une feuille extrêmement longue et amaigrie [fig. 12 A). Le limbe y est presque réduit à la seule épaisseur des nervures. Les groupes de digitations ainsi obtenus sont, dans les sculptures de Cordoue, séparés entre eux par des intailles plus larges et arrondies, qui représentent l'œillet intermédiaire de la feuille primitive (B). Ces intailles ne furent plus bientôt que des trous, alternant avec des stries profondes. A la Grande Mosquée de Tlemcen, c'est cet aspect qu'elles revêtent ; la feuille a de plus complètement modifié sa silhouette générale. En effet, si l'on y trouve un exemple d'acanthe peu déformée (fig. 19) et présentée de face, la palme la plus généralement employée est présentée de profil, divisée en deux parties d'inégale grandeur (C) ou formant un seul faisceau et s'échappant alors d'un bourgeon inférieur semblable à deux cotylédons ajourés (C). Cependant c'est toujours la même feuille avec ses stries régulières et ses représentations schématiques d'œillets. A Sainte -Marie- la-Blanche de Tolède, elle remplit son rôle classique en formant les crosses des chapiteaux octogones (D), dont la parenté avec les chapiteaux théodosiens n'est point douteuse.
Cette feuille eut le sort de presque tous les emprunts faits aux décors byzantins (Cf. suprà, Chapiteaux); elle alla, s'écartant toujours de plus en plus de la nature, se faisant de plus en plus conventionnelle et ornementale. A l’Alhambra, on remarque des feuilles où nervure principale, nervures secondaires, œillets intermédiaires se retrouvent, mais complètement défigurés par une libre interprétation décorative (E).A Tlemcen, au xiv° siècle, les œillets disparaissent, il n'y a plus que des nervures (F), et la palme, ainsi simplifiée, réduite, et généralement isolée de sa tige, sert de remplissage. Elle forme alors avec ses traits gravés sur un fond souvent repercé une valeur forte au milieu des méplats qui l'avoisinent.
Cependant cette acanthe, si conventionnelle qu'elle puisse paraître, devait se déformer encore. On s'habitua à ne plus considérer dans la palme que la figure géométrique dans laquelle elle s'inscrivait. De très bonne heure, parallèlement à la feuille sillonnée d'intailles, les décorateurs arabes employèrent une feuille lisse qui n'était qu'une simplification de la première. Les deux variétés de feuilles gravées que nous signalions à la Grande Mosquée fournissent deux types différents facilement reconnaissables. La palme divisée en deux parties engendre une palme plate, un peu plus longue et plus souple, mais de même galbe et remplissant le même rôle (G). La palme présentant un seul faisceau de nervures donne naissance à une sorte de triangle isocèle, s'adaptant à la tige par le milieu de son petit coté (G). Le bourgeon inférieur primitif s'y révèle encore par une petite intaille angulaire et un trou simulant l'œillet.
Ces deux feuilles s'enroulent librement suivant les besoins du décorateur; mais il est bien rare que la courbe n'enveloppe pas logiquement le bord interne de la feuille, c'est-à-dire, le côté qui, dans le prototype byzantin, était suivi par la nervure médiane.
Parfois ces palmes étaient garnies de décors fantaisistes qui en changeaient complètement l'aspect. Sainte-Marie-la-Blanche en montre déjà des exemples ; nous en signalerons de fort jolies interprétations, à la mosquée de Sidi Bel-Hassen (fit/. 32 D, F). Certaines même, dans ce dernier édifice, pré- sentent des recoupements qui en modifient d'une manière assez sensible la forme initiale [même fig. E).
Avec la période mérinide, ces curieuses variétés sont presque complètement abandonnées. La feuille longue et plate subsiste seule et constitue l'élément floral essentiel ; la feuille large, courte et gravée étant, comme nous l'avons vu, réservée pour les remplissages. C'est elle dont le galbe flexible décore les panneaux entiers ; elle termine la tige grêle des rinceaux ; elle forme les motifs d'axe. En effet il n'y a pas, à proprement parler de fleuron dans toute la flore maghrébine. Le fleuron n'est que le rapprochement de deux palmes doubles affrontées (H). Les deux pétioles étant parfois réunis par une ligature, il en résulte une forme assez analogue à la fleur-de-lys. Isolée de son support, elle circonscrit les losanges curvilignes des grandes surfaces. Quatre ou huit palmes doubles sont nécessaires à cet emploi. La pointe de la longue portion s'appuyant sous la courte portion de palme d'au-dessus, leur réunion engendre les festons successifs dont nous avons essayé de déterminer l'origine (fig. 9, H).
Cependant, avec le milieu du xiv e siècle, cet élément essentiel des décors arabes s'abâtardit et se défigure encore. Le limbe s'amincit et devient de plus en plus semblable au trait scriptural qui l'environne. Toute l'ornementation d'ailleurs subit cette dégénérescence. On peut dire qu'elle est surtout caractérisée par l'appauvrissement des surfaces en relief, d'où résulte le développement plus considérable des fonds; l'amincissement des pleins déterminant V élargissement des rides. Nous en constaterons de très manifestes exemples à la mosquée de Sidi Bou-Médine et plus encore à la qoubba de Sidi Brâhîm.
Cette dégénérescence fut très rapide : cinquante ans à peine séparent ce dernier édifice de la mosquée de Sidi Bel-Hassen, qui marque peut-être l'efflorescence complète du style arabe occidental. Ce fut encore assez pour laisser d'excellentes œuvres, témoignant d'une imagination pleine île ressources, donnant l'illusion de la richesse et de l'originalité, à l'aide de quelques formules très simples empruntées à un art étranger.
Nous avons essayé de le montrer : en fait, tous les éléments mis en œuvre et transformés par les artistes maghrébins se trouvent en germe, sinon clairement exprimés, à Cordoue, dans la grande mosquée d'Occident. D'autre part, cette analyse, nous le sentons, est incomplète et trop systématique. Toute recherche relative à la civilisation du Maghreb doit tenir compte des échanges et des rapports constants qui l'unissaient avec l'Orient. L'étude des monuments d'Egypte pourrait donner lieu ii quelques rapprochements intéressants. Nous ne la croyons cependant pas indispensable. L'art d'Andalousie et celui du Maghreb semblent avoir constitué un groupe à part et s'être simultanément développés.
S'il nous a semblé évident que la comparaison des monuments de Cordoue, Tolède, Séville et Grenade devait à chaque instant éclairer une étude des monuments tlemceniens, il ne nous parait pas moins certain que la connaissance de ces derniers peut, en plus d'un point, servir à mieux comprendre les édifices d'Andalousie. La plupart, en effet, offrent l'avantage d'être datés d'une manière certaine et d'avoir été peu remaniés. Alors qu'il est très difficile de démêler dans les palais espagnols l'apport des générations successives, chacune des mosquées maghrébines représente pour ainsi dire une étape de l'art moresque, une date de son perfectionnement ou de sa dégénérescence. Elles deviennent donc des documents archéologiques de premier ordre, utilisables non seulement pour l'étude des édifices andalous, mais encore de ceux de Sicile et de ceux que les explorations futures nous révéleront dans les villes marocaines.
Ce ne sont point que des documents archéologiques. Tous ceux pour qui les choses d'art ne sont pas indifférentes et vaines seront séduits par la grâce attique de leurs proportions et l'élégance un peu mièvre de leur parure ornementale. On l'a dit avant nous et mieux que nous, la Grande Mosquée, Bel- Hassen, Mansourah, Sidi Bou-Médine ne sont pas des frères indignes de l'Alhambra et de l'Alcazar. Mais nous croyons devoir insister sur le charme et l'intérêt que les monuments maghrébins empruntent à se trouver ainsi présentés dans leur vrai cadre, au milieu d'une civilisation toute semblable à celle qui les vit éclore. Les palais de Seville et de Grenade, que des restaurations tant soit peu indiscrètes ont rendus souvent plus riches qu'harmonieux, apparaissent comme de somptueuses curiosités, banalisées par le tourisme, incomprises du monde qui a continué de vivre autour d'elles. Les mosquées de Tlemcen ont presque toutes pour cadre les petites rues arabes toutes grouillantes de leur foule blanche.
Ce cadre, nous le savons, va disparaissant chaque jour ; le souci artistique du Gouvernement ne peut protéger des quartiers entiers qui valent surtout par leur ensemble, et dont la conservation ne s'impose pas. D'autre part, une tendance fâcheuse pousse les habitants français à débarrasser leur ville des seules choses qui y attirent encore des visiteurs et à faire de la cité royale des Beni-Zeiyân la rivale d'une sous-préfecture quelconque de la mère-patrie. C'est là, croyons-nous, un mauvais calcul, en même temps qu'une œuvre indigne delà civilisation que nous représentons. Mais il semble bien qu'il faille prendre son parti des vandalismes inutiles; Tlemcen arabe, comme le vieil Alger, s'amoindrira de plus en plus et succombera sous la pioche et le cordeau des vainqueurs.
Elle restera cependant, longtemps encore, un pays d'élection pour les pèlerins d'art. A la ville musulmane dépecée survivront, nous l'espérons du moins, d'autres merveilles qui ne sauraient être cataloguées dans cette étude ; nous voulons parler de ces productions naturelles de la terre et du ciel maghrébins, de ces aspects nobles et charmants qui nous ont nous-mêmes séduits, et qu'il nous semble préférable de laisser aux autres le plaisir de découvrir à leur tour.
Posté Le : 10/08/2011
Posté par : tlemcen2011
Ecrit par : Wiliam et Georges Marçais