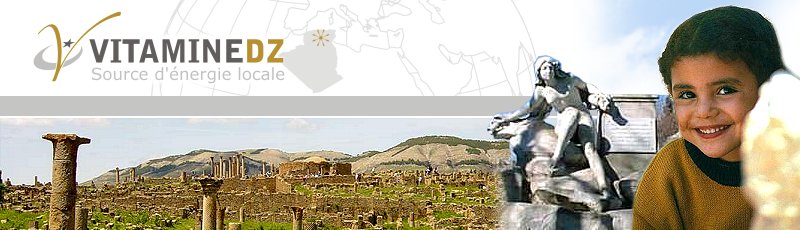
Gisèle Halimi : l’avocate de tous les défis (2e partie et fin)
Article publié par le quotidien Le Soir d'Algérie le 26.08.2020
Par Amar Belkhodja(*)
«Ce qui est scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue.»
(Simone de Beauvoir – Djamila Boupacha – p. 220 – Gallimard – 1962)
Retour dans le temps et dans l’espace. Skikda, février 1958. Procès du 20 Août 1955. Maîtres Gisèle Halimi et Léo Matarasso sont jetés dehors de l’hôtel, à 5h du matin, par le dernier hôtelier de la ville. Les troubles étaient imminents. Les colons de Skikda prêts à mettre le feu à l’hôtel si les deux défenseurs ne «vident» pas les lieux. Gisèle Halimi et son confrère, comme de vulgaires malfaiteurs, se plantent avec leurs bagages devant la salle d’audience. L’avocate n’est pas une dame à courber l’échine, à baisser les bras, à hisser le drapeau blanc, à fuir le danger. Elle lance le défi et met les instances judiciaires et gouvernementales carrément devant le fait accompli en déclarant avec grand fracas qu’elle «plaiderait même s’il lui faudrait camper en salle d’audience du tribunal».
La presse française et étrangère prend acte de ce cri de révolte et d’indignation et s’adonne à mille et une spéculations et libre cours à l’imagination, unique dans les annales judiciaires : «placer des lits de camp ou dresser des tentes en salle d’audience» destinés à héberger des avocats (sans domicile fixe) indésirables dans les hôtels de la ville de Skikda. Il faut croire aussi que placer la justice face à une telle impasse, Gisèle Halimi espérait faire déplacer le lieu du procès. L’appareil judiciaire, implicitement, ne cède pas et maintient les dates et lieu du procès. Pour compenser l’idée des «tentes et des lits de camp en salle d’audience» et pouvoir assurer le sommeil des deux défenseurs, image qui amusait les esprits taquins des journalistes, à l’affût du sensationnel et de l’inédit, les autorités vont recourir à une sorte de réquisition qui ne dit pas son nom. Non pas celle qui aurait dû s’appliquer – par la coercition – aux trois hôtels de la ville accompagnée d’une mise en place d’un service de sécurité et de protection de deux «auxiliaires de justice», selon les bonnes convenances, l’usage et la tradition.
Malheureusement, il s’agit d’une «réquisition» d’un autre ordre, d’une autre nature qui ne hasarde pas à fâcher les partisans de la haine et de la violence. Une «réquisition» qui se déguise par un esprit de confraternité puisque ce sont deux avocats locaux qui vont souscrire à l’hébergement de Me Gisèle Halimi et Me Léo Matarasso. En d’autres termes, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une capitulation devant les menaces et les intimidations que brandissent les chefs de la conscience locale européenne qui hurlent à la vengeance alors que 12 000 Algériens avaient déjà péri sous les balles de l’armée française et de la milice au lendemain même des offensives de l’ALN qui avait encadré les groupes de paysans volontaires. La vengeance était, par voie de conséquence assumée, largement, complètement assumée. Entièrement et impitoyablement accomplie. Car, «l’Algérien est un fellaga qui s’ignore. Il l’a été, il l’est ou le sera. À exterminer donc», avait soutenu Gisèle Halimi pour décrire une atmosphère qui persistera durant toute la guerre. Le peuple algérien étant devenu, dans son ensemble, un peuple de suspects qui doivent obligatoirement passer aux aveux.
Convaincue de la «culpabilité collective», Me Gisèle Halimi nous dira à propos des inculpés du 20 Août 1955 : «Au moment où ils interrogent les suspects, les policiers ne disposent pas encore des témoignages qui contrediront, plus tard, l’autopsie. Alors ils foncent. Ces Algériens doivent être coupables. Comme ils n’en ont pas d’autres sous la main, ils entreprennent de leur arracher des aveux. Par tous les moyens. Supplice de la baignoire, du courant électrique sur tout le corps, des brûlures de cigarettes sur les testicules. On ne lésine pas sur les moyens. Le secret règne, l’impunité semble assurée.» (Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – p.149 – Gallimard – 1988).
L’un des accusés du 20 Août 1955 raconte les moments innommables vécus en salle de torture : «Ils nous ont esquintés, comment résister ? Même le fer tu le tords avec le feu… Alors tu imagines, un homme… Nous avons dit oui à ce qu’ils avaient tapé à la machine… Nous n’en pouvions plus…» (Le lait de l’oranger – p.151).
Dans le procès du 20 Août 1955, Gisèle Halimi et Léo Matarasso sont, par voie de conséquence, contraints à «dormir dans la clandestinité» chez des confrères qui craignent eux aussi de faire l’objet d’intimidations, voire même de représailles. D’autres persécutions et déboires attendent les deux avocats auxquels on vient d’interdire le «droit au sommeil».
On estime donc que le côté hébergement est chose réglée dans le silence et la soumission des autorités administratives et judiciaires qui abdiquaient à la volonté et aux menaces de groupes racistes qui exigent que d’autres têtes d’Algériens tombent pour combler le désir morbide de persister dans l’extermination d’une race, un sentiment jamais assouvi.
Nouveau chapitre auquel nos deux avocats vont s’opposer : la restauration et la nourriture. Tracas qu’ils vont subir avec tout ce que cela comporte comme bassesse et perfidie parce qu’il vise à soumettre la personne humaine à l’humiliation. Les mots d’ordre visant à punir les deux défenseurs ont fait le tour de la ville de Skikda. C’est au tour des restaurateurs de fermer les portes de leurs établissements aux deux avocats que la population «pied-noire» de Skikda assimile à des «traîtres», des «complices» des «émeutiers tueurs» de la journée du 20 Août 1955.
C’est le règne de la terreur. Tous les restaurants de la ville refusent de servir des repas aux deux hôtes de la cité. Nous surpassons le seuil de l’outrage et de l’indécence infligés aux avocats venus plaider dans une fonction dont les trois sont reconnus dans toutes les contrées de la planète. Pas d’hébergement, pas de nourriture.
Il n’y a pas d’aussi vil et lourd fardeau que ces circonstances de rejet et d’exclusion absolue, que ce lot de contraintes, de chantages, d’intimidations, ces menaces hors de l’enceinte d’un tribunal, alors les «affrontements juridiques» sur la procédure, sa forme, son fond, les preuves, les aveux qu’on arrache par la torture, n’ont pas encore lieu.
Si le problème de l’hébergement est surmonté au prix de «réquisitions» amicales, de solidarité professionnelle, favorisées par pudeur et bonnes convenances, celui de la nourriture est laissé aux bons soins des concernés eux-mêmes. Personne ne cherche à s’en inquiéter. Gisèle et son confrère «paient» l’audace d’avoir accepté de défendre des «criminels». Tout le monde se frotte les mains. Les tenants de la justice coloniale, la population européenne de Skikda, les hôteliers qui se sont débarrassés à bon compte de clients indésirables qui leur auront attiré de pires ennuis d’une faune qui entretient, d’ores et déjà, les germes d’extermination qu’on retrouvera plus tard chez l’OAS (Organisation de l’armée secrète).
Enfin, les patrons de restaurants, volontairement ou sous la menace (qui sait) interdisent leur cuisine aux deux avocats pestiférés, mal-aimés, indésirables. Côté nourriture, Gisèle Halimi n’est pas d’avis de perdre pied. Elle va mettre sous la dent (c’est le cas de le dire) ce qu’elle trouve nécessairement sous la main : du pain – évidemment —, des olives, des orangs et des… cacahuètes.
Elle raconte dans un récit tragicomique les compensations des repas chauds par des rations de cacahuètes : «Ah ! les cacahuètes… Je me souviens en avoir ingurgité des kilos, pendant les suspensions d’audience, à midi, en guise de déjeuner, le soir dans ma chambre après le couvre-feu. Le vendeur de cacahuètes opère à toute heure du jour, tard dans la nuit, et à tous les coins de rue, d’où une appréciable facilité de ravitaillement» (Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – p.139 – Gallimard – 1988).
Puis il lui vient en mémoire que l’un des amis de son père possède dans la corniche de Skikda un bistrot à poissons. Son père, contacté par téléphone, l’orienta aussitôt et lui indique le lieu.
Le propriétaire des lieux se dispense d’accueillir les deux avocats avec chaleur et éclat. La peur rôdait partout. Il prit précaution de les isoler dans un endroit séparé de la salle publique, en évitant avec vigilance de tous les instants des «télescopages» compromettants. Décidément, les deux confrères commencent à être rompus aux rigueurs et aux exigences de la clandestinité.
Main basse sur Skikda. Sus aux avocats des Arabes. «Ils ne dorment pas chez nous. Ils ne mangent pas chez nous.» Un leit- motiv qui fait le tour de la ville. Il reste, cependant, encore un douloureux chapitre auquel les deux défenseurs vont devoir faire face avec beaucoup de force et de dignité : c’est malheureusement celui des insultes, des injures, des offenses les plus ignominieuses et les plus abjectes.
Le jour du verdict, les pieds-noirs emplissent la salle d’audience. Ils sécrètent le ressentiment envers les deux avocats comme la vipère sécrète son venin. Gisèle Halimi entend leurs commentaires : «Ils vont payer les salauds», «ces monstres à la casserole», quand nous passons devant eux. Un homme épais et rougeaud se lève et me crache à la figure. La femme assise près de lui ponctue : «Et s’en sortent, on aura votre peau.» (Le lait de l’oranger – p.159).
Les tourments, déboires et maltraitance morale que subit Gisèle Halimi pendant son séjour infernal à Skikda sont, en réalité, un avant-goût de ce qu’elle va endurer pendant toute la guerre d’Algérie, lorsqu’elle est en charge des procès du FLN.
Le procès du maquisard d’Aumale
À nouveau et à la même époque (1958) Gisèle Halimi défend un maquisard dont le procès a lieu à Aumale (Sour-el-Ghouzlane). Une aventure fort périlleuse est vécue à cause d’un trajet à hauts risques (les gorges de Palestro). Le train Alger-Bouira contourne les zones déclarées interdites par l’armée française. Cependant, de Bouira à Aumale point de transport. Les déplacements sont réglementés et organisés par convois sous escortes militaires, à des horaires précis. On refuse à l’avocate de se joindre au convoi qui transporte les juges composant le tribunal, sous prétexte qu’elle n’est pas commise d’office. Le président du tribunal la laisse plantée sur les lieux et ironise qu’elle n’a aucun espoir d’obtenir quelque facilité ou autorisation officielle pour le déplacement. Voici donc un échantillon qui annonce la couleur, qui affranchit d’ores et déjà l’avocate sur les prédispositions d’un tribunal dans la confection d’un verdict par anticipation et dans la conduite des débats
Longues à raconter ces péripéties où le suspense rivalise avec le risque : déplacement nocturne et dangereux, panne de véhicule, prise en charge par les Algériens de passage pour terminer le trajet Aïn-Bessem-Aumale ; si bien que le président du tribunal est – désagréablement – surpris quand il constate que l’avocate est bel et bien à l’heure, malgré tous les risques et les dangers qu’un relief géographique est propice à mettre en scène à tous moments.
L’épisode transport n’est pas encore clos puisque l’avocate est obligée de solliciter les services de l’armée qui accepte de l’escorter jusqu’à Aïn-Bessem parce qu’à Aumale, comme à Skikda, plus aucune chance d’être hébergée dans un hôtel. D’ailleurs, les magistrats du tribunal militaire l’avaient devancé en «raflant» toutes les chambres de l’unique hôtel de Sour-el-Ghouzlane (Aumale).
Un dilemme qui va mettre Gisèle Halimi dans une bien mauvaise posture et qui va inévitablement la conduire à trancher par égard à sa profession, à sa dignité et à celle des Algériens qu’elle a choisi de défendre. En son âme et conscience, quand on examine assez bien les conditions dans lesquelles se déroule le procès du maquisard d’Aumale, Gisèle Halimi a résolu de sacrifier sa mère quand elle estime que la justice est menacée.
Le procès est suspendu «en cours de route» par un incident qui démontre que l’avocate du FLN n’était pas une femme à se mettre à genoux et subir passivement toutes les offenses qui la mettent entre l’étau du corps militaire, d’une part, et l’enclume du corps judiciaire, d’autre part.
Les premiers harcèlements, les insultes, ironiques et humiliantes, proviennent de militaires qui, après les opérations dans les djebels, se déguisent en magistrats du tribunal militaire pour statuer sur le sort des accusés algériens. Les provocations vont bon train à l’égard d’une avocate qui défend des résistants algériens que ces mêmes militaires combattent dans les djebels. Maniaques dans les histories de procédures, les défenseurs du FLN importunent et – voire même – déstabilisent des juges souvent pressés de juger, d’en finir et de classer rapidement les dossiers.
Les remontrances des juges et autres remarques désobligeantes se traduisent souvent comme un procès (c’est le cas de le dire) à l’adresse de l’avocate qui leur rend la tâche fort pénible et harassante et, somme toute, leur fait «perdre du temps» à cause d’individus indignes du moindre intérêt.
Au fur et à mesure du déroulement des débats sur le maquisard d’Aumale, le colonel ne cesse d’ailleurs de l’apostropher, propos teintés de mépris et de racisme envers les Arabes et les accusés : «Voilà trois heures que vous nous obligez à discuter de ces paperasses… Et tout ça pour un seul bicot…Quand je pense… Cette nuit nous en avons tué une douzaine.» (Le lait de l’oranger – p.266). Maître Gisèle Halimi n’est pas épargnée de la risée, d’une atteinte à la moralité et à la dignité. Elle fait l’objet d’un assaut verbal impudique émanant d’un autre officier qui profère, irrespectueux et insolent : «Une femme comme vous, venir jusqu’ici pour défendre les Arabes… alors que vous êtes faite pour l’amour…» (Le lait de l’oranger – p.266).
Au terme de la première journée des débats, Gisèle Halimi est, malheureusement, contrainte de prendre place sur un camion militaire pour être déposée à Aïn-Bessem, puisque comme nous l’avions signalé plus haut, à Aumale point d’hébergement. Une contrainte qui l’incommode et qui lui fait supporter péniblement une sorte de compromis avec des militaires hostiles à sa présence, hautins et méprisant le rôle dont elle s’acquitte pour défendre les inculpés algériens.
Le lendemain, d’autres comportements malsains, anti-déontologie et provocateurs, vont pousser l’avocate à réagir avec colère et quitter la barre malgré les insistances et les supplications du président du tribunal dont le souci primordial était de mener le procès à son terme, le plus tôt, au plus vite, comme pour se débarrasser d’une corvée.
Les gouttes qui annoncent le débordement du vase commencent avec le commissaire du gouvernement qui intervient en prélude avec une remarque associée et assaisonnée par l’insulte et le mépris, comportement qui donne l’impression que ce personnage ruminait depuis la veille les propos d’humiliation qu’il destinait à l’adresse de l’avocate parisienne. Qu’on en juge (et c’est le cas de le dire) : «Ces avocats qui ont la trouille le soir et qui crachent sur l’armée sont bien contents de trouver des convois militaires pour les raccompagner.»
Une entrée en matière outrageante, malveillante qui blesse l’amour-propre de l’avocate qui «encaisse», espérant peut-être que le président du tribunal rappellerait à l’ordre le commissaire du gouvernement volontairement et manifestement indélicat. Rien de tout cela. Bien au contraire, le magistrat persiste et signe. Il laisse sa pensée voguer librement et ne se dispense guère d’user du ton méprisant et flagrant à l’encontre du corps des défenseurs. Qu’on en juge une seconde fois :
«Ces défenseurs parisiens qui traînent leur robe d’avocat dans la boue en acceptant de pareilles causes.» (Le lait de l’oranger – p.266). Cette fois-ci la coupe est trop pleine. Elle déborde. C’est tout le barreau de Paris qui est en cause, qui est cité à la barre (c’est aussi le cas de le dire). Gisèle Halimi range ses affaires, plie sa robe et quitte la salle d’audience. Le commissaire du gouvernement avait auparavant refusé de présenter des excuses publiques.
Procès suspendu. Repris plus tard avec désignation d’un avocat d’office, en prévention d’autres incidents, d’irritation et de colère – amplement justifiée – de Maître Gisèle Halimi. Qui ne tolère plus et qui refuse avec fermeté qu’il est hors de question de porter atteinte à l’honneur des avocats et à la dignité de leurs clients. Avant de quitter la salle d’audience, elle avait d’ailleurs exigé énergiquement des excuses en public ; considérant qu’«au-delà même du principe même ; il me semblait important, pour les Algériens, de sonner l’image d’une certaine dignité de leurs défenseurs». (Le lait de l’oranger – p. 267).
Fidèle à elle-même, à ses principes, à ses engagements, Gisèle Halimi s’est fait un jour expulser du prétoire parce qu’elle avait osé démontrer – avec force et insistance – qu’il n’y a aucune comparaison à faire entre des inculpés de droit commun et des hommes qui se battent pour l’idéal de liberté et d’indépendance. Elle faisait fi des balises et autres barrières conventionnelles qui plaçaient – beaucoup plus par usage et tradition que par des règlements rigides et formels – l’avocat dans une sorte d’obligation de réserve et de se garder, par voie de conséquence, de franchir les lignes rouges.
Pendant toute sa carrière, Gisèle Halimi militait sans répit pour le réaménagement de la prestation de serment de l’avocat et pour la remise en cause de certaines obligations contenues dans le «garde-fou».
Le combat est global. Il était donc hors de question pour Gisèle Halimi de plaider en acceptant la terminologie et le vocabulaire que partagent les rouages de la police, de la gendarmerie, de l’armée et de la justice, à savoir, entre autres, que les éléments qui composent l’ALN ne sont autres que des «associations de malfaiteurs», des «hors-la-loi», des PAM («pris les armes à la main», résistants urbains (terroristes), guerre répressive (opérations de pacification), exploitation du renseignement (torture) et ainsi de suite.
L’avocate de Djamila Boupacha n’est pas de cet avis. En face, les juges militaires ne partagent pas – eux aussi, évidemment – l’avis et le défi de celle qui deviendra l’une des championnes du mouvement féministe en France et qui s’intégrera aisément dans les plus hautes sphères de la vie politique française.
L’histoire des «droits de la défense» du FLN pendant la guerre d’indépendance rendra nécessairement hommage aux avocates et avocats qui ont accepté, au péril de leur vie, d’être aux côtés des opprimés avec une mention spéciale pour Gisèle Halimi, une «rebelle» du barreau qui n’a jamais eu peur de confondre ceux qui pratiquaient à outrance le maquillage de la vérité.
«Pouvait-on assimiler, par exemple, disait-elle, au cours d’un procès, les moudjahidine algériens aux malfaiteurs de droit commun ? Ils se battaient pour leur dignité d’homme. De sujets ils se voulaient citoyens. Ils récusaient la loi française, parce que loi d’exception et d’oppression. Je tentais de l’expliquer. Je fus expulsée du prétoire. Les juges me reprochèrent d’injurier le drapeau français, d’oublier mon serment.» (Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – pp.115, 116 – Gallimard – 1988).
Pendant le délire du 13 mai 1958, elle s’est trouvée, par curiosité, mêlée à une foule au bord de l’hystérie. C’était aux abords du Forum d’Alger. Malgré la furie et le tumulte collectif, vagues de bousculades et les hurlements pour une «Algérie plus que jamais française», Gisèle Halimi, malgré tout, fut reconnue par un élément déchaînée qui appelle «l’armée au pouvoir», pressé d’applaudir à l’instauration du fascisme. Il vocifère pour ameuter son entourage immédiat : «C’est Halimi, c’est Halimi, la p… du FLN.» Menace imminente d’un lynchage en règle, dans la foulée, au cœur de la foule. C’est de justesse que son confrère Garrigues l’empoigne et la délivre d’un étouffement certain et sème l’agité-agitateur qui talonnait l’avocate.
Gisèle Halimi, une cible à neutraliser et à abattre. Assurément. Les harcèlements et les menaces sont monnaie courante. Les coups de fils nocturnes et anonymes dans les hôtels à Alger ou Constantine véhiculent des menaces de mort et toute une panoplie de grossièretés que seuls les lâches sont capables de débiter.
C’est avec l’OAS que les menaces de mort acculent sérieusement l’avocate du FLN. Sa condamnation à mort est décrétée et rendue publique. Ordre est donné aux tueurs de l’OAS de l’exécuter à tous moments et en tous lieux, si bien que sa protection est assurée par les membres d’un comité universitaire antifasciste qui venait de se constituer pour la garde des personnalités menacées d’attentats par l’OAS.
Une grande aventure de risque et de combat s’achève avec la guerre d’Algérie. Pour Gisèle Halimi, la mission est accomplie. Peu ou pas de contacts avec les anciens résistants des réseaux FLN. Il est plus que nécessaire qu’un travail de mémoire et d’écriture historique soit lancé pour vulgariser des épisodes marginalisés par «l’histoire officielle» et livrés carrément aux effets pernicieux de l’oubli et de l’amnésie.
Gisèle Halimi, de son vrai nom Zieza Taïeb (son père aimait l’appeler «Zeiza»), est née le 27 juillet 1927 en Tunisie. Elle fait des études en droit et commence à plaider à l’âge de 22 ans. Dès lors, elle se passionne pour le barreau, parcourant des lieux et des cieux pour défendre les victimes de l’arbitraire et de l’injustice. Avant ce périple, faudrait-il rappeler qu’avec la capitulation de la France et l’avènement du pétainisme, le juif devenait le mal-aimé et soumis aux pires persécutions. Le racisme antijuif pratiqué en Algérie par l’administration coloniale était plus féroce que celui pratiqué en Tunisie. Myriam Ben évoqua dans ses écrits ce qu’elle subissait comme insultes et brimades de ses «camarades» écolières et écoliers fils de fonctionnaires.
À Tunis, Gisèle Halimi, elle aussi était devenue le souffre-douleur de sa propre institutrice qui passait son temps à la gifler et à l’insulter sous n’importe quel prétexte : «Sale juive» ou «sale bicote». «Vous êtes le diable, tous, vous voulez nous bouffer.» Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – p.62 – Gallimard – 1988).
L’avocate poursuivra sa carrière d’éclat en éclat, d’exploit en exploit. Si elle ne remporte pas toutes les victoires, elle aura laissé, néanmoins, des traces qui ne disparaîtront pas de sitôt, celles de ses conclusions et de ses plaidoiries, de ses cris de colère et de révolte, de ses mises au point percutantes et imparables, infligées avec courage et témérité aux magistrats de l’appareil judiciaire répressif militaire.
Infatigable, Gisèle Halimi est d’une assiduité remarquable dans les batailles juridiques, politiques, culturelles qu’elle mène et poursuit, après la guerre d’Algérie, aux côtés de Simone de Beauvoir, Germaine Tillon et d’autres femmes dont l’action a influé notablement sur la conduite des affaires publiques avec, certainement, une prise en compte au plan international. Gisèle fut ambassadrice auprès de l’Unesco. Ses fréquentations intellectuelles les plus passionnées – les plus affectueuses aussi – sont celles consacrées au philosophe du siècle : Jean-Paul Sartre. Comme Frantz Fanon, qui avait noué un rapport intellectuel – et humain ¬— très particulier avec Sartre, Gisèle Halimi était, elle aussi, sous d’autres traits, devenue une collaboratrice rapprochée et intime de l’époux de Simone de Beauvoir.
Les luttes et les rendez-vous avec les grands moments de l’histoire politique qui l’ont interpellée à différentes étapes de son existence sont, pour la plupart, consignées aujourd’hui dans des ouvrages d’essence sociologique, philosophique, politique et où la femme, son statut, son devenir, son avenir, se trouvent au centre des préoccupations de la grande avocate et, qui, devant les dilemmes les plus angoissants, a toujours résolu de savoir «choisir» — notion – ou slogan – qui désigna le mouvement qu’elle anima avec Simone de Beauvoir.
Mais, on est en droit de s’interroger comment Gisèle Halimi, qui se mêlait à tout et de tout, avait-elle trouvé le temps d’écrire des livres : Djamila Boupacha (bien sûr), Gallimard 1962 ; La cause des femmes -1977), Le lait de l’oranger (Gallimard - 1988), Une embellie perdue (1995) et La nouvelle cause des femmes, entre autres. Il s’agit globalement d’une œuvre littéraire militante pour le statut et la condition de la femme mais aussi d’une mémoire fragmentée et répartie à travers certains ouvrages dont le contenu traite d’un ouvrage à un autre, des thèmes variés avec une grosse part, bien sûr, consacrée à la carrière d’avocate et aussi et surtout aux procès intentés aux résistants algériens par l’appareil judiciaire colonial français.
Chez Gisèle Halimi, ce n’est pas un exercice ordinaire d’une profession impliquée dans les barreaux, c’est beaucoup plus une mission, une passion et un engagement qui correspondent parfaitement à un tempérament hostile à tout ce qui porte atteinte à la liberté et à la dignité de l’être humain et à nuire à l’émancipation de l’individu. Pour Gisèle Halimi, le colonialisme rassemblait toutes les tares qu’il fallait combattre.
Ceci en harmonie et en conformité avec les orientations des dirigeants du FLN qui, de par une lucidité avérée, ne laissaient rien au hasard. Rien ne pouvait échapper à l’«organisateur hors pair que fut le regretté Abane Ramdane, conscient de tous les enjeux, y compris le rôle que doit jouer le corps des avocats, en plus de leur engagement politique, dans l’identification avec clarté de la révolution algérienne et ses combattants. N’est-ce pas à cause d’une remise en cause d’une terminologie mensongère et tendancieuse par les officines judiciaires que Gisèle Halimi fut expulsée manu militari d’un prétoire, au milieu d’une plaidoirie ? On l’avait accusée d’avoir porté atteinte aux idéaux inamovibles de la République française.
Les «avocats maison» ou ceux désignés d’office n’étaient guère autorisés à faire le moindre clin d’œil aux «conseils pratiques» du FLN en la matière. «Choisir», exprimer le courage et la volonté de choisir, de savoir choisir, voici le principe et le guide avec lesquels Gisèle Halimi refusait toute rupture. Car assez souvent quand on se trouve dans l’incapacité de savoir «choisir» avec une application rigoureuse de l’opportunité et de la promptitude, c’est inévitablement la consécration d’un ratage fatal avec les grands rendez-vous de l’Histoire.
Avoir choisi le camp des Algériens en assumant une fonction qui consistait à les défendre contre tous les abus de la justice coloniale, Gisèle Halimi mérite que nous témoignons notre sincère déférence, notre affectueux hommage et exige de nous le devoir d’entretenir dans nos mémoires le souvenir de son noble combat et de le perpétuer dans le futur en meublant la conscience de notre jeunesse.
A. B.
(*) Journaliste, historien.
Posté Le : 11/09/2020
Posté par : rachids
Source : le quotidien Le Soir d'Algérie le 26.08.2020