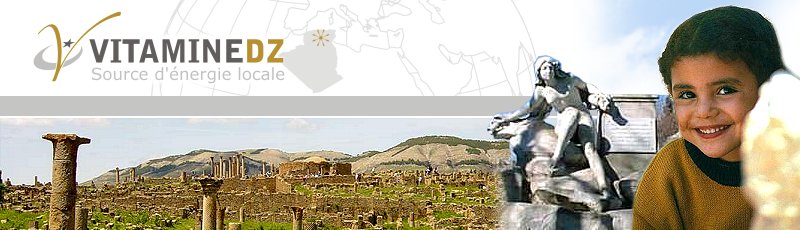
Gisèle Halimi : l’avocate de tous les défis (1re partie)
Article Publié par le quotidien Le Soir d'Algérie le 25.08.2020
Par Amar Belkhodja(*)
«Ce qui est scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue.»
(Simone de Beauvoir - Djamila Boupacha - p. 220 - Gallimard - 1962)
Je viens de me libérer péniblement des souffrances induites par un corona, sans danger pour certains, impitoyable et fatal pour d’autres. Je suis sous suivi médical à Alger, et, selon les premiers résultats, les choses ont tout l’air d’aller de mieux en mieux. Néanmoins, 80 ans d’âge, assaisonné d’un diabète chronique et d’une prostate coriace et persistante des décennies entières, ça peut nuire aux espoirs et aux espérances de vie.
Il est indiqué de se revivifier et d’injecter de bonnes doses d’optimisme pour permettre au moral de tenir bon et de résister aux bourrasques qui menacent de projeter notre corps contre les récifs et les écueils.
Heureusement, les sciences médicales et leurs praticiens sont plus que présents et se dressent comme des sentinelles, prêts à donner l’assaut contre des «envahisseurs maléfiques», invisibles et sournois, et les obliger à battre en retraite.
Ce qui m’a perturbé davantage ces derniers temps et réduit mon énergie, c’est d’avoir été dans l’impuissance de réagir promptement pour rendre hommage à une grande avocate, une grande militante anticolonialiste que nous retrouvons sur tous les fronts, debout, infatigable, passionnée, engagée, déterminée. Je veux nommer la vénérable, l’honorable, la respectable Gisèle Halimi. Je fus très mal à l’aise d’avoir commis le ratage d’une évocation, combien regrettable que la «raison de santé» m’imposa douloureusement.
Il y a quelques années, dans les années 1960 ou 1970 probablement, j’ai eu la chance d’avoir entre les mains Djamila Boupacha, ouvrage signé par Gisèle Halimi et préfacé par Simone de Beauvoir, compagne du célèbre philosophe Jean-Paul Sartre. Puis, malheureusement, on me déroba l’ouvrage. Assez souvent quand on consent à prêter un ouvrage, c’est assurément désespérer de le récupérer. J’avais perdu deux choses à la fois :
1.- Plus aucune chance d’exploiter le contenu de l’ouvrage qui rassemble témoignages et cheminement de toutes les péripéties du procès – de Djamila Boupacha et tant d’autres – de la rue Cavaignac où siégeait le tribunal militaire, en tant que rouage de l’appareil répressif colonial. 2.- Sur une page du livre figurait une reproduction du portrait de Djamila Boupacha exécuté par le célèbre peintre Pablo Picasso, antifranquiste, innovateur du cubisme, des périodes identifiées à travers les couleurs et signataire de la prodigieuse fresque Guernica qui fit le tour du monde et des époques. Le portrait consacré à Djamila fut signé par Picasso le 8 décembre 1961.
Plus d’une trentaine d’années après, un déplacement dans la ville de Boris Vian m’offrit un cadeau inespéré. Sur les quais de la Seine (Saint-Michel), découverte miraculeuse d’un ouvrage usé par le temps et par une édition plusieurs fois décennale : Djamila Boupacha.
Cette fois-ci, il n’est plus question de m’en défaire. À mon passif, un autre ratage (dans le journalisme, un ratage est la pire des choses qui puisse arriver à un praticien de la presse) combien regrettable celui-ci. Pendant mon séjour dans la capitale de l’héroïne de la commune de 1870, Louise Michel, je me suis procuré les coordonnées de l’avocate. Visite d’hommage et de courtoisie et d’affranchissement aussi. Déception. Sa secrétaire me fit part de l’absence des murs de Paris d’une avocate qui fut la mal-aimée du régime colonialiste et des colons et qui mettait les «bouchées doubles» pour confondre la justice militaire et autres institutions coloniales sur les dossiers les plus honteux : les arrestations arbitraires, les disparitions et la torture, devenue, somme toute, une véritable institution.
Une rencontre qui m’aurait affranchi sur un certain nombre de questions, surtout dénouer cette énigme, à savoir pourquoi la «désertion» de François Mauriac du mouvement «Pour Djamila Boupacha», initié par Gisèle Halimi et animé avec une ferveur exemplaire par Simone de Beauvoir, dès le lendemain de l’arrestation de Djamila Boupacha sous plusieurs chefs d’inculpation. Pourtant François Mauriac fut certainement le personnage qui avait dénoncé très tôt la torture – 1955 – pratiquée honteusement par les institutions militaires et policières françaises dès les premiers coups de feu de l’insurrection du 1er Novembre 1954.
Question en suspens, puisque nos calendriers n’avaient pas coïncidé pour consacrer une rencontre combien aurait-elle été enrichissante pour un chercheur toujours en quête d’une partie manquante d’un puzzle, jamais complété, jamais reconstitué. L’histoire est, en fait, un perpétuel questionnement et, comme en astronomie, les «trous noirs» ne sont jamais totalement conquis, totalement explorés…
Dans «l’affaire Boupacha», Gisèle Halimi déploie une énergie toute particulière qui emprunte deux voies à la fois, simultanément, complémentaires et qui fusionnent vers un objectif essentiel, à savoir désarçonner l’édifice judiciaire colonial et enclencher (ou déclencher) une mobilisation d’une partie de l’élite intellectuelle française autour d’une cause précise, en premier chef, le dossier Boupacha mais à travers lequel entraîner un véritable mouvement de dénonciation de la torture et d’opposition à la guerre coloniale.
La première action est de nature strictement juridique. La seconde, si elle prend le relais de la première, elle est davantage politique puisqu’elle va impliquer des personnalités de divers horizons.
Si Gisèle Halimi est «au four et au moulin», elle laisse cependant le soin à Simone de Beauvoir de manier – habilement, efficacement et intelligemment – le gouvernail politique qui va permettre à ces deux grandes dames de mettre en péril un régime qui chancèle, un empire en déchéance, une république qui s’entête désespérément à assembler des débris et les épaves d’un navire qui chavire à toutes les tempêtes, s’enfonce dans les abysses malgré tous les déguisements, les rafistolages et autres «bricolages» politiques faits de mensonges et de comédies.
Côté juridique – ou justice coloniale – (consulter Sylvie Thénault) les armes étaient ô combien inégales. L’appareil judiciaire était d’une taille surprenante et gigantesque par rapport aux «coups» et aux conclusions de l’avocate du FLN – ou de l’ensemble des avocats du FLN. Les combines étaient telles que l’avocat de Boupacha s’épuisait dans l’épuisement (c’est le cas de le dire) des délais réglementaires qu’on lui accordait pour séjourner à Alger. Assez souvent, la procédure tournait à l’avantage de la justice militaire et, comble de la malhonnêteté, on s’arrangeait pour désigner un avocat d’office qui «caressait» dans le sens du poil et n’osait jamais importuner les juges militaires de la rue Cavaignac, devant lesquels défilaient à longueur d’année les résistants de l’ALN et du FLN.
D’une rive à l’autre, l’atmosphère qui régnait dans les tribunaux n’était – évidemment – pas la même. Si à Paris, Vergès, Benabdallah et Oussedik «semaient la panique dans les prétoires» (Les porteurs de valises – Rotman et Hamon), à la rue Cavaignac, les barreaux étaient sévèrement gardés et il était plus aisé pour les magistrats militaires de manipuler les procédures judiciaires à leur guise en plus des menaces ouvertement prononcées contre les défenseurs et les insultes haineuses proférées contre eux par la faune des pieds-noirs qui «accueillent» avocats et inculpés dans les salles d’audience par un récital houleux, bien achalandé d’un vocabulaire raciste, malveillant.
En dépit de cette atmosphère infestée par un appel au lynchage et encouragé par le tribunal militaire de la sinistre rue Cavaignac qui porte le nom d’un ignoble criminel de la conquête française, maître Gisèle Halimi – et ses confrères – se cramponnait, vaille que vaille, aux fragiles cordes de la procédure et parvenait avec adresse à «troubler» elle aussi les prétoires algérois et gagner quelques batailles juridiques en utilisant les armes et les contradictions de l’adversaire et débusquer les failles d’un appareil judiciaire pourtant solidement barricadé dans la lenteur et les astuces les plus mesquines et les plus déshonorantes.
Malheureusement pour l’avocate et sa «cliente», le procès de Boupacha sera certainement le plus long de tous les procès intentés aux Algériens pendant la guerre d’indépendance. Le plus long, en ce sens qu’il chevauchera sur «deux territoires». Le premier acte en Algérie, le second en France au prix d’une harassante procédure. Maître Gisèle Halimi remet en cause les examens médicaux et exige le transfert de Djamila Boupacha en France et obtient l’intervention d’experts et, parallèlement, elle accède à la saisie d’une juridiction autre que celle qui sévit à Alger. Bien sûr, nous avons l’impression que la bataille juridique – aux armes toujours inégales – est presque remportée. La procédure est frappée – sciemment – d’une lenteur inouïe ; en somme, la défense s’oppose à une «arme à double tranchant» qui rend les démarches pénibles et la besogne fastidieuse. Boupacha subit, entre-temps, le poids d’un fardeau psychologique traumatisant, consécutivement à ces «va-et-vient entre les cabinets des magistrats et les cabinets médicaux, ces derniers appelés à «exhiber» ce qui resterait des traces de la torture. Le temps s’écoulant, il subsiste, bien sûr, le risque d’effacement de toute marque de sévices subis.
Djamila Boupacha, tourmentée dans son âme et persécutée dans son corps, a traîné assez longtemps une infirmité dans la région de l’épaule parce que les parachutistes français s’étaient mis à piétiner son corps avec haine et brutalité. Faire traîner les choses, alourdir au maximum les procédures, c’est inévitablement réduire toutes les chances aux experts médicaux de «la Métropole» de découvrir la moindre trace qu’auraient laissée des actes de brutalité et de violence, signés par l’institution militaire française qui passe le relais à l’institution judiciaire, chargée de parachever et justifier les «opérations de pacification» ou «du maintien de l’ordre».
Le comble de l’anachronisme ou encore celui de la bassesse et de la mesquinerie dont fait état l’autorité judiciaire, c’est lorsqu’elle réclame à la défense les «frais de transfert» de Djamila Boupacha d’Algérie vers la France.
C’est d’ailleurs par quoi nous tenterons de résumer l’action politique qui s’est toujours superposée ou accompagnait la bataille purement juridique. Au-devant de la scène, nous retrouvons, bien sûr, Simone de Beauvoir, toujours «flanquée» de Gisèle Halimi qui vont, toutes les deux, lancer le mouvement «Pour Djamila Boupacha».
Faut-il préciser aussi, qu’avant de satisfaire à la «quête» de la collecte des «frais de transfert» de Boupacha – les caisses de la trésorerie officielle étant «pratiquement vides» — le comité pour Djamila Boupacha a déjà franchi d’importantes étapes.
Des meetings, rencontres marathons brassent et mobilisent autour de la cause une partie de l’élite intellectuelle française (cinéastes, acteurs, comédiens, écrivains, journalistes, d’anciens résistants antinazis, artistes, de simples citoyens aussi). En définitive, Simone de Beauvoir, personnalité très influente, adoptée et écoutée dans les milieux du savoir, de la production intellectuelle, a le don de la persuasion. De surcroît, c’est aussi la compagne d’une autre lumière du temps : Jean-Paul Sartre, philosophe du siècle et père d’un «existentialisme» qui séduit une colonie fébrile d’une jeunesse française, toujours en quête et en attente de réponses définitives aux énigmes du monde et des sociétés qui bourdonnent dans tous les sens sans aucune précision sur le chemin à prendre.
Le 24 juin 1960, c’est le coup d’envoi. Le comité Djamila Boupacha organise une conférence de presse pour dévoiler au grand public que des choses horribles ont lieu en Algérie où le régime ne parle que «d’événements», de «pacification» ou de «maintien de l’ordre», contre une minorité d’agitateurs et de bandits de droit commun. Après l’intervention de l’auteur du Deuxième Sexe qui inaugure les débats, c’est Bianca Lambin qui donne lecture de la lettre du père de Djamila Boupacha qui, dans un français phonétique, décrit les effroyables et humiliantes séances de tortures qu’il avait atrocement subies. Le silence et l’émotion dans la salle étaient tels que la lectrice est saisie de sanglots. C’est Simone de Beauvoir qui se charge de terminer la lecture du supplicié aux accents si sincères, si émouvants et si révoltants à la fois. Bon nombre de Françaises, anciennes résistantes ou déportées pendant la Seconde Guerre mondiale, adhèrent sans hésiter, avec un engagement politique exemplaire, au mouvement qui n’est autre que le précurseur du manifeste des 121. Germaine Tillon et Anise Postel, toutes deux anciennes déportées, s’acquittèrent d’un rôle remarquable au sein du comité pour dénoncer les tortionnaires de Djamila Boupacha.
Aux rencontres qui apportent davantage d’éclairages sur une guerre que le régime maquille effrontément en «événements» ou encore – hypocritement – en «opérations de maintien de l’ordre», s’ajoutent des dizaines de correspondances que compile, tous les jours, le comité pour Djamila Boupacha et dont le contenu exprime colère et réprobation contre les pratiques indignes dont avaient souffert auparavant les Français sous l’occupation allemande.
Émotions aux accents intenses, dénonciation d’une guerre injuste livrée à un peuple qui exige sa liberté, solidarité avec une jeune femme – Djamila Boupacha – «abîmée» moralement et physiquement par une armée immorale au service d’un «empire colonial agonisant» qui creuse lui-même son propre tombeau en terre algérienne ; ce sont là mille et une opinions que certaines Françaises et certains Français ont refusé de refouler indéfiniment ou se taire sur des méfaits honteux commis – tous les jours – en leur nom.
Écrivains de renom et de talent grossissent les rangs du mouvement, animé et conduit avec une intégrité morale et intellectuelle, épuré de tout esprit démagogique et manipulateur ; action incarnée par deux femmes indignées et en colère : Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Si François Mauriac se fait remarquer par une absence qui nous taraude encore l’esprit, les lettres françaises sont puissamment et merveilleusement présentes grâce à une écrivaine qui a déjà conquis les milieux de la littérature française : Françoise Sagan. La «mère» de Bonjour tristesse rejoint, sans hésiter, le comité et la lettre qu’elle lui adresse a provoqué un véritable choc dans les consciences et induit une accélération supplémentaire au mouvement, en suscitant de nouvelles adhésions notamment. Le contenu du «document» de Françoise Sagan – une femme en colère et en douleur – ne pouvait pas traverser le paysage médiatique et l’opinion publique dans l’indifférence. La force littéraire, l’émotion, l’indignation exprimées par une femme d’esprit sont autant d’incitations à la dénonciation de la torture et à la formation de nouveaux contingents en devoir de donner l’assaut au mensonge et à la supercherie.
Pendant que le comité piloté par Simone de Beauvoir sensibilise courants et opinions, sème le sentiment de la révolte, le réseau Jeanson mis en place – dans la clandestinité – est déjà à l’œuvre et en mouvement.
Le Comité Audin animé par l’historien Pierre Vidal-Naquet tient la dragée haute aux ennemis de la justice et de la vérité ; l’affaire Ali Boumendjel, jeté par-dessus le 6e étage d’un immeuble à El-Biar, a déjà provoqué de sérieux remous dans les sphères politiques dirigeantes.
La guillotine est mise en action le 19 juin 1956 avec la première décapitation de H’mida Zabana, estropié et à moitié aveugle, marchant vers l’échafaud avec courage et dignité. L’assassinat de Mohamed-Larbi Ben M’hidi par une pendaison «convertie», sans honte ni pudeur, en suicide par une armée qui a fait du sens de l’honneur une bouse de vache.
Ce sont de tragiques chapitres qui ne sont d’ailleurs que des «arbres qui cachent la forêt», écrira plus tard Raphaëlle Branche (La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie – Gallimard – 2001), puisque ce sont des «événements connus qui n’ont pu contourner le scandale, tandis que tout le paysage s’était transformé en un «vaste chantier» de répression, de séquestration, de torture, en «corvées de bois», déguisées en «évasions…
C’est ce qui fera dire, entre autres, à Simone de Beauvoir, cependant qu’elle remue ciel et terre pour mettre à… terre les « professionnels du mal (Benyoucef Benkhedda), la compagne de l’auteur des Mains sales (c’est le cas de le dire) proclamera en effet une sentence irrévocable pour définir avec un sentiment de révolte et d’indignation tout ce qui est mis au service de «la raison d’État», à savoir que «ce qui est scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue». (Djamila Boupacha – Gallimard – 1962).
Dans le même article, consacré en premier chef au cas Djamila, la femme-philosophe étale librement sa pensée et son opinion en ajoutant notamment : «Quand les dirigeants d’un pays acceptent que les crimes se commettent en leur nom, tous les citoyens appartiennent à une nation criminelle.» (Article publié par le journal Le Monde.)
Dans l’affaire «Djamila Boupacha», l’auteure dénonce le gouvernement français qui se tait – en vérité, il cautionne et autorise – sur la torture et les assassinats que commet l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Je me suis permis de remanier, à mon tour, la pensée pour dire : «Quand les citoyens d’un pays acceptent que les crimes se commettent en leur nom, ils deviennent autant des criminels que les dirigeants qui ordonnent de les commettre.» C’est affirmer que les pensées voyagent dans le temps et dans l’espace avec cette faculté de correspondre aux situations qui prévalent à travers les époques, tellement les régimes tyranniques se ressemblent par le recours diabolique et rusé à la notion consacrée «inviolable», l’éternelle «raison d’État», l’arme la plus redoutable qui autorise tous les abus, toutes les injustices, toutes les manipulations et tous les endoctrinements. La planète pullule d’exemples qui se sont relayés à travers les siècles et à travers les espaces.
Pour reprendre le dossier Djamila, il faut rappeler que tous les subterfuges, toutes les ruses juridiques furent utilisés par l’appareil judiciaire colonial pour faire traîner indéfiniment le procès. Certes, les deux femmes, l’avocate et l’accusée, arrivent à bon port parce que la guerre d’Algérie venait de connaître l’épilogue dicté par le cours de l’Histoire, celui de l’indépendance des Algériens. En vérité, maître Gisèle Halimi arrive exténuée mais triomphante. Tandis que Djamila, elle aussi, arrive essoufflée, épuisée, l’âme traumatisée, le corps blessé mais combien réconfortée et réjouie puisque son pays et son peuple recouvrent liberté et dignité, au terme d’un long combat, âpre et acharné.
«Nous ne sommes rien sur cette terre si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples, celle de la justice et celle de la liberté.»
(Frantz Fanon)
Gisèle Halimi : aux côtés des inculpés du 20 Août 1955
Au lendemain de l’offensive du 20 Août 1955 dans la Zone II lancée par Zighoud Youcef, c’est l’hécatombe. C’est la vengeance et la haine. Armée et milice interviennent sans pitié, rappelant le crime génocidaire de mai et juin 1945, à Sétif, Kherrata et Guelma. Skikda et sa région connaissent le même drame. 10 à 12 000 Algériens sont massacrés avec le fer, les encouragements et la bénédiction de Jacques Soustelle, alors gouverneur général, un triste sire zélé et défenseur intraitable d’une Algérie plus française que jamais.
L’Algérie a connu trois grands criminels politiques, ennemis implacables du peuple algérien dont il faut dresser les portraits en guise de témoins pour l’Histoire et la postérité. Le premier, c’est le sanguinaire sous-préfet André Achiary qui a décimé la fine fleur de la jeune Guelmoise en mai et juin 1945, en instaurant une cour martiale et en armant des groupes de miliciens – y compris enfants et adolescents – qui se ruèrent à cœur joie dans la chasse à l’Arabe. Le deuxième, avec le même profil, c’est-à-dire enclin au meurtre collectif et individuel des Algériens, c’est Jacques Soustelle, gouverneur général, qui ordonne le crime génocidaire contre les populations de Skikda et toute sa région pour venger, comme en Mai 1945, moins d’une centaines d’Européens. Imitant Achiary qui massacra des milliers d’Algériens à Guelma, Jacques Soustelle, vingt-quatre heures après les troubles, promet de distribuer des armes aux colons.
Ce qui veut dire, ni plus ni moins, qu’une autorisation au crime.
À nouveau, l’Histoire va prendre acte d’une réédition des massacres de mai et juin 1945. On pourchasse n’importe qui, on tire sur n’importe qui. Qu’importe. On massacre des milliers d’innocents. Les «coupables» avaient déjà rangé leurs «armes hypothétiques» trois ou quatre jours après le mouvement insurrectionnel. En réalité, décision est prise de faire la guerre aux populations désarmées. Tout le monde hurle à la vengeance.
Colons et dirigeants. Gisèle Halimi, la future avocate de Djamila Boupacha, écrira à ce propos, lorsqu’elle aura à assurer la défense des inculpés du 20 Août 1955, lors de leur procès qui aura lieu en février 1958. Je cite : «Chaque Algérien est un fellaga qui s’ignore. Il l’a été, il l’est ou le sera. À exterminer donc» (Le lait de l’oranger – p.129 – Gallimard 1988).
Les représailles de l’insurrection de la Zone VII (20 Août 1955) n’ont pas été scrupuleusement consignées par l’histoire du martyrologue algérien et de l’esprit de sacrifice de la paysannerie algérienne qui, sans armes automatiques entre les mains, a donné l’assaut aux postes de sécurité français et aux fermes coloniales. Le troisième criminel politique, c’est Robert Lacoste, ministre résident, qui s’active avec zèle pour faire le bonheur des colons dans la mise en mouvement de la guillotine un certain 19 juin 1959. Robert Lacoste, c’est encore lui qui applaudit des mains et des pieds le vote des pouvoirs spéciaux par le Parlement français (communistes compris) et s’égosille à chanter les méfaits des parachutistes français quand ils se mettent à l’œuvre malsaine et maléfique, celle de semer la terreur et de généraliser la torture. Le diplôme d’avocate en poche, Gisèle Halima se détourne de sa mère pour choisir la justice. Elle s’engage dans un chemin périlleux. Car être avocate sous le régime colonial est un métier à haut risque. Qu’importe. Elle défend les nationalistes tunisiens (Gisèle est tunisienne), les nationalistes algériens. Elle défend Mehdi Ben Barka et des syndicalistes marocains. Elle sera également présente en Espagne pour assurer la défense des Basques antifranquistes. En Palestine, elle défendra le plus ancien prisonnier dans les geôles d’Israël, Marwan Barghouti. Elle fit l’objet, bien sûr, de toutes les ruées haineuses, porteuses d’insultes les plus honteuses et les plus ignobles animées par des fanatiques israéliens que l’«ordre» n’inquiétera nullement. Cependant, c’est en Algérie qu’on lui remarquera une présence assidue dans la défense des résistants algériens. Le procès qui fera couler beaucoup d’encre est, bien sûr, celui de Djamila Boupacha.
Toutefois, le procès où Me Gisèle Halimi subit les plus grands risques et les intimidations les plus abjectes, c’est celui du 20 Août 1955, qui se déroule le 17 février 1958 à Skikda. Les 44 inculpés sont tous originaires d’El-Halia. Par quel hasard, la fille de Tunis va se trouver aux côtés des insurgés du 20 Août 1955 ? C’est l’un des captifs qui lui envoie une lettre de la prison de Skikda dont le contenu est un véritable cri de détresse.
Nous estimons qu’il ne sera pas utile d’aller au cœur des événements dans les détails, ni de conduire le lecteur à travers les méandres de la justice, ni de décrire les duels juridiques entre défenseurs et accusateurs, ni sur le dénouement de l’affaire. Il serait trop long et trop fastidieux à la fois, compte tenu des spécificités du domaine. Pour nous, l’essentiel c’est de mettre en avant l’atmosphère débordante de menaces et emplie de terreur dans laquelle vont évoluer les avocats (maître Gisèle Halimi est accompagné par maître Léo Matarasso, un autre avocat de talent).
Rappelons dans ce contexte que plusieurs avocats du FLN furent assassinés par la Main Rouge ou par l’OAS pendant la guerre d’Algérie, entre autres, maîtres Pierre Poppie, Pierre Garrigues, Thuveny, Ould Aoudia, Abed… tandis que plusieurs autres furent carrément emprisonnés par les pouvoirs répressifs français. Maîtres Jacques Vergès fit l’objet d’un attentat à Paris. La veille de l’ouverture du procès du 20 Août 1955, Skikda est loin de souhaiter la «bienvenue» aux deux défenseurs des inculpés d’El-Halia. Les premiers tracas commencent au niveau des conditions d’hébergement. Le premier hôtel affiche un refus catégorique. Les avocats des «égorgeurs d’El-Halia» sont indésirables, soutient-on. Le climat d’interdiction de séjour est déjà entretenu par la presse locale coloniale qui ranime les passions et la haine contre les insurgés du 20 Août 1955, et incite la population européenne locale à «pourchasser» leurs défenseurs.
Le bûcher est dressé. Gisèle et son confrère vont être confrontés aux pires menaces et aux pires intimidations. On frappe aux portes du deuxième hôtel. Le patron semble accepter de les héberger mais deux heures après leur installation, tout agité, il les invite impérativement à quitter les lieux. Dernière tentative auprès du troisième et dernier hôtel de la ville de Skikda. Les deux avocats s’installent. Bon signe. Cependant, le danger plane toujours. L’hôtelier, la peur au ventre, les réveille brutalement vers cinq heures du matin pour les avertir que des Européens sont prêts à tout saccager et à tout brûler. Effectivement, dehors, il y a une très menaçante agitation. La situation est bel et bien grave. Les autorités ont les yeux bandés. Elles encouragent la loi du lynchage et ne manifestent aucune volonté ni ne prennent aucune mesure pour assurer l’accueil et la sécurité des deux défenseurs. À Skikda, la terreur règne. Les deux avocats sont pourchassés et traqués d’un endroit à un autre, d’un hôtel à un autre.
Dix ans auparavant, en 1947, deux avocats parisiens, maîtres Pierre Stibbe et Henri Douzon, ont échappé à des tentatives d’assassinat fomentées par des colons tueurs. Les deux avocats avaient rejoint Madagascar pour défendre des députés malgaches accusés d’être à l’origine du soulèvement qui a coûté au peuple malgache 89 000 morts. Il est fort utile, avant de clore le chapitre de la terreur à Skikda, de consigner quelques éléments sur ce qui s’était passé à Madagascar. Un dossier – global – qui doit être scrupuleusement exploité et par là même exhumer toutes les persécutions infligées aux avocats face à la justice coloniale partout dans les anciennes colonies. La journée du 23 mars (Ali Boumendjel fut assassiné le 23 mars 1957) est décrétée journée nationale de l’avocat, c’est-à-dire sur la défense et ses droits. C’est ce qu’on appelle «avoir du pain sur la planche». À Madagascar, les colons sèment la terreur. Maître Stibbe et Douzon sont pour ainsi dire condamnés à mort. Maître Pierre Stibbe est victime d’une tentative d’assassinat dont les auteurs ne seront jamais retrouvés. Maître Henri Douzon échappera miraculeusement à la mort. En septembre 1947, il fut enlevé par une bande de tueurs masqués, lynché et laissé pour mort dans la campagne à 25 km de la ville de Diego-Suarez, au cœur des broussailles auxquelles ses agresseurs mirent le feu. Une tentative de meurtre qui n’a pas empêché l’avocat de retourner à Madagascar l’année suivante, en 1948, pour assurer la défense des députés malgaches (Source : Amar Belkhodja – Barbarie coloniale en Afrique – Anep - 2002).
A. B.
(À suivre)
(*) Journaliste, historien.
Posté Le : 11/09/2020
Posté par : rachids
Source : Le quotidien le Soir d'Algérie du 25.08.2020