
Douar. Une saison en exil (Roman) - Éditions Domens
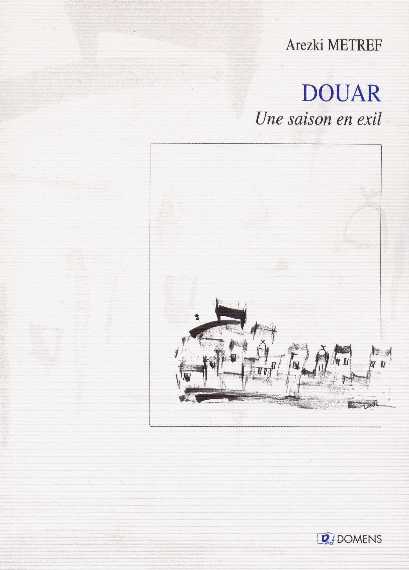
L’exil, c’est attendre. Attendre les nouvelles du douar. Attendre d’avoir une piaule. Attendre des papelards. Attendre un ami, une amie, des amis. Attendre que les météos s’améliorent, celle du temps, celle de la politique. Attendre d’entrer dans le cercle. Attendre, à défaut, de le briser. Attendre enfin la fin du cercle…
Donc, te voilà dans la queue de ceux qui attendent. Comme eux, tu ne sais qui, quoi, comment… Attendre te devient simplement une raison sociale, une identité à part entière, le motif vital pour lequel le matin tu te lèves.
Une âme pour les états d’âme
«Ici, nous n’existons que comme boucs émissaires. Le chômage, c’est nous. L’insécurité, c’est nous. Le trou de la sécurité sociale, c’est nous. La délinquance, c’est nous. La drogue, c’est nous. Nous ne sommes que des bruits et des odeurs.
Nous sommes ce qu’il faut supporter, le mauvais moment à passer… quand l’un de nous réussit, on vante les mérites de l’intégration…»
Ce paragraphe, extrait du livre d’Arezki Metref, Douar, une saison en exil, résonne encore dans ma tête et une question ne cesse de me tourmenter : pourquoi l’exil, même quand il est un choix, génère-t-il autant de souffrance chez l’exilé ? Je crois que même l’auteur, qui nous livre, dans cet ouvrage paru aux éditions Domens, son expérience, à moins que ça soit celle d’un exilé anonyme, n’a pas de réponse à mon interrogation.
Car depuis l’indépendance de l’Algérie, des centaines de personnes s’exilent chaque année et le refrain du «mal du pays» revient dans les écrits, dans les chansons et dans les histoires de chacune d’entre elles. Et quand on fait partie, dans son pays natal, de la «crème» de la société, le mal est encore beaucoup plus perceptible.
Arezki Metref est journaliste. Après les premiers attentats terroristes visant cette corporation, ainsi que les intellectuels en général, l’instinct de survie prit naturellement le dessus sur tout autre considération. Et ainsi, Arezki Metref s’installe à Paris en 1993.
Depuis quelques mois, ses allers et retours vers l’Algérie sont fréquents. Le personnage de son œuvre littéraire est habillé de ce statut d’intellectuel, contraint de quitter son douar pour la France. Avant même de mettre les pieds dans ce pays d’accueil, le futur exilé a déjà monté des scénarios de ce que sera sa vie ailleurs.
Intellectuel, il sait que l’exil de toujours n’est pas celui d’un rêve. C’est encore plus dur à vivre que de savoir qu’on sera désormais «l’autre», «l’indésirable». En dehors de toutes les peines et de tous les ressentiments qui se dégagent de ce récit, l’auteur a su accrocher le lecteur par son écriture poétique et la force de son verbe.
La précision dans la description des émotions, du monologue, de l’environnement extérieur marquent une bonne présentation du récit dont la lecture devient fluide, facile et agréable. C’est tout le talent d’ailleurs de l’auteur, qui nous a habitués à ce genre d’écriture dans la presse.
La seule nuance, c’est que les reportages avec lesquels Arezki, le journaliste, est revenu, après un passage dans des douars de la Kabylie, qu’il a d’ailleurs compilés dans un ouvrage, sont abordés avec joie et passion, alors que le grand douar qu’est l’exil est approché avec recul, méfiance et beaucoup d’angoisse.
Les intellectuels algériens restés au pays savaient bien, avant d’être frappés de terreur par les terroristes qui les pourchassaient sans relâche, qui ils étaient et ce qu’ils faisaient, tandis que pour ceux vivant l’exil, c’est toute leur identité qui est bousculée, voire remise en cause.
Il est vrai que nos intellectuels peuvent «s’intégrer» socialement et culturellement, mais peut-on imposer à son âme un autre douar que celui qui nous a nourris de sa culture, de sa terre ? Il faut peut-être avoir goûté à la souffrance de l’exil pour se rendre compte combien l’âme est profonde et une.
Posté Le : 17/05/2006
Posté par : nassima-v
Ecrit par : Rosa Mansouri
Source : www.jeune-independant.com