
Une approche historico-critique de l'islam des origines
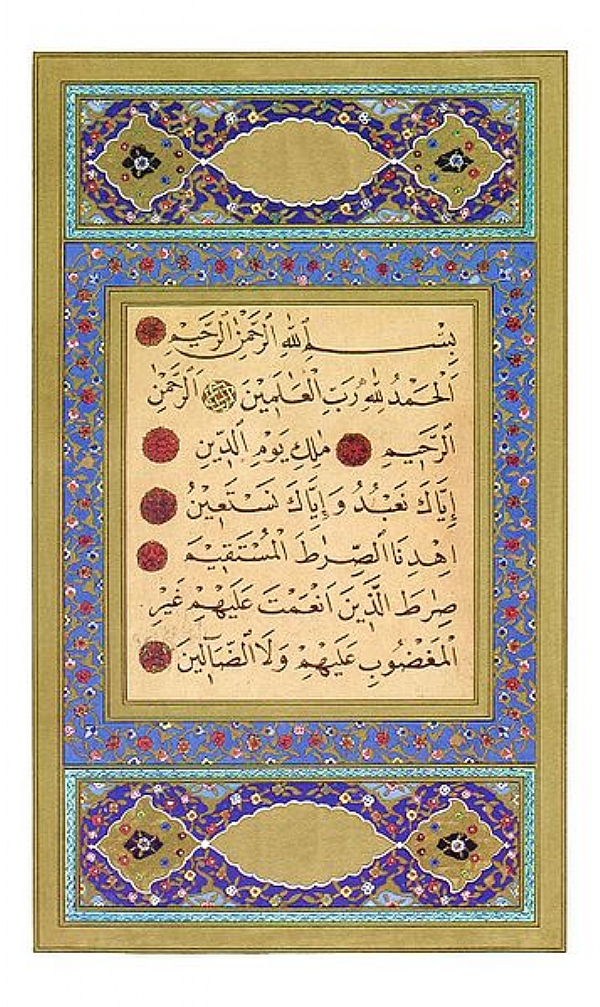
Jacqueline Chabbi, comment vous êtes-vous lancée dans le monde des études islamiques ?
C'est généralement un peu par hasard que l'on trouve un axe de recherche. Je m'intéressais depuis toujours à l'histoire. Claude Cahen, professeur d'histoire du monde musulman à la Sorbonne, était mon maître depuis le temps où je préparais une licence d'arabe dans les années 1964-65. J'avais découvert cette langue – que l'on a longtemps dite rare parce qu'elle est peu enseignée en France – dès le lycée, en cours du soir. L'histoire du monde musulman médiéval faisait évidemment partie intégrante de nos études universitaires.
Comment avez-vous abordé la recherche et découvert les distorsions, sur lesquelles vous insistez tellement, entre l'histoire des historiens et la manière dont l'islam considère sa propre histoire ?
Mon premier grand sujet, celui de ma première thèse, a porté sur le soufisme, c'est-à-dire sur l'histoire de la mystique musulmane. C'est au travers de cette recherche que j'ai construit, presque sans le savoir, ce qui allait devenir ma méthode de travail : se laisser guider par son objet d'étude et son terrain propre, une fois qu'ils ont été bien définis et qu'on en a fait une étude systématique, directement à partir des « sources » anciennes. Par cette expression, il faut entendre les écrits qui sont les plus proches de la période sur laquelle on travaille, lesquels doivent impérativement être étudiés dans leur langue, jamais en traduction ; sinon on peut être victime, sans même s'en apercevoir, d'effets très négatifs de « projection culturelle ». Une autre règle de base est de ne jamais envisager un objet de recherche à partir d'une théorie préconçue ! À ignorer cela, on n'a aucune chance de démonter les évidences qui passent pour intangibles.
Mon premier travail de recherche dans le domaine de la mystique musulmane portait sur un personnage du XIIe siècle qui était censé avoir été le fondateur de la confrérie des qadirites. Cette confrérie est encore présente aujourd'hui, de l'Afrique occidentale à la Malaisie. Je fus très surprise de constater qu'il y avait une différence importante entre la vie historique du personnage qui avait été avant tout un juriste musulman, originaire d'Azerbaïdjan, et la réputation qu'on lui avait faite après sa mort. Il passe même aujourd'hui pour un descendant du prophète Mahomet. Je découvris ainsi, à partir d'un fait concret, qu'il pouvait y avoir une distorsion majeure entre l'histoire comme fait vécu et l'histoire comme représentation, surtout dans le domaine des religions et des croyances collectives.
J'étais par hasard tombée sur un cas typique de dissociation du vécu et du récit. Il n'y a rien de tel pour aiguiser le sens critique d'un historien. En fait, j'avais eu beaucoup de chance en rencontrant d'emblée un sujet aussi formateur. C'est de cette période que date mon article sur le soufisme dans l'Encyclopaedia Universalis.
Comment en êtes-vous venue à travailler sur l'islam des origines ?
Il faut savoir répondre à sa propre curiosité quand elle se manifeste, quitte à changer radicalement de cap. C'est précisément ce qui m'est arrivé ! Enseignant à l'université depuis quelques années, j'eus à traiter une question d'histoire sur Mahomet pour les étudiants qui préparaient l'agrégation. Forte de ma première expérience dans le domaine de l'histoire de la mystique, je ressentis la curieuse impression que les auteurs que je lisais pour préparer mon cours et qui travaillaient sur le fondateur de l'islam s'en laissaient un peu trop conter par les textes qu'ils utilisaient, des textes médiévaux largement postérieurs au début de l'islam. Je décidai d'aller voir un peu plus loin.
Ce travail devint vite passionnant. Je fis part à mon directeur de recherche de mes premiers résultats et je convins avec lui de changer le sujet du doctorat d'État sur lequel je travaillais pourtant depuis une dizaine d'années. C'est ainsi que j'abandonnai les mystiques pour rencontrer le monde de Mahomet. Je ne l'ai toujours pas quitté.
Je retrouvai, là encore, un cas de dissociation historique, la vie de Mahomet dans l'Arabie tribale du VIIe siècle et ce que les sociétés musulmanes ultérieures allaient faire de lui en idéalisant le personnage. Mais l'enjeu était cette fois beaucoup plus important. Il concernait l'interprétation des origines de ce qui allait devenir une religion majeure.
Pourquoi « Mahomet » et non « Mohamed » en parlant du prophète musulman ?
Je précise, pour ne troubler personne, que si je parle de « Mahomet » et non pas de « Mohamed », c'est parce que je m'inscris dans la tradition savante. Mahomet est la forme francisée obtenue à partir du latin Mahometus. Je ne suis d'ailleurs pas la seule à écrire ainsi. Pensez au Mahomet de Maxime Rodinson, publié dans les années soixante, qui est devenu un des classiques du genre. Cela ne veut évidemment pas dire que je considère les musulmans qui portent normalement la dénomination que le Coran leur attribue, muslim, « celui qui consent à se mettre en sécurité auprès de quelqu'un » plutôt que le « soumis », terme qui a donné « musulman », comme des « Mahométans », ainsi qu'on le faisait jadis. C'était effectivement une manière de rabaisser leur religion que de les rattacher dans leur désignation même à un homme considéré en Occident comme un faux prophète. C'est uniquement le qualificatif qui est péjoratif, et non le nom de Mahomet lui-même qui était jadis la seule forme usitée.
Est-ce que le fait de vouloir remonter le temps pose des problèmes particuliers dans le cas d'une culture que l'on peut dire religieuse ?
Pour accéder à l'étude d'une période historique ancienne, on rencontre généralement de multiples obstacles. C'est comme si le temps écoulé entre le moment où vit l'historien et le moment du passé qu'il veut découvrir barrait la route vers ce passé. L'image serait un peu celle d'une caverne préhistorique dont l'entrée disparaîtrait sous un amoncellement de rocs qui auraient roulé de la montagne au fil du temps et qu'il faudrait dégager un à un.
Dans le cas d'une grande tradition religieuse qui, pour l'islam, est en même temps une grande tradition culturelle, les interprétations successives font partie de ces obstacles. Mais, en même temps, chacune sert de repère et de témoin de son époque. Il faut simplement les reconnaître pour ce qu'elles sont, en elles-mêmes, et ne pas croire qu'elles nous apportent les questions et les réponses. D'un point de vue historique, le passé ne nous parle pas par-delà les siècles. Il se parle à lui-même, et les textes conservés nous en donnent un écho.
Lorsqu'une culture se rattache à une religion vivante comme l'islam, il existe encore d'autres obstacles. Ils sont ceux de la croyance au présent qui a évidemment un point de vue sur son passé et surtout sur la période de ses origines. Le gros problème de l'historien est alors de ne pas laisser « l'histoire sainte » occuper le champ de la problématique historique. Il n'est pas toujours simple de résister à la pression ambiante et de ne pas traverser le miroir. Il faut alors se garder de trop de fascination pour son sujet. À défaut de cela, on finit par s'identifier à lui sans même s'en apercevoir. Un historien n'a pas de leçon à donner à un théologien, même s'il doit à l'évidence étudier son mode de pensée et sa doctrine. Bien entendu, il n'a pas non plus à recevoir de leçon de lui, en vertu d'un quelconque principe d'autorité qui interdirait de poser certaines questions.
Le point de vue que vous développez sur l'appréhension de l'islam avait-il déjà été expérimenté dans le milieu des orientalistes ?
L'orientalisme, dont les spécialistes du monde musulman médiéval sont les héritiers, naît à la fin du XVIIIe siècle. Il se développe durant tout le XIXe siècle et notamment dans les contextes coloniaux : les savants se rendent dans les pays qu'ils étudient et parfois même y vivent durablement. « Orientalisme » est un mot étrange qui ne fait référence à aucune discipline actuelle des sciences humaines. Il donne simplement une localisation vague que l'on pourrait presque qualifier de fantasmatique : l'Orient. Pourtant, les orientalistes du XIXe siècle furent des savants très sérieux qui travaillèrent directement sur les langues orientales pour elles-mêmes. Ces langues étaient certes connues auparavant, tout au moins pour les principales d'entre elles, mais dans des perspectives très étroites, telles que la diplomatie ou la controverse religieuse. Ainsi, les plus anciennes traductions du Coran en latin, à partir du XIIe siècle, s'inscrivent-elles dans la perspective d'une apologie du christianisme, pas du tout dans celle d'une connaissance de l'islam en temps que tel.
Le contact direct avec les pays d'Orient a complètement changé les données du problème. Les orientalistes ont commencé à travailler sur une immense littérature dans toutes les langues de l'Orient. En ce qui concerne le monde musulman, il fallait inventorier et « digérer » une masse documentaire d'une ampleur inouïe, nécessitant au moins la connaissance de trois langues, l'arabe, le persan et le turc !
Du point de vue des disciplines que l'on rattache aujourd'hui aux sciences humaines, il faut bien dire qu'il régnait un certain amateurisme. Chacun abordait l'Orient avec sa formation de départ, sans trop chercher à se poser des questions de méthode. Il y avait des philosophes, des historiens, des spécialistes de littérature, des grammairiens, de simples autodidactes et des esprits curieux. Il y avait aussi beaucoup de religieux. Il y eut ensuite de nombreux fonctionnaires coloniaux. Cette génération avait les vertus et les défauts de son époque. Elle cherchait d'une certaine façon à s'approprier l'Orient ou à le dominer.
Le fait d'étudier un monde étranger pour lui même est une méthode de recherche qui apparaît seulement au cours du XXe siècle, sous l'impulsion notamment des historiens des mentalités et des spécialistes des sciences dites sociales : ethnologues, sociologues, anthropologues… Il faut ajouter que les pionniers de cette nouvelle recherche ne travaillaient pas sur les mondes orientaux. Les historiens étudiaient alors surtout l'Antiquité grecque et romaine ainsi que l'Occident médiéval.
C'est pourquoi on peut ajouter que, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, les « études musulmanes » sont restées à la traîne dans le domaine de la nouvelle histoire. On en vient à se demander si l'islamologie, telle qu'elle est parfois encore pratiquée aujourd'hui, ne relève pas d'une forme de théologie qui s'ignorerait comme telle. Avouons cependant que la pression exercée par les écrits du passé qui semblent raconter l'histoire et par l'islam actuel est écrasante. Il y a de quoi y perdre son latin !
L'histoire événementielle est relativement mieux lotie. La politique et les guerres qui, pendant un millénaire et demi, opposèrent l'islam à Byzance, puis aux États européens comme l'Empire austro-hongrois, sont bien connues et étudiées, même si des progrès demeurent à faire. Quant à l'islam moderne, il est abordé depuis environ deux décennies par les sciences sociales et la politologie. Leur domaine d'étude concerne soit le monde arabe stricto sensu, soit différents pays musulmans comme l'Iran ou encore les pays d'immigration des populations d'origine musulmane. On saisit certes mieux les faits enregistrés par l'histoire événementielle que les comportements collectifs et les croyances relevant de l'intériorité d'une culture. Quant à la modernité, elle peut être étudiée sur le vif.
Le problème non réglé est celui des origines de la religion islamique et de sa construction culturelle et doctrinale durant ses premiers siècles d'existence. Comment l'islam est-il devenu ce qu'il est ?
Il y a aujourd'hui plus de deux siècles que la grande aventure scientifique a commencé, à peu près en même temps que le déchiffrement de la pierre de Rosette par Champollion. Les habitudes orientalistes héritées du passé constituent une base indispensable. Mais elles apparaissent aussi, du point de vue méthodologique, comme un obstacle qu'il faut dépasser. C'est ce que j'ai dû faire en ce qui concerne mon travail sur les origines de l'islam. La rupture fut d'autant plus brutale que cette période des origines de l'islam a été très peu soumise à la critique historique, sans doute parce que c'est là que la pression du religieux est la plus forte à tout point de vue.
J'espère ne choquer personne en disant que l'histoire s'inscrit dans un temps discontinu qui fait se succéder des situations singulières. S'agissant d'une religion ou d'une grande croyance collective, cela implique que la représentation que chaque époque se donne de son passé ne correspond pas forcément à une réalité historique vécue.
En ce qui concerne l'islam des origines, l'historien se trouve face à une situation bloquée par des évidences qu'il faut démonter une à une et tenter de replacer de façon hypothétique dans leur contexte. L'histoire de cette période demeure entièrement à écrire de ce point de vue. L'entreprise est d'autant plus difficile que, dans la société d'origine de l'islam, l'oralité l'emportait sur l'écriture. C'est seulement lorsque l'islam fut sorti de son milieu originel, à la faveur de la conquête du Proche et du Moyen-Orient, de l'Égypte, du Maghreb et du monde iranien, qu'il devint civilisation d'écriture, à la faveur aussi de la construction d'une société impériale complexe. Le mot « califat », qui a longtemps désigné les États musulmans de la période médiévale, ne doit pas faire illusion. Il s'agissait bel et bien d'un empire de type classique, qui n'avait rien de singulier du point de vue structurel par rapport, par exemple, à son homologue byzantin.
On dit souvent que l'islam fait partie des « religions du Livre ». Mais on ne se demande pas de quel « Livre » il s'agit et ce que signifie au juste le mot. Dans une société d'oralité, l'écrit n'est pas un livre que l'on feuillette, mais le Destin au sens de discours fixe ou de discours annonçant un avenir fixé. Ainsi l'islam comme religion du « Livre » ou plutôt de « l'écrit » serait d'abord une religion qui déclarerait s'être vue annoncer son destin. Ce n'est là que l'un des multiples paradoxes d'un discours sur le passé intoxiqué par les évidences qu'il a construites pour en faire sa réalité.
Pourriez-vous nous indiquer quelques exemples historiques ?
Ainsi en va-t-il également de certains rituels dont on s'imagine à tort qu'ils sont primitifs alors que c'est la pratique collective dominante qui a fini par les imposer. L'actuel sacrifice du mouton qui clôt le pèlerinage musulman est censé commémorer le sacrifice d'Abraham ; il correspond en fait à une pratique proche-orientale qui s'est vraisemblablement imposée seulement après la conversion des populations concernées. Les Arabes d'Arabie, en tant que grands pasteurs, sacrifiaient des chameaux ! Quant à la connexion abrahamique du sacrifice et du pèlerinage, elle est ignorée par le Coran.
Le pèlerinage primitif était vraisemblablement un rituel de demande de pluie qui avait lieu à période fixe, après le déclin des grandes chaleurs de l'été, dans la haute plaine de l'Arafât, à l'est du territoire mecquois ! Il aurait été pratiqué par les Bédouins. Il ne se serait d'ailleurs pas confondu avec le rituel célébré à La Mecque qui se déroulait quant à lui indépendamment, au printemps. Ce deuxième pèlerinage autour de la Ka'ba donnait lieu également à des sacrifices, mais ils avaient lieu sur place – ils ont aujourd'hui complètement disparu. C'est peu avant de mourir que Mahomet aurait regroupé les deux pèlerinages comme pour réunir – politiquement – sous une seule bannière les Bédouins, les gens des oasis et les caravaniers, toutes catégories de population qu'il dominait désormais. Le caractère saisonnier du rituel extérieur à La Mecque dont décidaient les seuls Bédouins se trouvait parallèlement aboli par un verset coranique.
Le fait que la tradition dite « prophétique », le hadith, corrobore la croyance postérieure qui « abrahamise » le sacrifice ne signifie rien pour un historien. Ce corpus réputé « prophétique » ne peut être mis sur le même plan que le Coran qui présente des indices d'ancienneté bien supérieurs. Lorsqu'il y a contradiction, c'est évidemment le Coran et son contexte d'origine qui l'emportent. De multiples exemples de ce type demeurent à élucider, à commencer par la mise par écrit du Coran, qui pourrait bien être beaucoup plus tardive que ce qu'annonce la tradition musulmane.
Quelles pourraient être les conséquences de vos travaux ?
On voit que le discours historique sur les débuts de l'islam n'est pas anodin. Il ne cherche pourtant aucunement à donner des leçons de religion. C'est aux communautés croyantes de gérer leur destin. Mais comme toutes les grandes religions, l'islam a une histoire réelle faite de développements, de ruptures et de fractures dont on n'aime guère à se souvenir, quitte à s'inventer, dans un certain nombre de cas, un passé de substitution. Pour moi, la tâche des historiens est d'investir le champ d'une histoire tout simplement humaine.
Posté Le : 16/04/2021
Posté par : patrimoinealgerie
Ecrit par : Jacqueline Chabbi Professeur à l’université Paris VIII-Saint-Denis
Source : clio.fr