
Le chant du lendemain d'Anne Leduc (Roman) - Éditions Bouchène, Paris/Alger, 2004
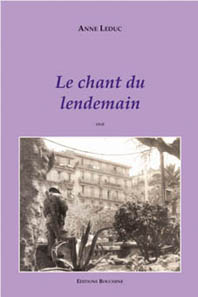
:
1962 : L'Algérie accède à l'indépendance dans la liesse, et dans l'espoir de lendemains qui chantent.
Un mois auparavant, Anne Lanta Leduc, étudiante en médecine, débarque à Alger par solidarité avec un peuple pour lequel elle a déjà payé le prix du sang, et dans le désir d'œuvrer, en sa qualité de médecin psychiatre, à la reconstruction d'une Algérie nouvelle.
Un récit qui permet de comprendre les cinq premières années de l'Algérie post-coloniale. Il mêle les pages de l'Histoire, celle d'un pays dans la mythologie révolutionnaire des années 60, à la chronique de sa vie de femme, dans ses aspects les plus ambigus : femme française, femme algérienne par le sang versé, femme épouse soumise malgré elle à la tyrannie d'un mari militant, femme émancipée et moderne, femme engagée aussi… ce texte est l'un des rares documents sur le quotidien des premières années de l'Algérie indépendante.
Dans son premier roman, Les Raisins rouges d'Algérie, paru sous le pseudonyme de Anna Berbera (Bouchene, 2000), elle se met en scène à travers le récit d'une jeune provinciale entraînée, au détour d'une manif sur la Paix en Algérie en 1957, à la solidarité, puis aux réseaux de soutien au FLN et, de plus en plus consciente de son engagement, à participer pleinement à la lutte des algériens.
Sa lecture du monde se fait à travers la révolte contre l'oppression d'une manière générale, et plus particulièrement la souffrance, la douleur, l'humiliation, la suppression de la liberté. Elle voit un parallèle entre les violences faites aux exclus de toutes sortes : les femmes qu'on maltraite, les militants qu'on torture, les colonisés qu'on exploite, les malades qu'on traite comme des objets.
Et c'est tout naturellement qu'à la fin des « événements », son histoire se mêlera à l'Histoire et qu'elle prendra avec d'autres le chemin de ce pays qui accouche dans la douleur, pays pour lequel elle paiera le prix du sang. Là elle fera souche avec Rachid, un « héros fatigué », laissant à leurs enfants comme à tous ceux de cette génération le legs d'une paix amère de raisins verts.
Préface
En lisant ce livre [1], le lecteur voit se dessiner le destin d’une rebelle. Rebelle contre sa famille, rebelle contre un ordre colonial sans doute entrevu dans le même registre d’émotions que l’ordre familial. Anne Leduc a été de celles - communistes marginales et rebelles - qui ont milité dans le soutien au FLN en France pendant la guerre algéro-française de 1954-1962 [2]. Comme pour nombre de ces « porteurs d’espoir », son engagement fut émotionnel et moral autant que politique, voire avant même que d’être politique.
Anne Leduc aborde la terre d’Algérie dans les semaines qui précédent l’indépendance, dans le cadre de cette ZAA (Zone Autonome d’Alger), du même nom que celle de 1957, mais reconstituée par le haut par le GPRA, et dirigée par le très contesté commandant Azzedine [3]. Le 22 juin 1962, elle y est victime d’un attentat commandité par la rivale de la ZAA, la wilâya 4 (celle de l’Algérois), dirigée par le colonel Hassan (Youssef Khatib), un des promoteurs les plus impitoyables des purges dans sa wilâya depuis 1959. Grièvement blessée, elle en garde de graves séquelles et elle perd pour presque un an l’usage de son bras droit.
L’attentat marque symboliquement ce qui est dès lors au cœur de sa vie : Anne Leduc est rattrapée par des données inattendues qui n’étaient pas inscrites dans son plan de libération. Luttant pour la libération de l’Algérie, elle est atteinte gravement, non par l’ennemi colonial, non par l’OAS qui opère alors ses ravages, mais par les balles perdues de l’affrontement entre cliques armées en lutte pour le pouvoir.
Non sans des résistances autant désespérées que vaines, elle se lance dans un mariage quasi forcé avec Omar, un beau combattant, qui tient le langage et la posture du pur révolutionnaire tout en peinant à lire Marx. L’appartenance d’Omar au PRS [4] de Mohammed Boudiaf, et pour cela son emprisonnent passager assorti de mauvais traitements, ne l’empêchèrent au demeurant pas d’être finalement sous Boumediene normalisé en fonctionnaire ordinaire, mais bénéficiaire de tel ou tel passe-droit - un passeport diplomatique par exemple.
Anne est battue ; elle doit supporter les humiliations d’un ménage à trois imposé ouvertement sans vergogne ; faire face à la suspicion violente de son Othello de mari ; déjouer l’action par lui intentée l’accusant d’abandon d’enfant. Elle doit supporter les vexations de son beau-frère Hicham, qui la honnit parce qu’il rejette en elle la qawriyya malfaisante... Ceci dit, Omar ne fut pas incapable de sentiments et d’attentions. Bref, une atmosphère de paranoia où la projection sur des tiers, prenant la place du retour du refoulé, constitue la norme épuisante de nombre de comportements.
Anne Leduc nous livre le portrait sans complaisance - mais sans acrimonie - d’une société où la surveillance mutuelle est un devoir communautaire/patriotique ; où la police traque les couples non mariés ; où le respect du Ramadan devient plus un signe de soumission à un ordre collectif réactionnaire que l’authentique et modeste acte de foi qu’il a dans la plus belle tradition musulmane ; où l’individualisme incivique peut servir de contrepoids à l’épaisse surveillance sacro-sociale, mais aussi fournir les voies de l’ascension vers le pouvoir. Le texte d’Anne Leduc est aussi une belle illustration de cette schizophrénie portée par les alluvions du rapport colonial telle que l’a décryptée Albert Memmi dans une analyse désormais classique [5].
Anne est aussi rattrapée par les admonestations imprévues, sous le signe du moralisme familial, de son ancienne compagne de luttes M. G., qu’elle dépeint transformée en censeur des mœurs. Il est vrai que, sur ce chapitre, l’historien ne peut plus recueillir le son de cloche de M. G., trop tôt disparue, pas plus que celui de son compagnon A. B., lui aussi décédé.
Mais Anne elle-même s’était identifiée à l’objet de son engagement originel, jusque dans l’introjection de tel tabou largement préislamique (l’interdit sur l’ingestion de viande de porc), mais non des prescriptions plus authentiquement musulmanes sur la consommation d’alcool (par bravade, elle boit ostensiblement une coupe de champagne en fixant le réputé austère colonel Boumediene). Ce faisant, elle se conforme à la norme algéro-musulmane, beaucoup plus sensible à tels tabous remontant peut-être bien au Néolithique - ainsi que l’a bien montré, pour le voile, Germaine Tillion [6]- qu’à tels enseignements empreints de hauteur de vue de la théologie musulmane.
Anne Leduc nous fait percevoir que ce que l’on dénomme vulgairement islam en Algérie est surtout une norme sociale, se révélant dans la sourcilleuse surveillance mutuelle communautaire.
L’itinéraire d’Anne Leduc, à l’image de tout itinéraire humain, se fait sous le signe de l’ambivalence, voire de la contradiction. Le contexte socio-politique algérien se déroulait, il est vrai, passablement sous le signe de la contradiction entre le révolutionnarisme et la technophilie officiellement proclamés, d’une part, et l’obscurantisme d’État réellement promu par le pouvoir d’autre part. Pour Anne, il y a contraste entre la vie dure de 1962-1963, - les précaires meubles de camping, le HLM minable sans ascenseur, le salaire non versé pendant les dix premiers mois, les pénuries omniprésentes - et l’aisance relative, ensuite, de sa condition de coopérante : bien qu’Algérienne de nationalité, elle peina à être considérée comme pleinement Algérienne et bénéficia d’un statut de coopérante.
Et cette rebelle originelle assiste à telle réception où se presse la nomenklatura - y figurent trois femmes pour cent hommes : c’est là exactement le pourcentage des femmes inscrites au très officiel fichier des mujâhidât, rapporté au nombre des hommes inscrits au non moins officiel fichier des mujâhidûn.
Pour Anne Leduc, l’Algérie fut sa patrie d’adoption car elle fut sa patrie de lutte. Même les voyages qu’elle entreprend périodiquement à Paris, à Genève, dans sa Bretagne natale, lui signifient que sa place est en Algérie. Mais en même temps, ces voyages fonctionnent comme une soupape la soulageant par intermittence de ce qui est, aussi, l’étouffoir algérien. Tout cela pour, finalement, sur fond du divorce de son couple, réintégrer la France au bout d’un peu moins de sept ans. Sept ans au terme desquels Anne avoue n’avoir jamais réussi à maîtriser l’arabe. Qu’elle se rassure : c’est là le lot de la plupart des Français ayant vécu à cette époque en Algérie.
à vrai dire, les conditions exceptionnelles de l’engagement originel ne préfigurent pas la vie normalisée ultérieure ; elles ne survivent pas au retour à la normale. Reprennent vite le dessus, chez ses compagnons algériens de lutte et de travail, le chauvinisme inquiet, la méfiance à l’égard de l’autre irréductible, probablement la mémoire inconsciente de la césure des croisades (l’historien algérien Ahmed Tawfiq al-Madani n’appelait-il pas la conquête coloniale al ghazû l isti‘mâr ul salibiyy : la conquête du colonialisme croisé ?), et souvent l’arrogance de la supériorité proclamée.
Cette arrogance n’est, à vrai dire, que le signe et le contrepoids de l’auto-dévalorisation, ou tout au moins de l’inquiétude éprouvée à l’endroit de soi-même. Tout cela sur fond d’exclusivisme communautaire refusant aux autres d’apprécier et d’analyser un pré-carré algéro-algérien entretenu comme un trésor jaloux. Mais, avec justice, Anne rend aussi hommage à tous ces militants dévoués et fidèles en amitié qui lui viennent en aide aux heures sombres.
Anne Leduc nous offre aussi un témoignage précieux sur la vie politique algérienne et sur le pouvoir : le discours révolutionnariste de l’époque, les sinuosités de caméléon politique de Ben Bella, les pratiques sordides de pouvoir où, structurellement, le militaire finit par avoir le dernier mot, la torture, couramment pratiquée - ce fut là un des legs coloniaux les plus pieusement conservés -, la démagogie populiste, mais aussi la bureaucratisation de l’autogestion, les rapports d’allégeance et les passe-droits, la mainmise sur l’UGTA en 1963, puis la répression musclée à l’automne 1967 contre le mouvement étudiant sous le signe du slogan « halte à l’immixtion étrangère » (vu comme marxiste en l’occurence) : c’était déjà, sans le nom, la dénonciation du hizb fransa.
Mais, en même temps, elle évoque le réel intérêt pour les œuvres sociales, les campagnes d’alphabétisation et de reboisement, le sentiment de solidarité authentique avec le Tiers Monde, le climat d’euphorie exaltant qui fut, c’est vrai, celui des lendemains de l’indépendance. Le livre note aussi ces coopérants - il y en eut de valeureux, mais il y en eut aussi d’incompétents et d’arrogants -, tels de ses collègues algériens modestes, dévoués, sérieux et acharnés au travail, mais aussi les arrivistes, les hommes avides de pouvoir et les dénonciateurs. C’est le petit personnel, celui des infirmiers, qui, dans son texte, détient peut-être la palme du mérite.
Ce qui fait vivre Anne, c’est notamment son métier de médecin psychiatre, d’abord au centre de Drid Hocine, rattaché au CHU de Mustapha, puis au centre médical de Belcourt de la Casoral -la caisse de sécurité sociale d’Alger. Anne est médecin, elle est experte en psychiatrie, elle enseigne, aussi - son évocation de tel examen de rattrapage réservé aux anciens junud ne manque de relief : lesdits junud posèrent ostensiblement sur la table de composition leur matériel antisèche et... leur arme.
Elle évoque avec justesse et retenue, dans un récit qui rappelle celui des beaux Souvenirs algériens de son collègue chirurgien Michel Martini, lui aussi très tôt engagé dans le FLN, le cas émouvant de Abdel, le jeune psychotique, les malentendus sur la perception des fous - le majnûn est littéralement celui qui est habité par les djinns -, et ces patients agressifs qu’elle doit affronter, et plus largement toute la sédimentation souffrante de la mémoire traumatique de guerre et de la violence coloniale, entremêlés inextricablement avec les tabous de la société, si souvent douloureusement inscrits dans l’affectivité et la sexualité des humains.
L’inconscient, c’est le corps : Anne, devenue psychanalyste, en sait quelque chose. à lutter au quotidien pour, dans les embûches et les horions, élever ses deux filles, à la ténacité de vouloir s’en sortir par elle-même, à devoir divorcer dans le conflit aigu, elle connaît de graves accidents de santé, redevables notamment à la somatisation de sa vie dure.
Au total, Anne Leduc nous fait entrevoir un destin personnel, marqué certes par l’ambivalence et la contradiction, mais aussi elle écrit avec une émotion vraie, et ce qu’elle exprime n’est pas sans grandeur. Sa fébrilité inquiète et la détermination de son combat de femme sont la signe de la vie même. Tout cela un temps confondu avec le destin d’un peuple souffrant, et dont le traumatisme n’a pas fini de rejouer dans l’histoire immédiate, mais porteur aussi de virtualités et de promesses à valoir pour la prospective.
Posté Le : 31/01/2004
Posté par : nassima-v
Source : www.dzlit.free.fr