
Ali El Kenz : l’ami
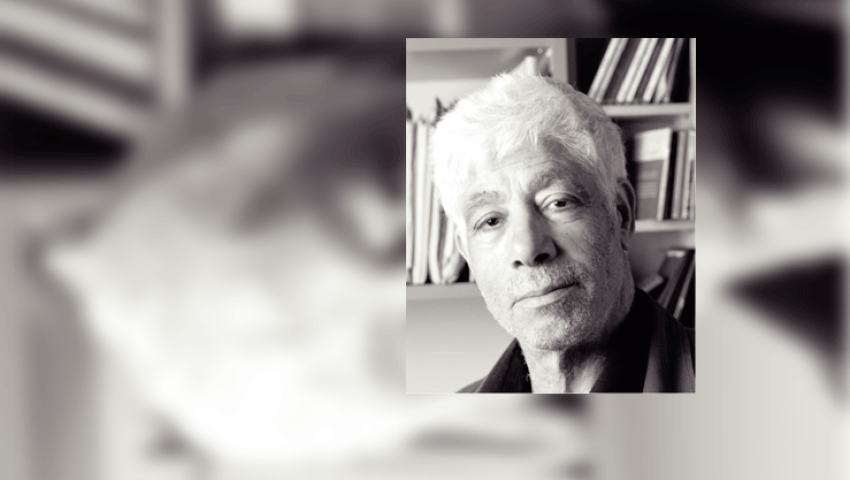
Par Kennouche Tayeb, sociologue
«La valeur des choses n’est pas dans la durée mais dans l’intensité où elles arrivent. C’est pour cela qu’il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables.»
(Fernando Pessoa)
Il est des absences qui nous rendent plus présents à nous-mêmes. Quand ces absences cessent, avec le temps, de nous faire moins mal en s’arrêtant de saigner, elles finiront par laisser sur notre cœur une belle cicatrice. Nous sommes présents au monde avec toutes ces absences qui, fidèles, nous accompagnent comme notre propre ombre. L’absence d’Ali El Kenz, depuis, déjà, trois années, restera, sûrement, pour beaucoup, une présence impérissable non parce qu’il a choisi un 1er novembre, un jour mémorable, pour partir mais parce qu’il était, également, pour tous d’un rapport agréable.
C’était, généralement, en français, «la langue marâtre», dirait Assia Djebar, que se déroulaient, habituellement, mes échanges avec lui. Brefs ou longs, ils étaient toujours plaisants. Mais, quand, le plaisir le prenait de vous parler dans «sa langue», vous cessez d’être, pour lui, un collègue et lui devenait «Aliouet» l’ami. L’ami de tous les jours. L’ami de toujours.
Ses mots, où sont restées perlées de joyeuses clameurs d’enfants jouant, insouciants, à la cité Tahar-Benhouria où il est né, se transformaient dans sa bouche en un beau coquillage de plage d’où pouvait s’entendre le frais murmure des vagues d’une mer, par tous les temps, radieuse à Skikda. À la manière d’un escargot, Ali El Kenz a dû emporter, partout, sur son dos cet accent qu’il n’a, jamais, cessé d’habiter comme un pays, comme une maison, comme une adresse. Malgré une longue vie algéroise, cet accent s’est conservé intact dans son jus. Il disait tout d’Ali El Kenz qui était resté inoxydable dans sa façon d’être. Il avait, au quotidien, le souci d’arborer une élégante sobriété autant dans sa langue que dans sa tenue.
C’est en tant qu’enseignants à l’université d’Alger et chercheurs au Cread que notre amitié a pris le temps de naître et de se développer sans familiarité mais, teintée, cependant, de beaucoup d’allégresse.
Tout au long de ces années où nous avons travaillé dans le même espace et évolué, souvent, dans le même groupe, cette amitié se tissait, agréablement solide, au gré de cheminements communs, de projets partagés, d’entretiens intellectuels et humains complémentaires. Elle se nourrissait de connivences et de complicités. Au rythme des jours nombreux qui défilaient, s’est installée, comme une habitude, comme un rite qui nous amusait comme de vrais adolescents et que nous reproduisions, chaque fois, à l’identique.
Etant son cadet, il me plaisait, toujours, d’être le premier à l’aborder par un audible et chaleureux «Bonjour Si Ali» et d'enchaîner, sans pause, «j’espère que tu n’as pas oublié que tu dois, comme dans le film l’Opium et le Bâton, mourir debout». Ce à quoi, avec son large sourire qui lui prenait tout le visage pour faire briller toute la pétillance de son regard, il me répondait, toujours taquin, «je souhaite, ce jour-là, que mes jambes puissent porter le poids de mon corps qui s’enrobe».
Ainsi, il nous arrivait de jouer, de manière en somme puérile, à l’idée de la mort dont on ne s’habitue jamais. Pourtant, très coutumière, dans notre existence, nous la considérons comme un scandale quand elle emporte celles et ceux que nous aimons, celles et ceux que nous apprécions.
C’est toujours avec la malice teigneuse d’une très jeune fille qui, jamais, ne se tient tranquille à sa place, que chaque fois, elle vient nous surprendre comme si, pour la première fois, elle nous endeuillait.
À quoi bon avoir choisi de raconter, aujourd’hui, cette anecdote ? Sinon, pour rendre à nouveau présent notre ami Ali El Kenz. Pour sauter par-dessus toutes ces dernières années où nous ne nous sommes plus croisés. Pour les effacer, les gommer et le ressusciter ne serait-ce que pour le temps d’un flash ou d’une fulgurante apparition tel qu’il a été et tel qu’il le restera dans ma mémoire pas encore défaillante. Je garde de ces instants fugaces, passés avec lui, le souvenir de moments parfaits que j’avais crus, naïvement, éternels.
Je n’ai pas cherché à savoir comment notre ami est mort. Je suis certain, cependant, qu’Ali est parti debout et bien droit, dans ses principes comme dans ses convictions. Il ne pouvait s’en aller autrement qu’avec la lucidité d’un homme qui a toujours choisi d’être libre, d’être indépendant. Une liberté qui s’est exprimée éloquente par la construction d’une vie féconde et active qui n’avait, absolument, rien à voir avec une paire de pantoufles usées, une robe de chambre fripée et une tasse de tisane au thym posée fumante sur une table de chevet. Je pourrais raconter, comme le ferait, aisément, chacun de ses nombreux amis, mille et une autres anecdotes pour dire combien se dégageait d’Ali El Kenz un puissant magnétisme qui vous colle à sa bonhommie et qui vous adopte.
Mais, j’ai surtout envie de dire tout le plaisir que je prenais à le lire dans ses différents travaux au point où je peux, sans risque, de me tromper, reconnaître son écriture à sa parfaite concision, au sérieux de son humour, à ses colères souriantes qui animent, parfois, ses phrases et qui, souvent, les déborde par le parti féroce qu’il y prenait pour se ranger du côté des opprimés. Il avait, en effet, un cœur bien à gauche pour garder en équilibre un esprit résolument droit. Il pouvait, en effet, avoir la dent dure dans cette tendre écriture mais jamais il ne s’est autorisé, un jour, à abaisser l’Autre à l’égard duquel il ne se départait, jamais, de l’inaltérable respect qu’il pouvait avoir pour les autres. Humaniste et relativiste, il l’a été dans son quotidien comme dans son rapport à autrui qui ne conservera de lui que sa manière de dire les choses avec une neutralité, toujours réflexive, qui ne l’avait pas empêché de «vivre, constamment, en partisan» pour parler comme Friedrich Hebbel. Une neutralité réflexive qui, chaque fois, l’engage à garder les yeux bien ouverts pour éviter que les préjugés et les jugements de valeur ne les fassent cligner.
Il avait la patience de l’érudit, qui lui faisait éviter la facilité de prendre des raccourcis pour atteindre les connaissances qu’il cherchait à acquérir sur les questions qu’il abordait. Ses travaux, que certains de ses amis et de ses collègues ont brillamment commentés dans les hommages mérités qui lui furent, déjà, rendus, témoignent, en effet, de la forte énergie intellectuelle qui émanait de lui. Cette énergie traduit l’esprit qu’il avait bouillonnant, à tout moment, pour exprimer ses idées de manière froide et claire. C’est parce qu’il se voulait intégral, à tout instant, qu’il faisait porter son écriture comme un gant à sa pensée qui, à l’égard des postures «moutonnières», était d’une radicale intolérance. Ali El Kenz avait le courage d’une pensée solitaire. Il a appartenu à une époque bénie où l’intellectuel n’avait pas encore appris à se mettre dans la tête une paire de ciseaux ou à se cacher derrière son stylo.
Lecteur assidu de ses travaux, je me délecte, encore, de son écriture coulant épurée au fil de sa plume que, sûrement, il ne devait pas prendre la peine de relire. Est-ce, peut-être, pour cette raison qu’en le lisant, j’éprouve l’agréable sensation d’entendre sa voix chuchoter dans les mots qu’il avait l’art de sculpter telles les statues romaines de Russicada pour laisser, sur leur marbre, indélébiles ses idées ? Est-ce pour éviter que la mémoire ne se perde dans l’amnésie, qu’Ali usait de cette dextérité d’enfiler les mots pour tisser le fil d’Ariane qui le maintenait même dans l’Ailleurs rattaché à son pays ? Est-ce pour empêcher la mémoire de s’égarer dans les labyrinthes de l’oubli, qu’il avait tenu dans ses écrits à emboîter les mots pour reconstruire dans cet «Ailleurs» les «mondes» qu’il a habités ici ?
Je n’ai point trouvé dans cette écriture la voix exilée d’un pays qu’Ali aurait perdu. Avait-il trouvé, seulement, dans cet Ailleurs, d’autres mots pour dire d’autres silences différents, de ceux qu’il avait l’habitude d’écouter ici ? Devait-il les apprivoiser ? Les avaler, pour les apprendre car la langue avait besoin de les connaître dans leur goût ? C’est de cette façon qu’il devait s’assurer de leur saveur avant de s’en servir pour se dévoiler dans ces Écrits d’exil où comme un don de soi, il se donne au lecteur en confession.
C’est pourquoi, je n’ai point aimé ce titre Écrits d’exil donné à un de ses ouvrages où se fait, au contraire, entendre la voix intérieure d’un pays qui jamais ne fut quitté. Un ouvrage dans lequel Ali El Kenz charge les mots de retisser les fils de la trame de sa vie qui se seraient distendus. C’est, parce que je considère que nous avons, tous, en nous, fécondes les graines d’une certaine forme de déracinement que l’exil ne trouve pas toujours dans l’éloignement une condition nécessaire pour naître ou pour se manifester.
L’exil ? Nous pouvons le vivre même en restant chez nous, quand nous submerge le sentiment inconfortable que le monde que nous portons en nous s’est délogé, bien malgré nous, pour être quelque part. Un monde qui nous quitte parce qu’il n’est plus tout à fait le même. Parce qu’il n’est plus tout à fait là. Je ne vois pas Ali, mon ami, avoir emporté son pays à la manière d’une trousse de toilette, de quatre paires de chaussettes ou de quelques chemises et pantalons, hâtivement glissés dans une valise en carton. C’est dans la tête qu’il l’avait pris, entier, avec lui.
Il ne l’avait pas emporté «collé au talon de ses souliers». Son pays est resté une évidence qu’aucun exil ne pouvait défaire. C’était, depuis toujours, son compagnon de route. C’était son double et c’est ainsi, qu’ensemble, ils sont partis se réfugier dans des contrées qui ne furent pour eux que d’occasionnels abris. Je me souviens qu’Ali m’avait appris un proverbe, bien malicieux, qu’il devait avoir ramené, un jour, de ses multiples voyages africains. Ce proverbe disait que «toute route doit se faire à deux : l’un voit les cornes et l’autre l’antilope».
Devoir fuir son pays pour protéger sa vie menacée par la folie meurtrière qui nous a privés de tant d’artistes et d’universitaires prestigieux dont «le talent est un malheur suicidaire chez nous», écrivait Yasmina Khadra dans son roman Les chants cannibales. Devoir, à un âge, relativement, avancé, se mettre à chercher un toit, un travail et une fin de vie ailleurs, ce n’était point le destin qu’il entrevoyait paisible et ordinaire chez lui. Ali El Kenz a vu se fracturer le cours de son existence. Mais sans tomber dans le spleen de l’exil ou dans la mélancolie crépusculaire qu’El Ghorba se plaît, quelques fois, à diffuser, il a vécu, alerte et agile, comme un fugitif portant dans son âme la fêlure d’une vie réparée. C’est parce qu’il fut, un jour, par l’histoire, détourné, comme un fleuve de son lit, qu’il a su en creuser un autre pour continuer d’irriguer les belles racines qui lui avaient permis de se développer et de s’épanouir.
Il arrive que dans l’exil, s’additionnent, dans un hasard organisé, des pérégrinations obligées qui peuvent donner à la vie des individus un parcours improbable ou encore aléatoire. Mais, s’il est bien accueilli, cet exil est en mesure d’offrir, aussi, une heureuse opportunité d’enrichissement dès l’instant où il rend possible une existence nouvelle où, sans peine, s’apprend un humanisme sans frontières. Une situation inédite qui, comme un berceau, permet d’accueillir une autre naissance non attendue d’où pourraient sortir les «premiers hommes», dirait Albert Camus. Mais pour cela, les yeux, le cœur et l’esprit doivent savoir rester ouverts. Ceux d’Ali l’étaient déjà, suffisamment, pour qu’il se sente, partout, à l’étroit et veille à conserver, toujours, ouverte une porte en lui. Il a toujours su que c’est par cette ouverture que s’aère et se rafraîchit toute identité claustrophobe qui redoute d’être cloîtrée, emmurée ou emprisonnée. C’est par l’apport d’un air nouveau qu’elle respire à pleins poumons, qu’elle se vivifie et se «créolise» en se drapant de toutes les belles couleurs de l’humain qui lui éviteront de sentir le renfermé, le rance et le moisi.
L’exil n’est donc pas, toujours, une fatalité malheureuse. Bien souvent, il mérite, au contraire, le voyage comme celui qui a conduit Ali El Kenz loin de son pays, en lui faisant connaître à quoi aurait pu ressembler l’itinéraire, avant lui, emprunté par certains grands «exilés» que furent Edward Saïd, Milan Gundera, Maurice Halbwachs, Lévi-Strauss, Celso Furtado et tant d’autres encore. Ceux ou celles qui ont dû, un jour, partir pour trouver un lieu où s’inscrire. Ceux ou celles qui, dans des marches à l’allure, souvent, pèlerine, savaient qu’il a, toujours, existé, quelque part, des endroits qui semblent attendre l’excommunié, le persécuté et le marginal.
Au cœur de l’arrachement ou du déchirement que provoquerait tout exil peut, alors, jaillir, dans une sorte de revanche inespérée, une source claire qui apporte à l’enracinement suspendu ou contrarié, une sève qui le nourrit et le restaure. À cette source Ali El Kenz avait étanché la soif qu’il pouvait avoir de son pays. C’est pourquoi l’exil ne l’avait pas réduit au silence. Ses écrits ont cette formidable prouesse de le faire à tout moment revenir chez lui. C’est par ses écrits, qu’à tout instant, il se rapatrie.
Les mots lui sont restés fidèles pour tout l’amour qu’il avait pour eux. Ils lui faisaient retrouver intact sur les lèvres le goût qu’il avait d’un pays dont il ne s’était jamais dessaisi. D’un pays dont il ne s’était jamais appauvri. Ses mots ont conservé, écarlate, la lumière d’un soleil méditerranéen, suave, le parfum des soirs d’été qui s’enivrent de Mesk El Lil et, diaphane, la couleur bleue d’un ciel qui fait belle la mer. Une mer qui, jamais, ne se lasse de déposer sur le sable des plages de son enfance l’écume laiteuse de ses caresses ondines. Des «écrits d’exil» où les mots furent, en somme, des tours de magie où Ali, notre ami, pouvait à chaque page se retrouver revenu chez lui.
C’est parce que chacun de nous est unique et multiple à la fois, qu’il peut se réclamer d’un lieu qui ne serait pas, forcément, celui de sa patrie. Nous avons, très souvent, en nous la douceur d’un sentiment profond qui nous fait plus de notre enfance que de notre pays. C’est dire que nous ne trouvons pas construit ce lieu d’où nous pouvons être. C’est un lieu qui s’édifie sans mur. C’est un endroit qui s’élève sans clôture. C’est un refuge, toujours, ouvert pour que l’Autre puisse, à tout moment, sans frapper à sa porte, trouver une fraternelle hospitalité.
Ce lieu est fait par la faim que nous avons de cet Autre quand il arrive à la différence d’être considérée comme une menace ou une agression qui doit, à tout prix, être traquée ou combattue ou quand elle est tenue pour être une maladie honteuse ou contagieuse de laquelle il faut s’éloigner ou se protéger. Est-ce raisonnable, en effet, de vouloir que l’Autre s’oblige à nous ressembler, alors, que, très souvent, nous sommes, nous-mêmes, dans l’ignorance de ce que nous sommes vraiment ? Ce lieu est, également, fait par l’amour de l’inattendu quand il arrive à une existence d’être, tout entière, sommée de suivre, au pas cadencé, un chemin fléché. Je suis convaincu qu’Ali, mon ami, avait, toujours, habité ce lieu qui est un espace sans géographie particulière où l’on cesse, comme le souhaitait Edouard Glissant, de n’avoir «qu’un frôlement d’ombre» avec son prochain.
Voila pourquoi, conduit, un jour, à sauter par-dessus les frontières de son pays. Ali El Kenz était, bien loin, d’avoir sauté, à pieds joints, dans l’exil. Il n’a pas bougé de chez lui en restant dans ce lieu qu’il avait construit à la dimension de son humanisme. C’était dans ce lieu où il avait appris à abandonner l’Avoir pour la promotion de l’Être. C’était là, où il avait combattu le sens commun qui pour Gramsci est «un terrible négrier des esprits». Ali El Kenz ne fut guère l’homme d’une langue, d’une idéologie, d’un pays. C’était l’homme d’une perspective. C’était l’homme d’un horizon, d’un devenir qui ne pouvait être atteint que par une pensée libre et, à tout moment, vigilante pour déjouer les pièges qui lui sont, continuellement, tendus pour être capturée et domestiquée.
En s’en allant, Ali El Kenz a emporté avec lui un bout de nous-mêmes. Avec sa disparition, c’est un morceau de notre monde qui vient de nous être enlevé. Nous pouvons nous consoler de son absence comme celle de nos intellectuels partis avant et après lui, mais nullement de l’avenir qu’ils ont tellement espéré pour leur pays et qui, de leur vivant, n’est point, hélas, advenu.
Avons-nous ressenti combien nous affecte la mort de nos collègues et amis universitaires ? Combien leur disparition nous ramène à l’absence que nous avons de nous-mêmes ? N’avons-nous pas, quelquefois, éprouvé ne serait-ce qu’un frémissement ou un soupçon de languissement qui nous vient de l’incompréhensible isolement qui n’a pas cessé de nous éloigner les uns des autres ?
Suffit-il à ce bruissement de languissement pour que l’on se réveille de toutes nos torpeurs et que se renouent les fils de la permanence cassés qui nous feront revenir de notre vacance ? Je trouve, aujourd’hui, Martin Heidegger bien dépourvu de toute forme d’émotion quand il déclare dans son ouvrage Être et temps que «la mort d’autrui n’a rien à nous apprendre». Je lui préfère Emmanuel Levinas pour qui, au contraire, cette mort représente dans son livre Entre-nous. Essais sur le penser à l’autre, un événement fondateur.
La mort de nos intellectuels est un moment de grande douleur. Un moment très important qui nous interpelle sur l’état dans lequel peut se trouver, chez nous, à l’heure actuelle, autant l’université que l’intellectuel et sa société. Je serais bien triste, encore, d’apprendre qu’Ali, notre ami, n’aura existé que pour ceux qui ont trouvé dans l’âge, la profession ou la proximité d’heureuses occasions pour l’approcher ou pour le connaître. Je serais bien davantage, amèrement, affecté de savoir qu’il a cessé d’exister à l’université bien avant même qu’il nous quitte.
Tout semble indiqué, aujourd’hui, que très peu d'universitaires sont intellectuellement pétris de l’âme de leur société. Sinon, tout le reste donne l’air de se vautrer dans l’ignorance de ses pulsions comme de ses «convulsions originelles» dont parle Frantz Fanon dans son ouvrage Les damnés de la terre. De tels universitaires semblent se complaire dans la méconnaissance qu’ils ont des romanciers de leur société, de ses poètes, de ses conteurs, de ses chansonniers, de ses hommes de théâtre, de ses peintres, de ses philosophes, de ses historiens, de ses linguistes comme de ses sociologues aussi.
C’est quand la langue se détache de la littérature comme de la philosophie qu’elle se décharne, se dessèche, décline et meurt. Mais, quand il arrive à une discipline des sciences sociales comme la sociologie de se mettre dans l’oubli de ses propres langages, elle perd, tout simplement, sa fonction de dire la société ou sinon que par d’incompréhensibles balbutiements. Mus par ces deux handicaps majeurs, des fournées entières de doctorants et de doctorantes se «bricolent», depuis quelque temps, pour les besoins de leurs travaux de recherche en sociologie, des visions de société qui finissent par les rendre aveugles sur la réalité de ses pulsations. Alors ? Combien de fois, en tant qu’enseignants, avons-nous, péché à l’université contre la sociologie ? N’ayant crainte de confesser nos fautes commises dans l’exercice de notre métier. Il nous sera beaucoup pardonné car la société s’allégera de l’illusion de se croire être, réellement, questionnée à l’université.
Dans un état pareil, comment de tels universitaires pourraient-ils se sentir ‘’poreux à tous les souffles du monde ?’’ se demanderait, très inquiet, Aimé Césaire. Ali El Kenz n’avait pas tort d’affirmer, dans l’entretien, recueilli par Nadia Taibi, qu’il avait donné en 2010 à Sens-Dessous que «ce qui est intéressant, c’est cette notion de métier dans un pays comme l’Algérie où il n’y a plus de métier. Vous savez, je suis universitaire, j’ai enseigné trente ans à l’Université d’Alger : le prof n’est plus prof, l’étudiant n’est plus étudiant. Tout est «salopé».
Mais de l’aveu de certains de ses anciens étudiants comme de ses anciennes étudiantes, il fut un véritable «maître-penseur». Il se distinguait par l’aisance qu’il avait de capter l’attention de son public estudiantin mais surtout de savoir la retenir intéressée tout le temps que durait son cours. Il ne se donnait pas pour objectif pédagogique principal de faire gagner l’assistance à ses idées mais cherchait avec un réel souci que s’érigeât à l’université un véritable espace de dissension dans la collaboration.
Ces étudiants ne rataient aucun de ses cours qu’ils considéraient comme de véritables séances de thérapie qui les faisaient grandir en donnant une force à leur puissance d’exister. Ils éprouvaient une merveilleuse sensation que durant ces cours, qui se passaient dans des amphis sombres et froids, se levait, chaque fois, un lourd rideau qui empêchait la lumière d’y entrer.
Certains d’entre eux affirment se souvenir, encore, qu’il aimait leur répéter une citation où Theodor Adorno avance l’idée que «le penser s’apprend aussi à penser contre soi-même». Sans nul doute, les cours d’Ali El Kenz, professeur de sociologie, furent pour ses étudiants une invitation ouverte à «échanger la confiance… contre de la confiance», «le respect… contre du respect», «la pensée… contre de la pensée comme pouvait le croire un Marx, idéaliste, dans les manuscrits de 1844.
Ali El Kenz incarnait la conscience alerte et vive des sociologues ou encore, selon un bon mot de Mustapha Lacheraf, il fut un «veilleur à la haute tour». Mais, le sérieux et la rigueur qu’il avait, pour quelque temps, précieusement apportés au département de sociologie, en tant que président de son conseil scientifique, allaient, très vite, être remplacés, dès son départ, par la curie et l’incurie. Avec le temps des «lumières» révolu, ce département n’allait plus s’arrêter, chaque jour davantage, de sombrer dans la nuit. Même si, malgré tout, continuent, encore aujourd’hui, de flotter, comme des épaves, sur les eaux de son naufrage, quelques rares étoiles encore scintillantes.
Ali El Kenz était et reste à mes yeux la quintessence de l’intellectuel algérien. Normalien de formation et d’abord philosophe de profession, il s’est servi avec brio du regard «éloigné» de la sociologie pour questionner du plus proche possible les réalités sociales qui l’inquiétaient. C’est grâce à son apport et à celui des personnes aussi généreuses que lui que nous continuons de vivre des aubes d’intelligence et de belles éclaircies dans les sombres journées que vit l’université où la pensée se ramollit à l’image des montres molles de Salvador Dali.
C’est, en effet, grâce aux souvenirs que nous avons conservés intacts de ces individualités enseignantes que nous éprouvons le sentiment réconfortant que nous ne sommes pas tout à fait esseulés dans les foules qui se forment, toujours plus compactes et volumineuses, à l’université où notre solitude devenait lourde à être portée. Que leurs écrits comme leurs pensées nous accompagnent et nous relient dans une chaîne qui, même très courte, encore aujourd’hui, est en mesure de nous enrichir par le seul fait de nous faire réfléchir autant sur nous-mêmes que sur l’Autre et sur le monde duquel nous sommes en passe de nous déconnecter. Un monde que nous avons l’air de vivre à contretemps ou à contre-courant parce que, rarement, nous nous sommes souciés d’être en résonance harmonieuse avec lui.
Il appartient aux étudiants comme aux enseignants de sociologie de se considérer comme les héritiers légitimes de ce patrimoine qui, tout particulièrement, leur revient. C’est ainsi qu’ils feront éviter à leur université de tomber dans des trous de mémoires dont elle est, aujourd’hui, pavée. De protéger de l’oubli ce legs important pour l’esprit et comme dirait Aicha Kassoul dans son roman La colombe de Kant «pour donner une vie aux morts ; afin qu’ils continuent de nous apprendre la vie». Sinon par la perte de notre mémoire nous risquons de nous couper de tous nos héritages. Est-ce facile de vivre sans trace ? Mais, est-ce possible surtout ? C’est par le souvenir autant que par l’oubli que respire notre mémoire. C’est autant par les souvenirs qu’elle prend soin de conserver que par ceux dont elle se déleste que la mémoire fidèle ou oublieuse accompagne notre vie.
Si, quelques fois, nous avons le sentiment diffus d’être si peu ou si maladroitement Algériennes ou Algériens dans nos travaux où nous n’avons pas fini de verser trop d’eau dans les moulins des autres, c’est que notre mémoire est vide des écrits que beaucoup de nos aînés ont laissés derrière eux comme une saine tradition, comme une vertueuse filiation. Max Jacob disait : «On ne chante juste que dans les branches de son arbre généalogique.» Avec quelles idées et avec quelles pensées, devrions-nous continuer à produire la connaissance que nous devons avoir de nous-mêmes pour que l’Histoire s’arrête, chez nous, de bégayer à l’université ?
Disposons-nous, véritablement, dans les profondeurs de notre mémoire d’une sorte d’herméneutique collective où sont rangés tous les ouvrages que nous avons lus de nos aînés et même ceux que nous avons oubliés mais qui, par leur effet, sont tous en mesure de nourrir nos réflexions et de les élargir pour approcher notre société dans toute son envergure déployée ?
Car, avec un appétit que nous avons vorace pour l’oubli, qui pourra demain se souvenir de ce que nous avons, réellement, été ? C’est parce que cette perte de connaissances est une perte tragique de soi que nous demeurons ensablés dans la difficulté d’aller très loin pour nous retrouver entiers dans nos racines. Cet oubli de soi est tellement ancien que le souffle risque de nous manquer si nous devons, ici et maintenant, entamer le long chemin qui nous fera retourner à l’endroit d’où l’on s’est lâché la main? Qui pourrait nous inciter à la réflexion critique sur nous-mêmes ? Comment donner un corps à l’historicité de nos réflexions sans l’appropriation de tous nos auteurs qui sont les frères jumeaux et les sœurs jumelles de notre ami Ali El Kenz ? De quel héritage sommes-nous, donc, le nom ? Sommes-nous condamnés à nous agripper juste au présent qui demeure très actuel mais surtout trop évanescent, et de nous en contenter, pour dire notre culture plusieurs fois millénaire
Voila, pourquoi nous sommes, aujourd’hui, presque dans l’incapacité d’avoir même un brin de nostalgie pour nous-mêmes et d’être dans «l’amour de notre destin pour rendre possible l’éternel retour» si cher à Friedrich Nietzsche. C’est parce que nous courons le risque de perdre notre patrimoine herméneutique qu’entre nous et le néant plus rien ne semble pouvoir nous protéger.
Nous devons veiller à être, au sens bourdieusien du terme, des «héritiers» dans notre université où, actuellement, la déshérence nous met dans l’inaptitude de penser notre société par nous-mêmes. La pensée critique ne saurait être possible sans la pensée de ceux qui nous ont précédés sur le chemin que nous avons choisi, comme eux, d’emprunter. Ali et bien d’autres nous ont laissé comme héritage un trousseau de clefs capable d’ouvrir les portes qui, jusqu’ici, nous ont empêchés de prendre le chemin qui nous fera revenir de nos errances comme de nos égarements. C’est de cette manière que monsieur Ali El Kenz, professeur de sociologie, aura à reprendre ses cours interrompus à l’université algérienne où, désormais, il sera, à jamais, vivant.
Même libéré du temps, «Aliouet» ne pouvait nous quitter pour bien loin. Il a juste «changé de pièce» pour reprendre cette formule combien simple et juste de Gabriel Garcia Marquez. C’est là où, le moment venu, nous aurons, dans le partage nouveau de nos anciens sourires, à nous retrouver, debout, dans notre propre mort.
K. T.
kennouchetayeb@yahoo.fr
Posté Le : 18/11/2023
Posté par : rachids